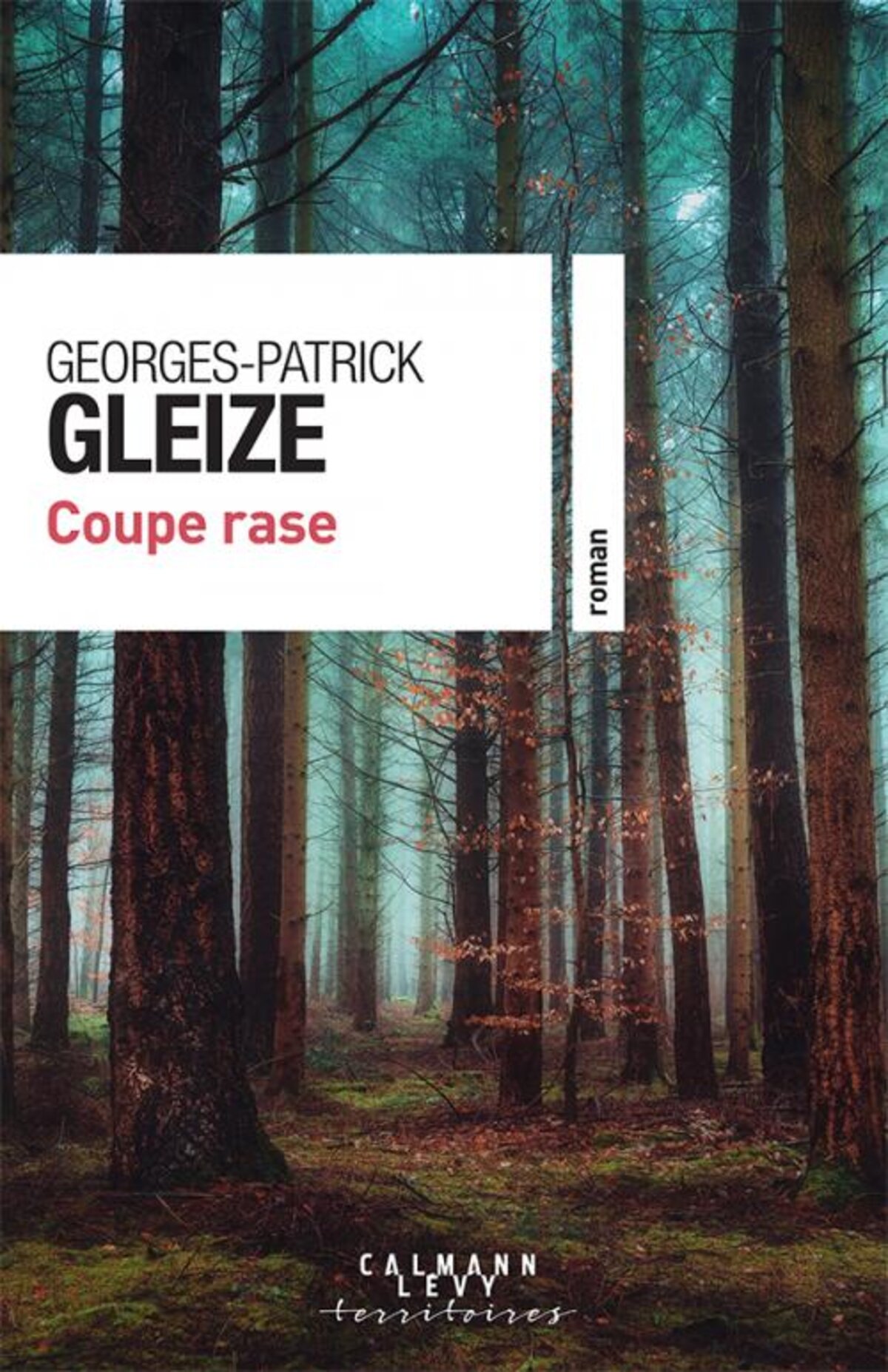
Agrandissement : Illustration 1
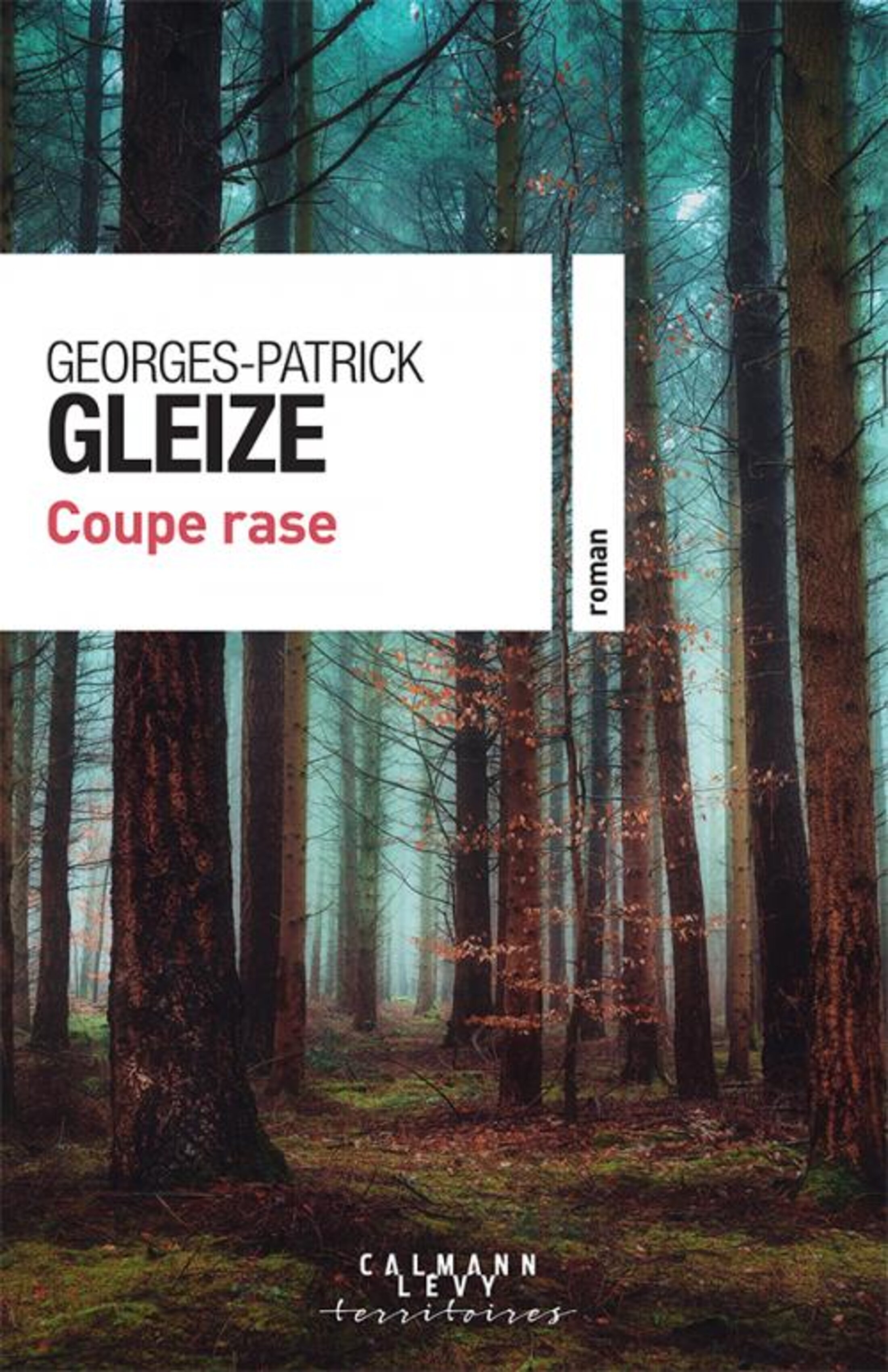
COUPE RASE
Par Georges-Patrick Gleize
Œuvre de fiction localisée à Mauriac, petite ville de la Haute-Corrèze, ce roman est le vingtième de Georges-Patrick Gleize, lit-on sur la quatrième de couverture.
Une macabre découverte saisit d’effroi un club d’aînés. L’image du talon d’un brodequin accroche le regard de l’un d’eux. Sous les branches, un cadavre.
Les randonneurs préviennent la gendarmerie qui intervient illico. Pour comble de drame forestier, la victime, Mathieu Champeix, un militant écologiste, a été tué d’un coup de sapie, « un pic à grumes, sorte de croc au fer courbe solidement emmanché dont les bûcherons se servent pour déplacer les troncs d’arbre.»
Une journaliste nommée Valérie Lafarge se rend sur les lieux. Divorcée, elle habite le 14e arrondissement de Paris et se décrit elle-même comme « une grande rouquine, coiffée à la lionne, un peu style Pretty Woman. »
Une plongée dans la nature sauvage
Le récit gratifie lectrices et lecteurs d’une évocation sensorielle de la beauté sylvestre.
Qui donc était ce Mathieu Champeix ? « Un gêneur, un empêcheur de tourner en rond. Le genre poil à gratter», répond à la journaliste un certain Chatel, un confrère qu’elle va rencontrer à Limoges. D’après lui, « cette consœur allait à l’échec », Chatel en était certain : « Elle se heurterait au mur poli de l’indifférence, à ce silence glacé que l’on réserve à l’étranger. »
Le décor, l’auteur le dépeint sous des angles variés qui ont pour effet de plonger le lecteur dans ce beau pays un peu sombre à la faveur d’une traversée des bois profonds. À commencer par la petite ville de Mauriac autour de laquelle gravite l’intrigue. Le maire de la commune se nomme François Lansac. Il est aussi le propriétaire d’une importante scierie établie sur le territoire de la commune. Que sait-il de cette coupe rase et du meurtre de l’écologiste qui s’y intéressait ?
Georges-Patrick Gleize s’y entend à imager en peu de mots les objets du quotidien, dans leur banale essentialité. C’est le cas quand il guide la journaliste Valérie, son personnage féminin principal, à l’intérieur de la maison de la presse du lieu. En quelques phrases nous recevons l’inventaire complet du magasin, avec son « lourd parfum de tabac au miel mêlé à celui de papier fraîchement sorti des rotatives. »
Il en va de même lorsque l’auteur restitue l’ambiance incomparablement typée d’un café-restaurant de la France profonde.
Faites venir les protagonistes !
On comprend vite que des pressions se sont exercées sur ceux des habitants de la commune qui sont susceptibles de fournir quelques miettes de vérité. Des personnages peu recommandables émergent peu à peu, tel ce Xavier Borderie, « un marchand de bois véreux » dont on se dit qu’il pourrait bien avoir tenu un très mauvais rôle dans cette affaire. C’est vrai également pour une poignée d’autres. Attendons et lisons plus loin avant de nous prononcer et saluons le docteur Vareilles. Lui, qui sonde les reins et les cœurs du tout Mauriac, pourrait peut-être nous en apprendre davantage sur les suspects potentiels, sur celui qui aurait pu frapper à mort ce malheureux Champeix.
Au bout d’un peu moins de deux cents pages de ce roman construit sur du solide, des pistes diverses et heureusement semées d’embûches s’offrent au lecteur. Tracées au cordeau sensible : elles animent le fébrile récit d’un phrasé incisif.
Georges-Patrick Gleize n’est pas historien pour rien. Il prend soin de fournir les éléments factuels nécessaires, non seulement à la lecture, mais aussi à la culture générale du lecteur, comme lorsqu’il rappelle l’historique ferroviaire des lignes disparues.
On mange bien, dans ce récit. Les données gastronomiques y produisent un effet divertissant. Citons notamment le passage où l’auteur évoque la Salers et son « zeste de fraîcheur en plus » ou encore le «quart de poulet à la crème » qui nous passe allègrement sous le nez.
Cette alternance d’hédonisme, de gourmandise et de crasse cruauté, confère au récit une saveur où le doux ne va jamais sans le très aigre, le mordant et l’atrabilaire. Combien sont-ils à vouloir attenter aux jours du moindre curieux qui s’approcherait un peu trop de la margelle du puits d’où sortira la vérité ? On verra quel instrument de torture figure dans leur atroce panoplie…
Les bienfaits littéraires de l’éloignement
Quand on a lu les récents romans ariégeois de Georges-Patrick Gleize, on constate que ce livre-ci lui a offert un dépaysement, même si notre auteur connaît bien la Corrèze, à laquelle de multiples liens affectifs et culturels semblent le rattacher. Cela permet de constater que l’auteur n’a nul besoin d’être chez lui pour exceller. Cet ailleurs de son écriture a pourtant l’avantage d’aiguiser son regard sur une matière littéraire nouvelle, vivante, visuelle et vraie.
Le lecteur découvrira que la chute de ce roman propose une formulation suscitant à elle seule une utile réflexion. Nous pouvons livrer ici la phrase-clé sans trahir le dénouement du récit : « Le devoir de réserve n’est pas en contradiction avec le droit d’informer, » fait remarquer Valérie Lafarge, valeureuse journaliste d’investigation.
Ce vingtième récit romanesque de Georges-Patrick Gleize a l’étoffe d’un roman noir qui ferait parler le terroir, avec minutie et caractère. L’enquête menée presque uniquement par la pétulante et accorte journaliste, ne fait pas de ce roman un ixième polar. Il a pour lui cette qualité qui consiste à représenter des réalités sociale, culturelle et géographique, dans toute leur désarmante et palpitante ambivalence.
Pierre-Jean Brassac
Georges-Patrick Gleize, collection Territoires, Éditions Calmann-Lévy, 2022, 309 pages, 19,90 €



