Au loin grondait l’orage, par Muriel Batave-Matton
Un récit qui invite le lecteur à une délectable nostalgie, non pas tant d’une époque révolue, que d’un type de société éteint à jamais.
On se souviendra que lorsque commence le roman, en 1905, quelque 80% des foyers européens vivent directement de la terre. Ils seraient à peine 2% aujourd’hui. Révolution silencieuse et disparition d’une civilisation…
Belle réussite que celle de l’auteure dont les réflexions et les outils littéraires servent une restitution anthropologique à grands traits de deux mondes culturellement opposés : la campagne corrézienne et le pavé de la Capitale.
Selon les lieux, il y a ceux qui défendent simplement leur vie, et d’autres leur patrimoine. C’est ce que tient Charles, personnage masculin principal de l’histoire, de la bouche même de sa belle-mère : « La seule chose qui commande est la sauvegarde du patrimoine ! La seule, entendez-vous ? » Il n’empêche que certaines alliances paraissant financièrement judicieuses peuvent s’avérer foncièrement calamiteuses pour l’esprit, et funestes pour la joie de vivre.
D’un chapitre l’autre, Muriel Batave-Matton nous fait changer de société et de monde. Cela donne à la temporalité du roman la forme de deux courants parallèles et continus qui s’écoulent pourtant à des rythmes distincts.
Son récit fait défiler sous les yeux du lecteur plusieurs générations de Français du début du 20e siècle.
La langue élégante et énergique sert un texte d’une agréable lisibilité. Et souvent d’une certaine beauté. Si un bon film nous captive au point de nous faire oublier que l’écran n’est qu’une toile de PVC tendue, un roman comme « Au loin grondait l’orage » nous persuade vite que nous regardons un monde bien réel.
Si elle n’était pas cette romancière authentique que nous connaissons, Muriel Batave-Matton pourrait certainement mettre sa virtuosité verbale au service d’une cause sociale, d’un militantisme et d’une lutte contre les injustices. En témoignent les accents compassionnels dont elle fait preuve par endroits. Sa grande affaire demeure le féminisme, tant il est vrai que les femmes sont les grandes victimes sociales du nouveau siècle qui s’entrouvre à peine à elles.
Chemin d’écriture faisant, l’auteure ne se départit jamais d’une forme d’optimisme qui atteste qu’un roman peut se déployer tout à la fois selon des principes idéologiques, voire militants, quoique constellés de revirements heureux. C’est le cas lorsque le sobre personnage de Germain obtient un poste de palefrenier, ou quand d’autres personnages, ni transfuges ni déclassés, parviennent à trouver une place —leur place dans la société de la première décennie du 20e siècle.
Parmi les morceaux de bravoure du roman, on aime sans réserve la négociation bon enfant entre la châtelaine et la nouvelle institutrice qui cherche un local pour abriter sa classe.
Parmi d’autres considérations sociologiques, culturelles et historiques, ce roman montre les conséquences d’une tentative d’oubli des origines. Charles, personnage évolué, centralien de formation devenu Parisien, mène une vie de déraciné, quoiqu’en apparence confortable. « Le meilleur de lui-même était resté au fin fond de la Corrèze, » nous apprend cette attachante fiction littéraire.
Une question émerge : existe-t-il une fatalité, un éternel retour des données biologiques, généalogiques et sociologiques identiques, qui contraindrait à vivre et revivre indéfiniment les mêmes situations par des générations successives ?
Toute cette histoire de vies humaines repose sur une habile construction animée de ressorts qui conduisent le lecteur à désirer par anticipation les scènes et actions que distillera en effet par la suite l’auteure au meilleur de son art des situations et des « confusions généalogique.» Untel se découvre un demi-frère, et « c’était un peu fou, de penser qu’on allait célébrer ses noces tout à l’heure et qu’il allait épouser celle qui attendait l’enfant de son frère. Comme un retour à l’envoyeur, un pied de nez au destin. »
Avec ce neuvième roman, Muriel Batave-Matton donne, me semble-t-il, une nouvelle confirmation incontestable de sa stature littéraire.
Pierre-Jean Brassac
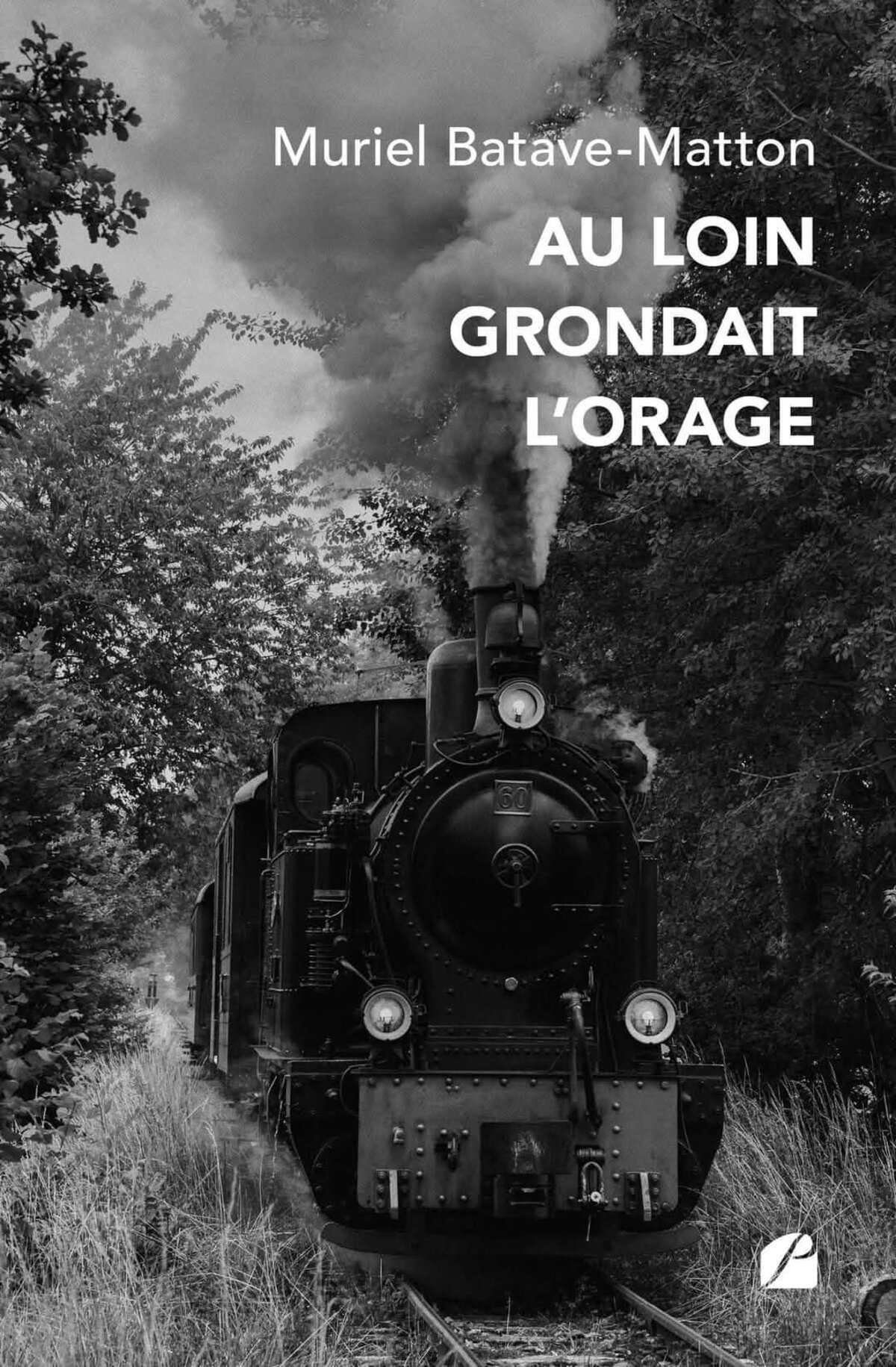
Agrandissement : Illustration 1

Au loin grondait l’orage, roman, par Muriel Batave-Matton.
Éditions du Panthéon, 268 pages, 21,90€



