
Agrandissement : Illustration 1
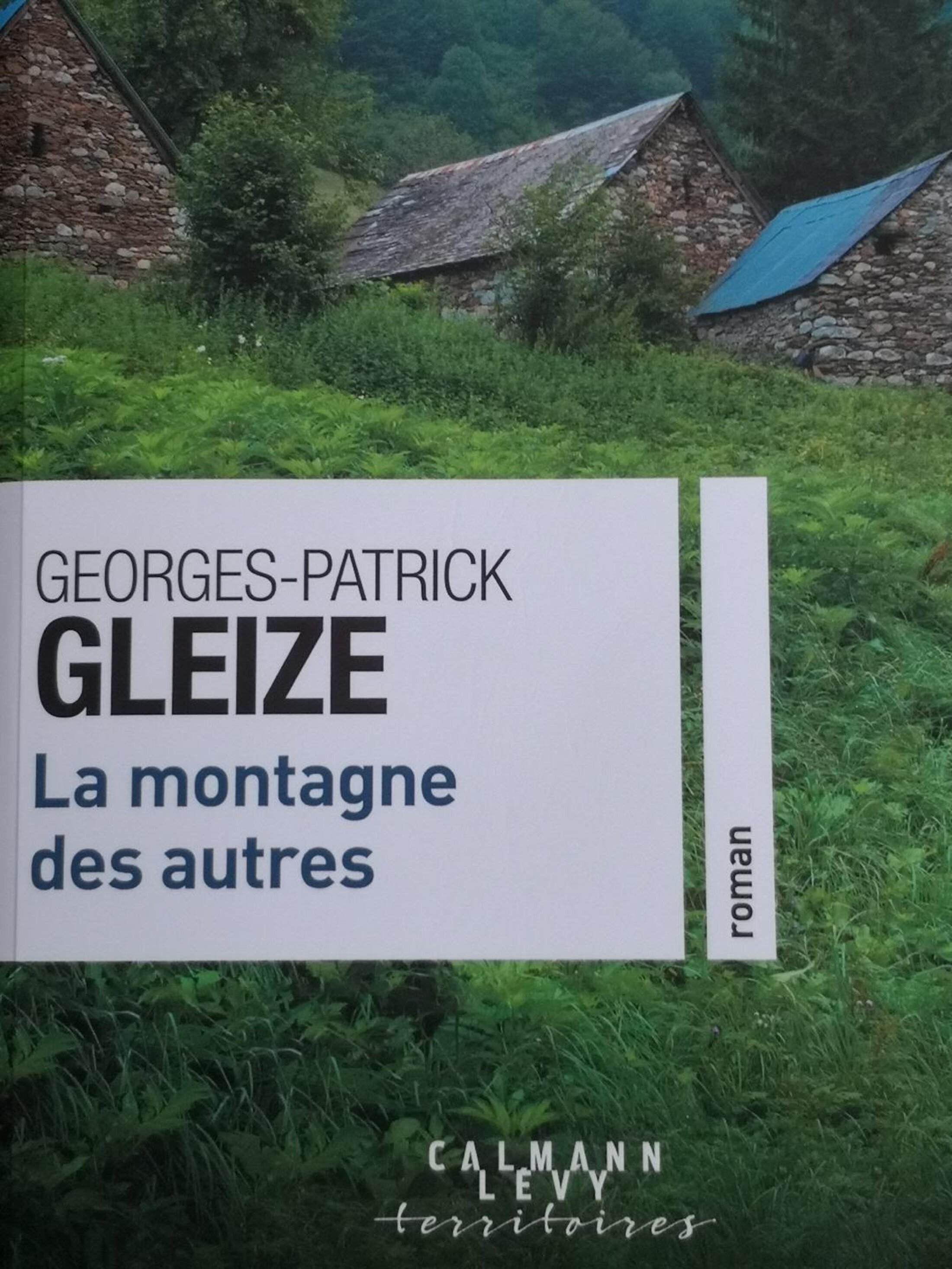
Des gens du terroir, des gens du cru
Un sujet pas souvent traité bien que générateur de situations belliqueuses. Un sujet qui nous remet en mémoire Georges Brassens et sa Ballade des gens qui sont nés quelque part. Ces « porteurs de cocarde empalés une fois pour toutes sur leur clocher. » Irrévérencieux, certes. Mais réaliste.
Laura Farges habite Fontainebleau, elle enseigne l’histoire et la géographie dans un établissement de la ville. Un message de sa mère Brigitte tombe dans sa boîte à lettres. Dans l’enveloppe, un article qu’elle a découpé dans La Dépêche du Midi pour appeler sa fille à davantage de prudence en ce qui concerne les dangers de la montagne. Il faut dire que son frère est mort dans les Alpes, âgé de vingt et un ans.
C’est la fin de l’année scolaire. Laura s’apprête à partir en vacances. Ce seront des vacances studieuses : elle doit achever la rédaction de sa thèse de doctorat.
À bord de sa Peugeot 307, elle part pour l’Ariège avec son bagage bourré de livres. Elle passe chez sa mère qui lui remet à regret la grosse clé du logis où elle doit séjourner. S’enfermer dans une contrée aussi éloignée de tout, c’est-à-dire au-dessus des villages de Vicdessos et Auzat, quelle idée !
L’ultime portion de chemin de montagne s’avère obstruée par un fil de fer barbelé que signale un chiffon rouge. Cet empêchement forme la première menace d’une abondante cascade que déclenchera la présence de Laura.
Le temps s’arrête, la tension monte
Georges-Patrick Gleize situe son récit dans un univers à la fois rural et complexe, personnel et singulier ; il aime la vie quotidienne et ses traces dans le décor intérieur. Son art consommé de la description ponctue la temporalité condensée du récit en scènes et tableaux où persiste une menace douloureusement indéfinie…
Rien n’échappe au narrateur, même pas la mouche bleue qui, au cœur de l’immensité pénètre simplement par une fenêtre de la sombre habitation où vient d’entrer Laura Farges. Les objets présents portent la marque du temps : « une pomme oubliée s’était fossilisée dans une coupe en faïence de Martres-Tolosane aux couleurs chatoyantes. » Tout à côté se trouve, « juché sur une console en bois fruitier, un poste de radio flanqué d’un chandelier de cuivre jaune où un moignon de bougie jaunissait, laissait deviner un espace propice à la sieste. »
Laura va passer seule sa première nuit dans cet environnement sauvage et lugubre qui ne favorise pas le sommeil. Au début de la nuit, de gémissements en hurlements, des bruits de plus en plus inquiétants percent la nuit. Elle perd tout espoir de pouvoir s’endormir.
Quand elle rencontre La Louve, une Hollandaise installée dans le hameau depuis des années, Laura n’est plus seule. Pourquoi, La Louve ? Eh bien parce qu’elle élève des loups. L’auteur nous la caractérise sur le ton de l’aphorisme, avec une marquante subtilité : « Orpheline des frissons du bonheur qui rendent la vie plus belle, elle était veuve de l’espérance communicative qui déborde du cœur de celui qui n’a que l’amour pour armure. »
Gleize nous apprend ce qu’est un tustet, sorte de déclaration de guerre sournoise qui consiste à s’amuser à plusieurs aux dépens d’une personne à qui l’on a décidé de nuire.
Laura sera plusieurs fois victime de cette pratique. Les auteurs du harcèlement se sentent propriétaires exclusifs de la montagne. « On est ici chez nous » répètent à l’envi ces protagonistes locaux de l’histoire. Les choses vont-elles s’arranger pour Laura malgré la pesanteur de l’épais mystère. Il y a bien ce personnage revenu d’Argentine qui aurait voulu, dit-on, implanter par ici, au-dessus de la vallée de Vicdessos une station de sport d’hiver… Les choses ne font que commencer.
L’auteur voue, lui, une affection certaine à ce pays ariégeois où se passe le plus clair de son roman à suspense. L’homme est né à Paris, a vécu, étudié et enseigné « du Nord au Sud », et n’est nullement suspect de chauvinisme. Les origines ariégeoises de sa famille ne sont assurément qu’une donnée parmi d’autres dans la représentation du monde de ce docte écrivain.
Bref, Georges-Patrick Gleize n’est aucunement de ceux qui « nous font voir du pays natal jusqu’à loucher. » Il se rangerait peut-être de préférence parmi ceux qui, comme Michel Torga, professent que « L’universel, c’est le local moins les murs. » Un avis qui confirme implicitement toute l’importance du local.
Et justement, certains se laissent aller à imiter ces « gens qui regardent le reste avec mépris du haut de leurs remparts, » dont parle le poète de Sète et de partout.
À qui donc appartient la montagne ?
Aimer d’amour son lieu de vie, son village, son hameau, pourquoi pas ? Mais cela sans ériger de murs d’aucune sorte, sans exclure a priori qui, venant d’ailleurs, veut y vivre aussi. L’amour est salutaire s’il n’est pas ourlé de haine. C’est ce que suggère l’auteur de La montagne des autres, en choisissant de rappeler en exergue la saine pensée de Martin Luther King : « La noirceur ne peut pas chasser la noirceur. Seule la lumière peut le faire. La haine ne peut chasser la haine. Seul l’amour le peut. » Or, l’histoire qu’il nous raconte est une histoire de haine destructrice.
Le titre du roman installe sa propre ambiguïté. Cette montagne est-elle la nôtre ou celle des autres ? Est-ce la leur ou la vôtre ?
Avant que le délétère n’empoisonne l’existence de tous les protagonistes sans exception, on voit bien que leur cadre de vie est en puissance une exceptionnelle Arcadie.
Dans des romans précédents, tels que Les noisetiers du bout du monde et Même les pierres ont une histoire, Georges-Patrick Gleize nous offrait des sagas où évoluait une élite sociale sur plusieurs décennies. Dans La montagne des autres, la noire intrigue se trame dans un hameau clairière où la lumière n’éclaire pas tous les esprits. Le danger ne venait pas de la montagne, comme la mère de Brigitte le redoutait dans sa lettre, mais des habitants.
Cette déchirante histoire nous fait entendre le tic-tac insupportable du complot, avant le démontage pièce par pièce du mécanisme raffiné de l’horloge.
Pierre-Jean Brassac
Georges-Patrick Gleize, La montagne des autres, coll. Territoires, Calmann-Lévy, 323 pages, 19,50 €



