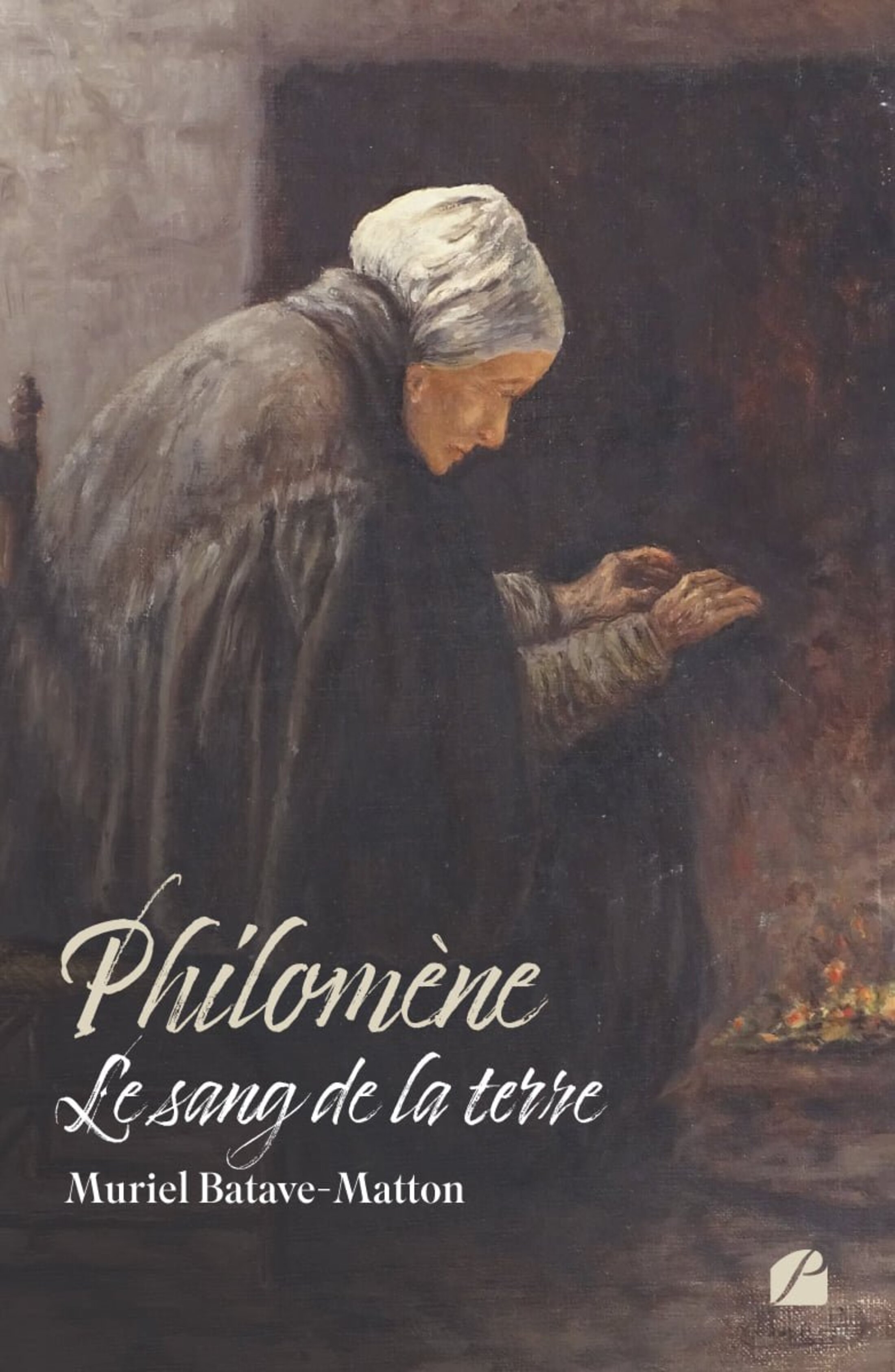Philomène. Le sang de la terre
un roman de Muriel Batave-Matton.
Voici tout un monde romanesque où l’inconstance inévitable des sentiments fluctue au gré des évènements qui affectent les communautés rurales et bourgeoises de la Corrèze au cours des dernières décennies du 19e siècle.
Les temps politiques le jalonnent ici et là : la grève des mineurs de Decazeville, le boulangisme. On constate que MeToo n’est pas la grande affaire du seul 21e siècle : le 19e connaît sa part d’abus sexuels. Pourtant le silence y est encore la règle. Les femmes comptent sur la protection des maris, encore faut-il qu’elles en aient un, ce qui est loin d’être le cas des filles de ferme et autres soubrettes que la gent masculine prend si souvent pour proie. Paradoxe : bien que non voulu et dénié, le mélange des sangs abâtardit la société de ceux qui se pensent comme une élite.
En un peu moins de trois cents pages, ce que nous propose Muriel Batave-Matton n’est rien de moins que cinq années de la vie quotidienne en Limousin dans deux univers fort éloignés l’un de l’autre, que l’économie rapproche pourtant parfois.
Louons les auteurs qui, comme elle, nous font revivre un édifiant passé grâce à la littérature et la minutie de leurs écrits, aidés en cela par la distanciation historique et la vivacité de leur imaginaire.
Comment l’on devient transfuge de classe
Lorsque la jeune Philomène quitte le pauvre toit familial, elle devient domestique au château de Bellecombe, propriété des Després. Antoine Després, le père, vient de trouver la mort dans un accident de chasse.
Son fils, Louis, épouse une certaine Charlotte Delage. La naissance de Charles, leur enfant, sonne aussitôt le glas de tout rapport sexuel entre Louis et Charlotte. Ainsi en a décidé Jeanne, la mère de Louis, afin de prévenir tout risque de division des biens.
Dès lors, Louis, le Monsu, se fera une spécialité de transporter ailleurs ses pulsions et ses désirs ; il ira de séductions singées en exultations ancillaires et culbutera à tout va les jeunes domestiques au service de sa caste.
La vie de Philomène bascule : les domestiques du château de Bellecombe constituent sa nouvelle famille. L’auteure nous en dépeint les moeurs avec verve et force détails pittoresques en cette fin du 19e siècle en Corrèze
Au fil de son parcours, la sage et exemplaire Philomène réussit une évolution sociale qui devient aussi la salutaire transformation de sa personne. Elle se forme, se perfectionne, s’attache à « parfaire sa lecture », et saura bientôt lire à haute voix les potins du Petit Journal pour distraire Jeanne, la douairière du château de Bellecombe. Mais pas seulement, bien sûr. Avec l’acquisition d’un langage plus riche et nuancé, sa pensée et son jugement s’affermiront, tandis qu’elle saura de mieux en mieux ce qu’elle veut et ne veut pas.
Cet aspect forme l’un des attraits du récit, tant il est vrai que l’on se plaît à admirer, de saison en saison, le cheminement personnel de la jeune paysanne. Elle s’affranchit peu à peu des pesanteurs de son milieu d’origine. Son histoire est celle d’un épanouissement, d’une revanche sur la destinée que tout un chacun dans des conditions similaires pourrait légitimement ambitionner.
Marie, la sœur aînée de Philomène se voit contrainte de choisir une voie opposée qui, la conduisant dans les ordres, l’écartera pour toujours du temporel.
La civilisation rurale du face-à-face
Les femmes se surveillent les unes les autres : Jeanne surveille Charlotte qui surveille Philomène qu’elle croit à tort naïve et mal dégrossie, quoique bien installée à Bellecombe et reconnue de presque tous.
Contre toute attente, la jolie Philomène semble pouvoir échapper aux assauts du maître. Car Le Monsu, comme on le nomme en patois, semble s’assagir radicalement par la seule grâce de la jeune femme.
Philomène ne ressemble pas aux habitants de son hameau ; une « distance de plus en plus grande » la sépare des siens. Plus qu’une différence, cette distance se résume à un écart mental et culturel. Un écart vis-à-vis du bas comme du haut de la pyramide sociale. Elle occupe une place qui lui est propre. Tout sauf charmeuse, son prénom sonne pourtant comme un charme : Philomène, c’est un peu philomèle, c’est-à-dire rossignol, du latin philomela. Jolie blonde, elle s’attire, malgré elle, l’admiration de Germain, le palefrenier du château. D’amour éperdu, le jeune homme déploiera en vain des prodiges d’attention et de calculs.
Quant à Louis Després, ses affaires vont bien. Il a su prendre les bonnes décisions et gère convenablement son domaine. Cela n’empêche pas son mariage de tourner au fiasco.
La sape sournoise du secret de famille
C’est là que Marie, l’aînée, la religieuse, interviendra pour révéler un lourd secret.
L’auteure fait tout ce qui est en son pouvoir littéraire — qui est considérable — pour susciter chez le lecteur une affection spontanée à l’égard de la personne de son héroïne au parfum de pomme.
La mort d’Augustine, mère de Philomène, initie chez cette dernière une lancinante interrogation existentielle : pourquoi sa mère ne lui a-t-elle jamais témoigné d’amour ?
Puis vient la première des scènes fondatrices du roman. Éblouie par la beauté d’une robe découverte en cachette, Philomène ne peut résister à la tentation de la revêtir un instant, ne sachant pas que le maître des lieux la contemple, ému de tant de joliesse.
Un roman composé avec une incontestable force narrative, structuré qu’il est en cinq actes selon la dramaturgie shakespearienne ou cinq mouvements à l’instar des « Souvenirs de la vie rustique » de Beethoven, plus connus sous le titre de « Symphonie Pastorale (n°6) ».
Les accents du patois fleuri sont là pour relayer tout à la fois sagesse paysanne et inventivité langagière de ce pays d’oc. Le plaisant vocabulaire régional orne le texte de part en part, tandis que l’auteur prend soin de fournir pour chaque terme sa traduction en français courant.
L’issue du drame s’imposera d’elle-même dans une situation plus que regrettable dont on appréciera pourtant la cohérence philosophique.
La campagne, la nature, les saisons, la culture —tout le texte sobrement empreint de délicates tonalités géorgiques offre, ainsi que ses attachants personnages, un bonheur de rencontres et de lecture.
Pierre-Jean Brassac
« Philomène. Le sang de la terre »,
par Muriel Batave-Matton, Éditions du Panthéon, 2022
267 pages, 19,90 €
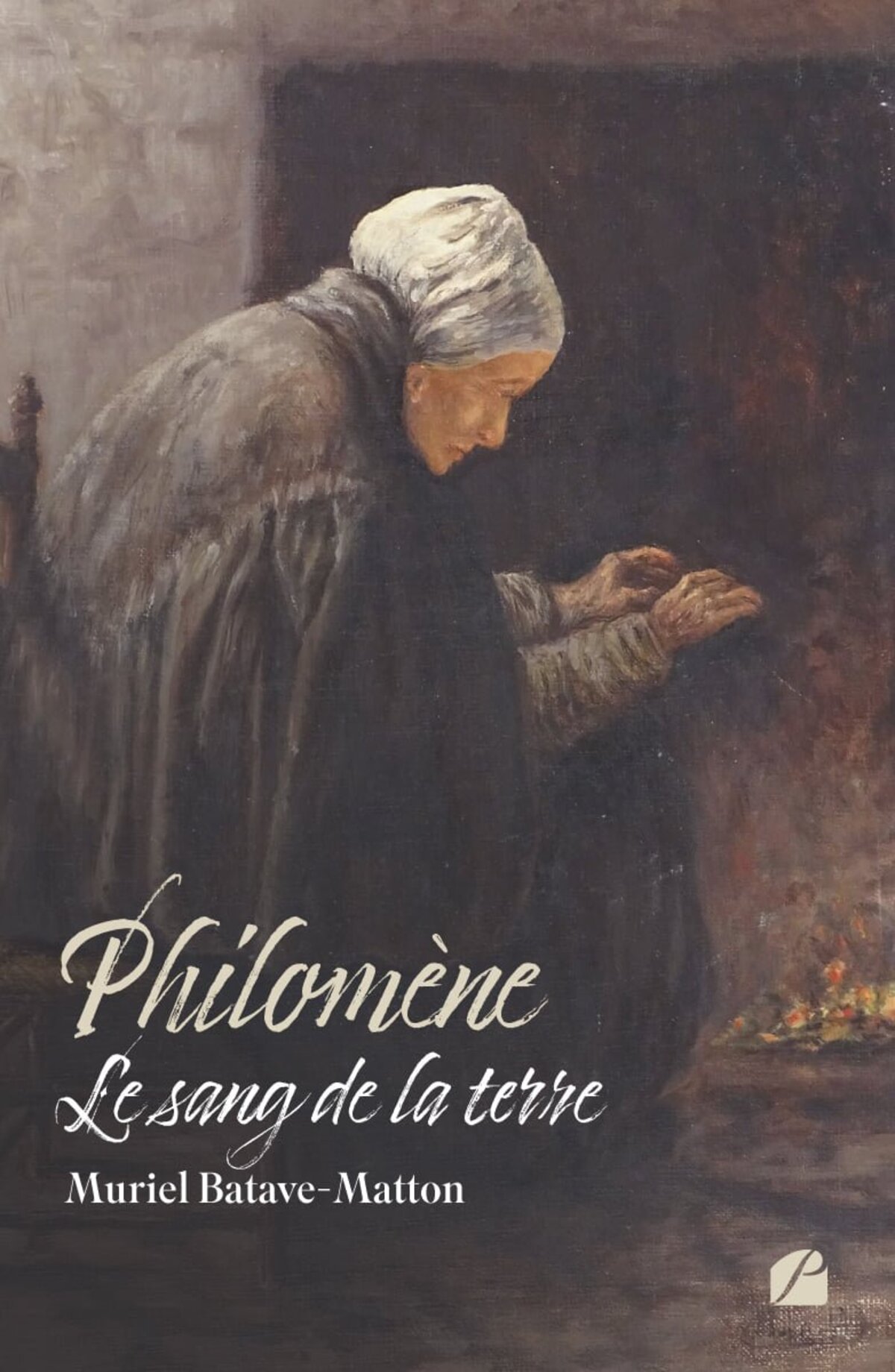
Agrandissement : Illustration 1