– mise à jour le 16 janvier 2023
Le maillon du développement urbain est la route. Sans le réseau routier, la liberté de mouvement serait diminuée et le monde serait coupé de tout. Pour autant, il est temps d'en réduire son extension à l'infini, comme il est temps de revenir à une raison moins individualiste dans nos modes de déplacement.
l nous faut une prise de conscience. Nos décideurs doivent changer leur regard sur la mobilité. Les problèmes climatiques nous forcent à agir, poussés par des contraintes énergétiques et sociales où les inégalités ne cessent de croître. Si nous n'agissons pas, la notion de liberté individuelle s'adressera davantage qu'à une élite. Est-ce ça que nous voulons ?
Oui, le transport des personnes et des marchandises, devient un casse-tête. Sortir de la logique du tout-routier ne concerne pas uniquement les autoroutes et routes, elle vaut également sur la place de la voiture dans les centres-villes.
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES,
DÉPLACEMENTS URBAINS ET MODES DE VIE
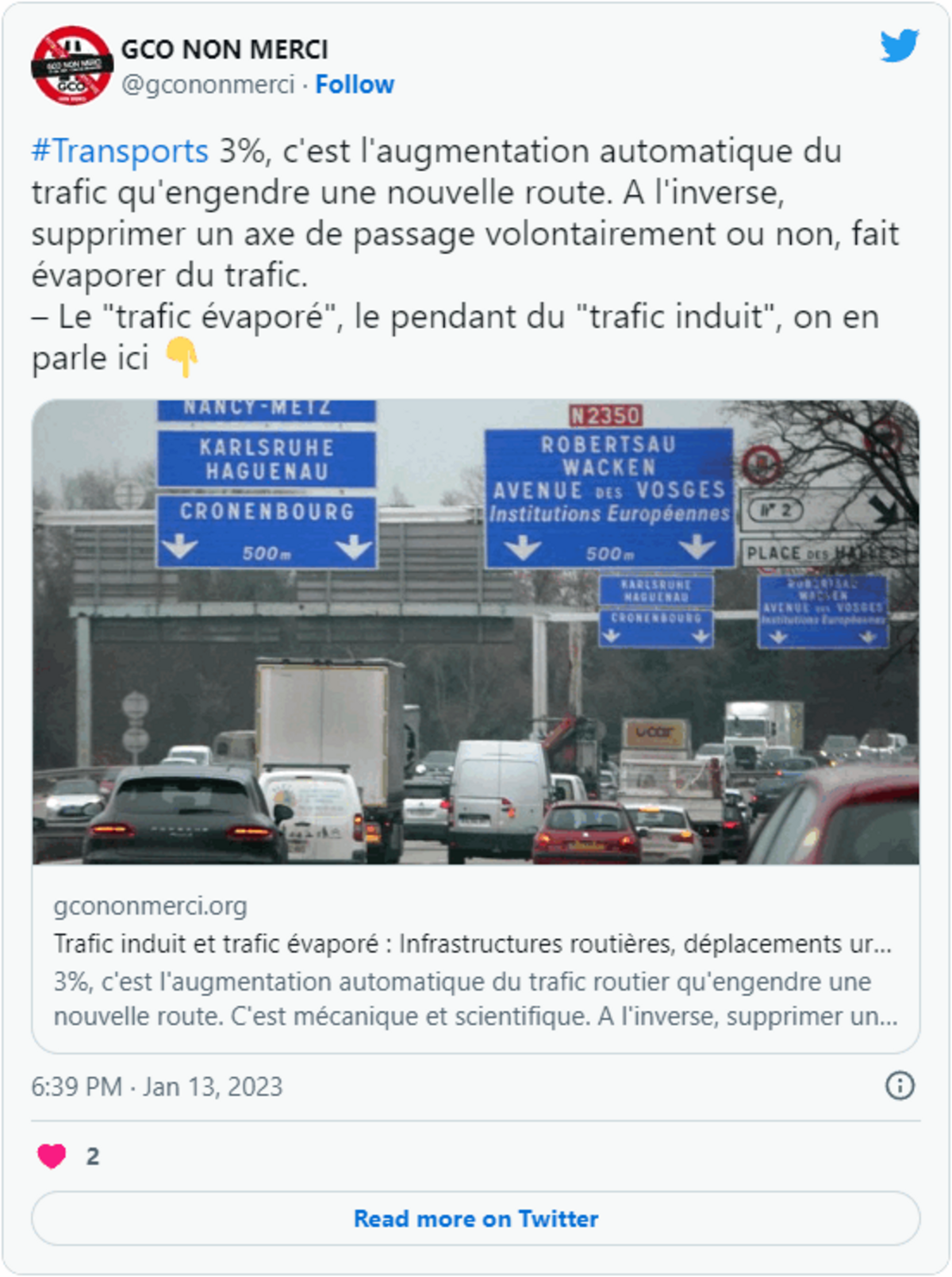
Agrandissement : Illustration 1

Le « trafic évaporé », le pendant du « trafic induit »
3 %, c'est l'augmentation automatique du trafic routier qu'engendre une nouvelle route. C'est mécanique et scientifique. Dans les déplacements, contrairement à ce qu’affirment les milieux économiques, travailler à réduire le trafic routier n’a jamais les conséquences catastrophiques qu’ils annoncent. Elle contribue à l’inverse à améliorer l’attractivité...
Autoroutes et voies rapides sont des « aspirateurs à voitures » (c’est le trafic dit « induit »), dénoncent les critiques de l’automobile. A contrario, supprimer ces infrastructures entraînerait « une évaporation du trafic » (c’est le trafic dit « déduit » ou « évaporé »). Est-ce bien sérieux ? Par quel prodige pourrait-on faire naître de tels effets ?
Ces phénomènes sont pourtant scientifiquement fondés et abondamment documentés.
– pour comprendre :
Le « trafic évaporé », le pendant du « trafic induit ». Pourquoi supprimer des autoroutes peut réduire les embouteillages
Mais de nombreux élus et professionnels ne l’admettent toujours pas, limitant ainsi leur capacité à adapter nos villes aux exigences sociétales et environnementales du XXIe siècle. Voilà à quoi les militant(e)s et villageois(es) ont été confronté(e)s sur la lutte contre le contournement ouest de Strasbourg et c’est cela même qui crispe les tentions sur d’autres projets que pointent la coalition La Déroute des Routes.
Quand on comprend le mécanisme du trafic routier, on comprend que les deux phénomènes sont la preuve qu’il existe bien plus d’élasticité dans l’évolution de la circulation automobile que ne le sous-tendent les modèles de trafic.
D’une part, à cause du trafic induit, les nouvelles capacités routières sont vite saturées et les embouteillages reviennent. Il est donc illusoire de croire qu’il suffit de quelques investissements routiers pour diminuer les bouchons, comme tant de politiciens l’affirment. C’est pourquoi l’Autorité environnementale (entité indépendante qui donne son avis notamment sur les grands projets routiers) recommande d’en tenir compte.
D’autre part, grâce au trafic évaporé, la réduction des capacités routières, ne provoque pas de congestion durable, car les automobilistes s’adaptent plus qu’on le croit.
Toutefois, il convient, comme le soulignait déjà Jane Jacobs (auteure, militante des droits de l'homme et philosophe de l'architecture et de l'urbanisme canado-américaine), d’ajuster le rythme d’apaisement du trafic aux capacités d’adaptation progressive des usagers et la mise en œuvre d’autres options positives.
Le déplacement urbain : sortir du dogme « pas de parking, pas d'affaires »
Sortir de la logique du tout-routier vaut également à la place de la voiture en centre-ville. Ainsi, il faut en finir avec le dogme du « no parking, no business ». Les difficultés des commerces de proximité sont ailleurs.
L’idée de freiner le développement des zones commerciales périphériques commence à faire son chemin. Y a encore du boulot à l'exemple de l'extension de la zone commerciale de la Vigie au sud de Strasbourg – voir l'article des DNA « Le centre commercial La Vigie gagnera 10 000 m² ».

Agrandissement : Illustration 2

En revanche, les avis divergents fortement sur la façon de traiter l’espace public pour redynamiser le centre-ville et sur les actions à mettre en place pour organiser la mobilité
Les conflits d'usage et perspectives sont parmi les tensions qui existent par exemple à Strasbourg. La municipalité réfléchit à la réorganisation de son espace public : stationnements, aménagement de son centre-ville pour le rendre exclusivement piéton et cyclable. Autre exemple qui suscite des interrogations et parfois même une forme de violence, toujours sur l'agglomération strasbourgeoise, au nord de l'Eurométropole sur les communes de Schiltigheim, Bischheim ou Hoenheim où l'extension du tram va transformer l'axe où il doit passer : depuis la place de Haguenau en direction de la Route du Général de Gaulle / Route de Brumath et les réflexions en cours pour éviter un report du trafic routier via la Route de Bischwiller (Schiltigheim /Bischheim) / Rue de la République (Hoenheim).
– à lire:
Commerces de proximité : en finir avec le dogme du « no parking, no business »
Ce qui est certain, c'est que nous devons sortir de cette logique individualiste autour de la voiture dans nos modes de déplacements. Les enjeux climatiques, écologiques, énergétiques et sociaux nous y obligent. Il ne s'agit pas de la bannir totalement, mais d'en réduire notre dépendance et réfléchir notre mobilité différemment.

Sortir de la notion individuelle de la voiture
Le changement fait peur. Il fait doublement peur et suscite une forme de rejet parce qu'il touche notre liberté individuelle. Or, face aux problèmes climatiques et énergétiques, nous n'avons pas d'autre choix que de changer nos habitudes. Les énergies fossiles se réduisent. La fin des moteurs thermiques se profile. En Europe, l'Union européenne a décidé de les interdire dans les véhicules neufs à partir du 1er janvier 2035. Remplacer à terme, le parc automobile par une motorisation électrique est impossible, contrairement à ce qu'à laisser entendre le Président Macron dans une interview en fin d'année 2022. Aura-t-on une autre technique de masse pour les moteurs du futur ? Il y a l'hydrogène. Mais rien ne garantit qu'il pourra être produit en grande quantité.
Par conséquent et pour éviter d'accentuer la pression sociale qui pèse sur les ménages modestes et pauvres, notre société doit repenser la manière de nous déplacer. Elle doit reconnecter le monde rural à la ville en matière d'offres de mobilités alternatives à la route pour sortir de la dépendance à la voiture. Cela implique de mettre en oeuvre des investissements colossaux dans les transports collectifs de manière à les rendre fiables, peu onéreux et dans une temporalité qui permettent de répondre aux exigences du quotidien : travail ou école par exemple.



