Lorsque j'entends parler de la croissance économique et de son hypothétique retour, je ne peux m'empêcher de songer au choc qu'eurent les premiers astronautes en découvrant la terre sous cet angle:
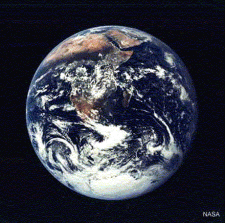
1) Le principe de finitude
La conquête de l'espace nous a mis en quelque sorte « sous les yeux » la finitude de notre petite planète bleue. Même sans aller dans l'espace, il nous suffit de prendre n'importe quel moyen de locomotion moderne (voiture, train, avion) pour nous rendre compte du rétrécissement des distances qui a caractérisé le XXème siècle et qui est vécu aujourd'hui comme un fait établi. Ce rétrécissement, combiné à l'accroissement vertigineux de la population humaine (9 milliards d'humains prévus en 2050 selon les projections actuelles), nous oblige à nous représenter nous-mêmes au sein d'un monde fini. L'épopée des civilisations occidentales s'est construite sur un postulat d'un « monde infini » dans lequel il y avait toujours de nouveaux territoires vierges (ou présentés comme tels) à conquérir. La « découverte » de l'Amérique, puis, au sein de celle-ci, la conquête du grand Ouest, font partie des légendes fondatrices de notre civilisation.
2) La croissance (jusqu'à l'infini)
Le postulat économique actuel suppose une croissance infinie (puisque, lorsqu'il y a stagnation ou décroissance, on considère que l'on est dans une crise dont il faut sortir au plus vite). La finitude de la terre et de ses ressources a pourtant bien été prise en compte par certains économistes (Malthus au début du XIXème siècle, le Club de Rome dans les années 1970), mais la pensée économique dominante – orthodoxe - nie farouchement ce postulat pourtant incontestable. Le progrès technique est alors invoqué d'une façon incantatoire pour balayer d'un revers de main le problème de la finitude des ressources. Et la rumeur populaire entretient en permanence des mythes confortables qui « prouvent » que la technologie sera la réponse au problème et évite de se poser des questions embarrassantes.
3) Le mythe de la pile à hydrogène, utilisé pour conforter le postulat de la croissance (jusqu'à l'infini)
A titre d'exemple, je vais mettre en exergue un de ces mythes tenaces qui, sous le couvert d'un langage « scientifique », aboutit, passez-moi l'expression, à « nous enfumer »:
. Le mythe:
« La pile à hydrogène va remplacer le moteur à explosion dans les futures voitures, qui deviendront ainsi propres et résoudront la problème du pétrole »
. Les questions qui sont éludées grâce au mythe:
1.La finitude des ressources en pétrole et en gaz (sous-entendu: la pile à hydrogène est basée sur un nouveau carburant – l'hydrogène – qui va nous libérer de la servitude du pétrole et nous permettre de continuer à circuler indéfiniment dans nos voitures individuelles).
2.La pollution et l'émission des gaz à effet de serre (sous-entendu: La réaction hydrogène/oxygène produit de l'eau: on ne peut pas faire un moteur plus propre).
. Pourquoi la pile à hydrogène est-elle un mythe ?
Loin de moi l'idée de contester le fonctionnement d'une pile à hydrogène qui est effectivement « propre » et permet de fournir de l'électricité facilement. Le sophisme – et c'est là que se situe la perversité du raisonnement – consiste à assimiler l'hydrogène à une source primaire d'énergie. Or, sur terre, l'hydrogène libre ne se trouve qu'en très petites quantités. En réalité, pour obtenir de l'hydrogène, il existe deux procédés (un procédé chimique, et un 2ème électrique), qui permettent de produire de l'hydrogène, moyennant la fourniture d'une certaine énergie. Et c'est là que le bât blesse. En effet, « Le rendement des électrolyseurs actuels est mauvais avec presque deux joules d'électricité pour en produire un d'hydrogène. Il faut encore diviser par deux ce rendement énergétique lorsque la pile à combustible retransforme l'hydrogène en électricité » (cf http://www.bilan.ch/voiture-verte-une-verite-qui-derange).
Vous avez bien lu: avec les technologies actuelles, il faut fournir quatre joules d'électricité pour fournir un joule au moteur électrique d'une voiture alimentée par une pile à combustible.
Quant au 2ème procédé de production d'hydrogène, il repose sur le « craquage » du gaz naturel qui n'est pas, vous en conviendrez, une ressource renouvelable.
Moralité: l'hydrogène n'est pas une source primaire d'énergie, mais un moyen de stockage, qui ne fait que repousser le problème. En effet:
- Si sa production repose sur une extraction du gaz naturel, cela revient à continuer d'utiliser une énergie fossile.
- Si sa production provient d'un procédé électrique, alors se pose la question de la production de l'électricité: nucléaire, charbon, hydroélectrique. Remarquons au passage que le nucléaire n'est pas une énergie renouvelable et que, pas plus que le pétrole ou le charbon, il ne permettra de soutenir un développement pérenne.
Mon propos n'est pas ici d'écrire un bilan énergétique précis de la « filière hydrogène », mais bien d'en revenir aux fondamentaux : le mouvement perpétuel n'existe pas, les ressources de la terre ne sont pas infinies et, jusqu'à nouvel ordre, les arbres ne montent toujours pas jusqu'au ciel.
3) La croissance est-elle un mythe ?
A la lumière des lignes qui précèdent, je crois l'avoir sinon démontré, du moins fortement suggéré.
La croissance est à l'économie de marché ce que Zeus était aux grecs, Jupiter aux romains et Toutatis aux gaulois: un symbole et un mythe sur lequel la société entière fonctionne à un moment de son histoire. Après avoir (re)découvert il y a quatre cents ans que la terre était ronde, nous pourrions maintenant intégrer le fait qu'elle est finie. Ceci nous permettrait de fonder le développement de notre société sur de nouveaux principes, et non sur un mythe ancien dont on sait désormais qu'il est caduque.



