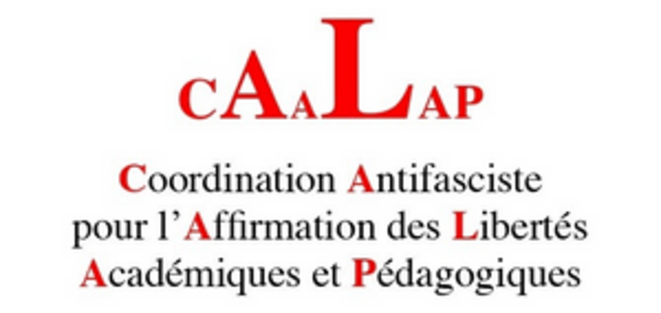Le 29 avril 2025, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, Philippe Baptiste, prononçait un discours pour lancer un programme de recherche sur l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur conçu « en partenariat avec la DILCRAH et la Fondation pour la Mémoire de la Shoah » et en consultation avec l’Union des étudiants juifs de France (UEJF).
C’était anticiper sur la loi du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur, elle-même « issue des conclusions d’une mission d’information du Sénat mise en place à la suite des incidents survenus dans des universités, après l’attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre 2023. » Après l’Assemblée nationale le 25 mars 2024, le Sénat avait en effet organisé le 10 avril de la même année des auditions, suscitant la dénonciation de 70 présidents d’établissements du supérieur : « Les universités ne doivent pas être instrumentalisées à des fins politiques. » C’est que les auditions étaient conduites sur le modèle accusatoire de celles, alors menées sous l’égide de la droite républicaine à la Chambre des Représentants étatsunienne, qui ont provoqué la démission de plusieurs présidentes d’université, de Harvard à Columbia, sans toutefois obtenir le même résultat : en France, ce sont les communautés universitaires qui élisent chacune leur président·e, alors qu’aux États-Unis, ce sont des Board of trustees, conseils d’administration composés de notables le plus souvent extérieurs au monde universitaire, qui les nomment.
Un questionnaire qui questionne
Le questionnaire sur l’antisémitisme que vient d’envoyer le ministère aux établissements d’enseignement supérieur, pour diffusion auprès de l’ensemble des personnels et des étudiant·es, s’inscrit dans cette histoire qui confond délibérément la lutte légitime contre l’antisémitisme dans la société avec la répression illégitime des mobilisations pro-palestiniennes contre le génocide en cours à Gaza. La CAALAP a co-signé un communiqué, diffusé aujourd’hui même, d’associations et de syndicats réunis en réseau pour la défense des libertés académiques par la Ligue des droits de l’homme (il est ouvert à la signature). Nous y soulignons les « graves dangers que soulève cette initiative » d’un point de vue légal. En effet, l’État ne saurait enquêter sur les opinions politiques et religieuses des fonctionnaires qui relèvent de son autorité ; c’est une question de liberté d’opinion. Sans doute le ministère s’est-il adressé à l’IFOP, qui, pour un premier sondage sur l’antisémitisme à l’université, juste avant le 7 octobre 2023, s’était associé à l’UEJF, dont les réseaux avaient composé l’échantillon d’étudiants juifs qui ont répondu ; ses résultats avaient nourri l’offensive parlementaire. Mais avec ce questionnaire, il s’agit, non d’un simple sondage, mais d’un recensement de toute la population universitaire ; il devrait donc être soumis à la CNIL pour protéger des données aussi sensibles (article 35 du RGPD).
Malgré l’association affichée avec un laboratoire de science politique, le CEVIPOF, ces dangers sont redoublés par des problèmes méthodologiques qui finissent par trahir une logique politique. C’est ainsi que sont juxtaposées des questions sur la fréquence et l’aggravation éventuelle de « la radicalisation religieuse », « du sentiment antimusulman » et de « l’antisémitisme des étudiants » dans l’établissement, ou encore de l’antisémitisme et de l’islamophobie en France. Il ne s’agit pas d’expériences, vécues ou vues (sauf dans deux questions), mais de simples opinions (toutes les autres). De même, quand on interroge : « selon vous, quelles sont les principales causes de l’antisémitisme en France ? », le premier item, c’est « le rejet d’Israël, la haine d’Israël » ; suivent « le complotisme », « les idées d’extrême gauche » et « d’extrême droite », et « l’islamisme. » Cette question prépare la suivante, sur la contribution des formations politiques énumérées, à « la montée de l’antisémitisme en France », répondant au passage à une question antérieure : « diriez-vous que, par rapport à il y a quelques années, l’antisémitisme en France » est « plus répandu », ou moins?
Mais ce n’est pas tout. Après une question sur les propos ou actes visant « un étudiant parce qu’il était juif », et avant d’autres sur les préjugés (argent, pouvoir, etc.) sur les juifs, il est demandé la fréquence, « dans votre établissement », de « la détestation d’Israël », « l’affichage de son soutien à la cause palestinienne », « l’affichage de son soutien au Hamas », « la haine des sionistes ». L’amalgame est clair autant que le biais qui, des questions, induit les réponses. Mais surtout, il suggère que l’enquête reprendrait la définition de l’antisémitisme de l’IHRA (Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste), qui tend à considérer la critique d’Israël comme une forme d’antisémitisme. Or l’amendement contesté de la députée Renaissance Caroline Yadan, qui le proposait, n’a pas été retenu au moment de l’adoption définitive de la loi relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur. C’est donc, avec le questionnaire, une manière de faire rentrer par la fenêtre une tentative que le Parlement avait fait sortir par la porte. C’est aussi le moyen de revenir à l’enquête sur l’islamogauchisme dans les universités annoncée en 2021 par la ministre Frédérique Vidal (et finalement démentie en 2023 par le ministère), dont Philippe Baptiste avait été le directeur de cabinet jusqu’en 2019.
Antisémitisme et antisionisme
Si l’on veut des éléments empiriques solides sur le lien entre « antisionisme », ou plus précisément critique de la politique d’Israël, et antisémitisme, il vaudrait mieux s’appuyer sur l’enquête annuelle de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, mandatée par la loi du 13 juillet 1990 contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Son rapport est remis chaque année au Premier ministre – sauf en 2024, lorsque Gabriel Attal n’avait pas répondu à cette demande, alors qu’il venait de forcer la porte du Conseil d’administration de Sciences Po pour y dénoncer l’antisémitisme étudiant (après enquête, l’accusation a été abandonnée). C’est aussi que ce rapport de la CNCDH contredisait les discours sur un « nouvel antisémitisme » identifié à « l’islamogauchisme », c’est-à-dire à l’idée d’une convergence de la gauche (ou de la gauche radicale) et des musulmans (ou des islamistes). En effet, « l’antisémitisme sous sa forme traditionnelle n’a pas disparu. Il reste plus marqué à droite et à l’extrême droite du champ politique. » La gauche, et à un moindre degré l’extrême gauche, sont beaucoup plus favorables à « une lutte vigoureuse contre l’antisémitisme » que le centre, la droite et l’extrême droite.
C’est pour les jugements sur Israël et la Palestine que la logique s’inverse. « Si une vision négative d’Israël est plus fréquente à gauche et à l’extrême gauche, elle est relativement dissociée des préjugés anti-juifs classiques qui restent plus vivaces à l’extrême droite et chez les proches du RN ». Ainsi, les sympathisants de gauche sont beaucoup plus critiques de la politique israélienne, mais bien moins antisémites. Symétriquement, « c’est à l’extrême droite qu’Israël suscite le moins d’opinions négatives », et de loin, alors que ce sont clairement la droite et l’extrême droite qui sont le plus traversées par l’antisémitisme. L’enquête de la CNCDH dont le Premier ministre n’a pas souhaité recevoir les résultats confirme les précédentes : il n’y a pas de corrélation entre les préjugés antisémites, dirigés contre les juifs, et les opinions dites « antisionistes », au sens de critiques de la politique d’Israël ; voire, c’est une corrélation inverse. On comprend pourquoi la droite veut identifier antisionisme et antisémitisme, à l’heure où l’extrême droite israélienne fait la guerre au peuple palestinien dans les territoires occupés.
La campagne contre les universités
Tous ces éléments permettent de mieux comprendre le sens d’une telle enquête, qui s’avère moins scientifique que politique. Elle intervient après l’annulation d’un colloque scientifique au Collège de France sur « La Palestine et l’Europe », les 13 et 14 novembre, sous la pression du ministre de l’Enseignement supérieur relayant celle de la LICRA et d’un Réseau de recherche sur le racisme et l’antisémitisme. Cette cancel culture de droite était justifiée politiquement, non sans ironie, par la défense des libertés académiques, confondue avec la pluralité des opinions. Dans son discours du 29 avril, Philippe Baptiste citait pourtant Gaston Bachelard : « La science, dans son besoin d’achèvement comme dans son principe, s’oppose absolument à l’opinion. » Il aurait pu ajouter, du même auteur : « l’opinion pense mal ; elle ne pense pas. » Or c’est Raymond Aron qu’il cite, mais pas contre l’opinion : « La science ne pense pas, elle mesure. » De fait, c’est Martin Heidegger, critique de la technique rallié au nazisme, qui écrivait au début des années 1950 : « La science ne pense pas ». Il est vrai qu’au moment où l’on prétend lutter contre l’antisémitisme, Aron est plus légitime qu’Heidegger : le lapsus est donc significatif.
Pareille offensive résonne avec un contexte international. Aux États-Unis, le gouvernement fédéral est lancé dans une offensive contre les universités, au prétexte de lutter contre l’antisémitisme – alors même que, l’actualité le rappelle après l’interview complaisante du suprémaciste blanc Nick Fuentes par Tucker Carlson, proche du président, qui a reçu le soutien du président de l’influente Heritage Foundation, Kevin Roberts, c’est bien le mouvement MAGA qu’il « gangrène ». Il est ainsi exigé de l’université Penn, soupçonnée de mal combattre l’antisémitisme, qu’elle fournisse la liste de ses employés juifs – réveillant bien sûr des craintes sur la constitution d’un fichier juif. Il s’agit clairement d’une offensive politique : le cabinet de Donald Trump prétend en même temps défendre la « diversité des points de vue » dans les universités, comme à Harvard, soit en réalité à imposer le recrutement de sympathisants idéologiques du pouvoir dans les universités et départements critiques. Là-bas aussi, c’est au nom de la diversité des opinions, et au mépris des libertés académiques. En France comme aux États-Unis, la vigilance s’impose donc.
Aujourd’hui, dans notre pays, le ministre de l’Intérieur est d’abord un ministre pour les policiers ; mais le ministre de l’Enseignement supérieur est surtout un ministre contre les universités. Le 29 octobre, devant les sénateurs, il a en effet dénoncé des universités « à la ramasse » : une « bande de nuls. » Rappelons-nous la phrase d’Emmanuel Macron dès 2020 : « Le monde universitaire a été coupable. » C’est dans le droit fil de cette campagne que le ministère vient de lancer cette enquête. Dira-t-on qu’elle mesure sans penser ? En tout cas, dans le contexte actuel d’un anti-intellectualisme politique qui instrumentalise la lutte contre l’antisémitisme pour réduire, dans le monde universitaire, et la liberté d’expression et les libertés académiques, si ça ne pense pas, du moins, ça parle. Car mesurer, c’est aussi penser politiquement.
Coordination antifasciste pour l’affirmation des libertés académiques et pédagogiques (CAALAP), 24 novembre 2025