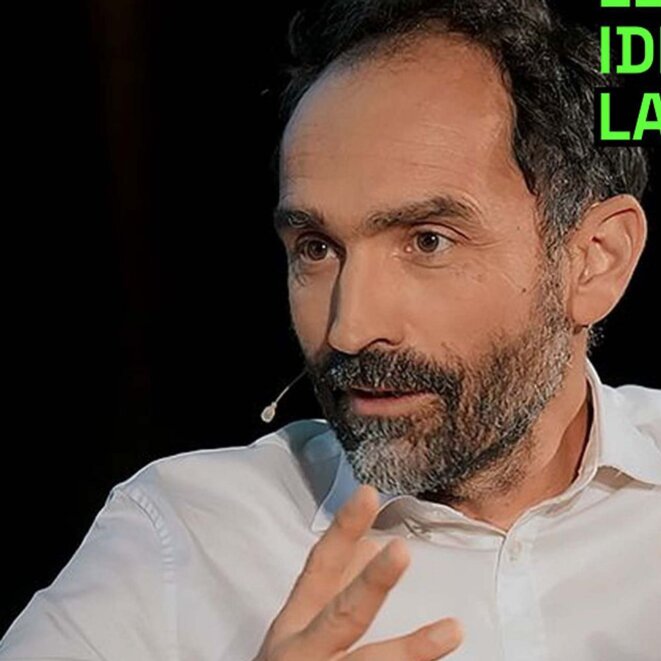Intervention faite au Colloque des Économistes atterrés samedi 9 octobre 2010 à Paris dans la table ronde « quelle économie pour quelles finalités ? »
Avec l'imbrication des crises économiques, sociales, et écologiques, la RSÉ est un sujet qui devient incontournable. Par RSÉ – à ne pas confondre avec la RSE, la notion douteuse de responsabilité sociale des entreprises – je me réfère à quelque chose qui nous concerne plus spécialement dans cette assemblée : la responsabilité sociale des économistes.
De quoi s'agit-il ? La reine d'Angleterre, en visite chez nos collègues de la London School of Economics, a assez bien résumé le problème : effarée par la brutalité de la crise, elle s'est alors exclamé : « C'est horrible ! Pourquoi personne ne l'a vu venir ? ». En fait, nous savons ici qu'elle était mal conseillée dans ses lectures. Mais, fondamentalement, le problème posé est bien le bon : les économistes ont des compte à rendre.
Pratiquement au même moment, début 2009, la grande revue médicale britannique The Lancet a publié d'une étude sur l'impact des privatisations de masse en Russie. Dans cet article, David Stuckler et ses collègues démontrent l'existence d'un lien entre les privatisations et la surmortalité qu'a connu la Russie dans les années 1990. il s'en est suivi une vif débat que le Financial Times et The economist ont relayé. En particulier, Jeffrey Sachs, un des promoteurs des privatisations de masse, s'est retrouvé sur la défensive, contraint de justifier les recommandations de politique économique qu'il avait porté une vingtaine d'années plus tôt.
Ces deux exemples – l'étonnement de la reine face à l'incompétence du mainstream avant la crise et le bilan sanitaire de la transition – permettent d'éclairer le sens de notre réunion d'aujourd'hui. En effet, si nous sommes atterrés, c'est parce que nous comprenons qu'une catastrophe est en train de se nouer. Et prendre la parole pour l'expliquer, c'est en fin de compte exercer notre responsabilité sociale. C'est en tous cas la manière dont j'interprète le manifeste qui a été lancé et le sens que je donne à la question qui nous est posée dans cette table ronde : « quelle économie pour quelles finalités ? ».
Je vais maintenant tenter d'y répondre en exposant succinctement trois idées .
La première idée concerne la nature de la crise. Je voudrais insister sur le fait que cette crise s'inscrit dans une longue phase de déclin, ce que j'appelle la grande fatigue du capitalisme. Une longue fatigue telle qu'il n'est ni possible, ni souhaitable de parier sur un nouvel âge d'or du capitalisme.
La seconde idée concerne les conditions dans lesquelles il faut faire face à cette grande fatigue du capitalisme. Démanteler un pouvoir du capital centralisé comme jamais grâce à la finance est une condition nécessaire pour stopper la dynamique de régression sociale généralisée qui est la réponse actuelle à la crise.
Enfin, je vais faire allusion à des pistes susceptibles de donner corps à la notion de transition écologique et sociale.
**
La grande crise actuelle est tout sauf un coup de tonnerre dans un ciel d'azur. Elle s'inscrit, pour les pays riches dans une phase de ralentissement économique progressif depuis les années 60 (graph 1).
Ce ralentissement est à première vue surprenant. L'essor des technologies de l'information et des biotechnologies ou encore l'intégration des mondes communistes et de l'Inde à l'économie mondiale n'ont-ils pas contribué à dynamiser le système ?
Il n'est pas possible d'entrer ici dans la discussion, mais on peut toute de même lister une série de facteurs qui expliquent cette grande fatigue et vont continuer à peser dans les décennies à venir. D'abord, l'intensification de la concurrence internationale s'est accompagnée, dans de nombreux secteurs industriels, de surcapacités de production importantes. Ensuite, la tertiarisation des économies tend à ralentir la productivité. C'est le fameux effet Baumol : il n'y a pratiquement pas de gains de productivité possible dans des secteurs comme la santé ou les loisirs : qu'est-ce qu'être plus productif lorsqu'on est enseignant, comédien ou infirmière ? Enfin, troisième facteur, une augmentation multidimensionnelle des coûts : elle provient en partie du vieillissement des populations et de l'augmentation des dépenses de santé. Cette hausse des coûts se nourrit également d'une nouvelle tendance de fond à la hausse des matière premières – on retrouve ici la question classique de la rente. Et il y a également la hausse des coûts environnementaux. Le cas du changement climatique est emblématique. Si on prend au sérieux les recommandations du GIEC, et même avec de hypothèses optimistes sur l'accroissement de l'efficacité énergétique, il semble impossible d'atteindre les objectifs de réduction d'émissions fixés sans renoncer à la croissance.
Il y a donc une série de signaux qui suggère un épuisement de la dynamique d'accumulation dans les pays riches. Mais il y a peut être encore plus. L'idée que le capitalisme n'a plus rien a apporter, qu'il aurait d'une certaine façon épuisé ses potentialités historiques.
Cela renvoie d'une part à ce que Michel Husson a appelé le divorce entre la production et les besoins sociaux, Robert Boyer l'essor des besoins anthropogénétiques – c'est-à-dire la production de l'homme par l'homme dans les domaines de la santé, de l'éducation et des loisirs - ou encore la thématique du Care. Dans tous les cas, la logique des besoins sociaux contemporains est radicalement distincte de celle du développement industriel dans lequel le capitalisme a déployé toute sa puissance.
L'autre symptôme d'épuisement découle des caractéristiques de l'économie de la connaissance. On le sait, dans nos économies contemporaines, la compétitivité des firmes dépend de plus en plus de leur capacité à faire émerger de nouvelles idées. Or leurs profits dépendent de leur capacité à empêcher la diffusion de ces idées. Il y a là une puissante contradiction entre leੇs exigences de l'accumulation du capital et la satisfaction des besoins sociaux : contradiction qu'illustre bien les controverses sur les médicaments génériques ou autour de la loi Hadopi.
En résumé, je pense qu'il n'est ni possible, ni souhaitable de donner comme principale finalité à l'économie de relancer durablement la croissance. Il existe probablement des marges pour un regain temporaire de la croissance, mais je ne crois pas à la possibilité d'un nouvel âge d'or du capitalisme. La question sur laquelle nous devons nous pencher est bien celle d'un nouveau mode de développement. Ce nouveau mode de développement va tourner le dos à ce qui était au fondement même du capitalisme : l'accumulation illimitée du capital.
**
Lorsque l'on parle de changer de modèle de développement, il y a un risque à poser le problème de manière abstraite, a-historique, sur le mode du souhait, sans partir de la situation et des rapports de pouvoir dans lesquels nous sommes pris. Hors, il est évidemment crucial de constater que la situation contemporaine est marquée par la persistance d'un rapport de force très favorable au capital. Ce rapport de force s'appuie, d'une part, sur un degré extrême de centralisation du pouvoir du capital qui découle de la financiarisation. D'autre part, il s'enracine dans une logique de « diviser pour mieux régner » qui couvre toute une série de domaines depuis la mise en concurrence des travailleurs et des systèmes fiscaux à l'échelle internationale jusqu'à l'individualisation des parcours professionnels et la fragmentation contrôlée de l'organisation du travail.
Le sursaut du pouvoir du capital à partir des années 1980 est cependant fragile. La longue modération salariale des dernières décennies a permis la restauration de la part des profits. Mais, le revers de la médaille, c'est l'atonie de la demande effective. Or cette faiblesse de la demande n'a été contrecarrée qu'au prix d'une accumulation de dettes, publiques et privées, qui constituent désormais une gigantesque baudruche, une accumulation inouïe de promesses de remboursements qui ne pourront pas, pour la plupart, être honorées.
La combinaison de ce pouvoir du capital centralisé et le caractère largement fictif du capital financier accumulé entraîne une logique prédatrice. Une logique d'autant plus féroce que les difficultés économiques s'aggravent. David Harvey appelle cette logique l'accumulation par dépossession. L'idée est la suivante : lorsque l'accumulation du capital ne peut plus se nourrir de manière suffisante de l'exploitation du travail, elle accapare d'autres richesses : privatisations à prix bradées des autoroutes, crédit impôt recherche, absorption par les banques centrales des titres pourris ou piraterie génétique par exemple. Une logique prédatrice que l'on retrouve dans les politiques d'austérité qui déferlent aujourd'hui sur l'Europe. Il s'agit à chaque fois de spolier les populations de leurs droits collectifs pour financer les coûts de l'accumulation.
Pour faire vite, là encore, pouvoir du capital via la finance, gonflement de la baudruche financière et accumulation par dépossession sont indissociables. Un coup d'arrêt aux politiques de régression sociales passe donc nécessairement par un désarmement de la finance de marché mais aussi par un dégonflement contrôlé de la baudruche financière. De tels bouleversements ne vont pas sans affrontement sociaux. Des batailles sociales et politiques qui s'annoncent dépendra la possibilité de contrer les projets néolibéraux. Mais pour ces batailles même, il n'est pas inutile de pointer des mesures clés qui constituent des points de basculement.
Beaucoup de choses ont déjà été évoquées aujourd'hui, je m'en tiendrais donc à deux choses. D'abord, la socialisation du système bancaire. Cette question était largement à l'agenda au lendemain de la chute de Lehman brothers. Et par la force des choses puisque, plusieurs gouvernements furent contraint de nationaliser en catastrophe une série d'institutions ! Mais, également parce qu'une brèche dans le débat de fond s'était ouverte. L'actuel économiste en chef de la citibank écrivait alors – excusez la radicalité du propos ! - on sait «depuis bien longtemps qu'il n'y a pas de véritable argument pour justifier la propriété privée des banques de dépôt ». Aujourd'hui, cette question de la socialisation n'est plus discutée. Et on peut d'ailleurs regretter qu'elle n'apparaisse pas dans le manifeste.
Second problème, le paiement des dettes. De crises en crises, chaque fois plus graves, chaque fois payées par les salariés, c'est une pression irrépressible à la dévaluation des actifs financiers qui se manifeste. Plutôt que de subir des chocs brutaux récurrents, ne faudrait-il pas procéder de façon ordonnée à cette dévaluation inévitable ? Un moratoire sur les dettes publiques et les dettes des salariés modestes suivi d'un audit public permettrait de faire d'une pierre deux coups : désarmer la finance et faire avancer significativement la justice sociale en dégageant des ressources pour les politiques publiques et pour les ménages modestes.
**
Avant de conclure cette intervention, je voudrais revenir sur la question posée précédemment. Comment, face à la grande fatigue du capitalisme, les économistes peuvent-ils être socialement responsables, c'est-à-dire se saisir de la demande sociale d'avancer vers un nouveau mode de développement ? Cela nécessite très certainement une redéfinition de ce qu'est l'économie et de ce que doit être son insertion dans les sciences sociales. Mais je vais laisser cette discussion épistémologique de côté. Je voudrais plutôt me focaliser sur la notion de « transition écologique et sociale ».
On pourrait définir cette transition écologique et sociale comme un processus de transformation institutionnelle délibérée en vue d'une réduction drastique des inégalités, une démocratie étendue à la sphère économique, une insertion pacifique dans les relations internationales et une utilisation des ressources environnementales compatible avec la reproduction à long terme des écosystèmes. En la matière il n'y a pas de recettes toute faites. Tout sera affaire de bataille sociales, politiques et idéologiques. Mais il existe cependant des pistes qui permettent de nous projeter plus avant. En voici deux.
La première est celle d'une politique industrielle qui devrait être menée, notamment, au niveau européen. Il s'agit de transformer les structures productives et les infrastructures en vue de satisfaire, dans la durée, les besoins de nos sociétés dans toute une série de domaines. On pense par exemple aux transports, au logement, à l'énergie mais aussi à la santé ou à l'éducation. Une telle politique industrielle peut aussi être un instrument immédiat de réponse à la crise sociale, car elle est un moyen de fournir à chacun un emploi digne et utile. Elle implique de remettre au goût du jour un outil depuis longtemps jeté aux oubliettes : la planification.
La seconde piste est davantage tournée vers la demande. Elle fait systématiquement appel à la créativité des individus et des communautés. Cela implique d'abord de délivrer nos sociétés du consumérisme. Et, en premier lieu, de dégager les individus de l'emprise cognitive et affective que leur impose le harcèlement publicitaire. A partir de là, de multiples formes décentralisées de consommation et de production peuvent émerger et se constituer en systèmes complexes. Les travaux d'Elinor Ostrom sur les communs – qui furent honorés l'an dernier d'un prix nobel, montrent combien une telle voie est prometteuse.
**
Il y a bien des manière de tenter d''être un économiste socialement responsable face à la crise. Celle que j'ai suivie ici m'a conduit à apporter une réponse en trois temps à la question posée – « quelle économie pour quelles finalités ? ».
Il s'agit d'abord de prendre la mesure de l'épuisement d'un système, plutôt que de parier sur une relance moins injuste de la croissance capitaliste. Mais pointer la nécessité d'un autre mode de développement ne doit pas faire oublier l'urgence de la situation. Une situation extrêmement favorable au capital en raison de la centralisation inédite de son pouvoir. Pour stopper la logique brutale de dépossession des populations de leurs droits, le préalable est un démantèlement du pouvoir de la finance. C'est une condition pour que puisse s'affirmer un bloc historique – c'est à dire, au sens gramscien, une coalition de forces sociales et idéologiques - qui soit porteur d'un projet de justice sociale et qui soit conséquent sur le plan écologique. La transition écologique et sociale à engager pourrait alors s'appuyer sur tension féconde entre deux pôles : d'une part, une politique industrielle de transformation des structures de nos économies et, d'autre part, la montée en puissance de formes diversifiées et décentralisés de gestion en commun des processus de production et de consommation .