
Agrandissement : Illustration 1

Cédric Lépine : Peux-tu parler de la rencontre essentielle sur laquelle le film repose, celle avec l'historien Jan Gross, auteur des Voisins (2000) ?
Joanna Grudzinska : C'est une rencontre qui a eu lieu plusieurs fois en fait, et sur plusieurs registres différents. Depuis la chute du mur, Jan Gross est régulièrement revenu en Pologne consulter les archives de l'Institut Historique Juif de Varsovie. Celles-ci n'ont jamais été fermées, mais il y avait une telle omerta, une telle tension autour des révélations qu'elles contenaient, qu'elles étaient très peu abordées. Il était ainsi quasiment impossible de transmettre.
Quand le mur est tombé, tout s'est un peu libéré. Jan Gross était aux USA depuis la fin des années 1960, riche d'une histoire scientifique, académique, universitaire américaine, appuyant l'émergence des récits minoritaires, la libération de la parole qui naît à ce moment-là de manière très forte, concernant toutes les minorités raciales, de sexe, etc. Il faut savoir que Les Voisins s'inscrit dans ce courant progressiste.
La Pologne après 1989 est un pays qui prend goût à la démocratie. Il y a énormément de débats, ce qui se passe est assez incroyable, on voit vraiment une démocratie bouillonnante, avec des débats sur l'histoire du pays, sur la politique, sur la culture : c'est l'émergence des meilleures œuvres littéraires et théâtrales dans une ébullition intense. C'est dans un tel contexte que fait son apparition le livre de Jan Gross qui vient mettre une sorte de bémol énorme à cet enthousiasme général.
Il n'y a pas eu la reconnaissance de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette histoire de massacre par des Polonais de leurs voisins juifs a été longtemps tue, y compris chez les enfants des survivants juifs restés en Pologne. En effet, ceux-ci ont cru à la démocratie, ils se sont battus pour le pays, leurs parents, eux-mêmes survivants, ont été un peu dans le déni de ce qui s'était passé pour construire le communisme.
C. L. : Les révélations historiques appartiennent ainsi au contexte social prêt ou non à recevoir certains événements.
J. G. : Le film est une chronique médiatique des années 2000-2025 en Pologne sur la question de la responsabilité des Polonais dans l'extermination de leurs Juifs, de leurs voisins, de leurs concitoyens polonais. Dès lors ce débat va en fait être un étalon de la démocratie. C'est-à-dire que plus on va pouvoir parler des Voisins, plus le pays sera démocratique. Moins on peut parler des Voisins, moins le pays sera démocratique. En effet, cette parole libre permet de sortir d'une histoire martyrologique de la Pologne aux XXe siècle.
C'est vraiment pour cela que le livre est passionnant, parce qu'il parle autant des Juifs que des Polonais, enfin, pas seulement le livre, mais tout le débat qui a suivi, et qui est devenu aussi fort que le livre. Personne n'a lu Les Voisins, mais tout le monde sait quel est ce livre. Cette puissance d'un livre a quand même fait admettre à un président ce qui était encore inadmissible et qui provoque encore des débats pendant 25 ans dans le pays, offrant une contre-culture à la Pologne patriote, néolibéraliste et capitaliste.
Les Polonais.es continuent à avoir beaucoup de mal à s'identifier à cette histoire. C'est très difficile de s'identifier à l'enfer qu'on a pu faire vivre aux gens. Et je pense que ça, c'est totalement paradigmatique. Le déni c’est de ne pas pouvoir se voir dans le miroir de ce que l'on fait subir aux autres.
C. L. : Le passage du temps devrait faciliter cette reconnaissance de la responsabilité des drames.
J. G. : Si l'histoire était racontée, je pense qu'il n'y aurait aucun problème. Je pense que la société polonaise d'aujourd'hui est prête. Cependant, ceux qui décident, sont pris dans les camps patriotiques. Ça ne les intéresse pas. Si ceux qui protestent étaient au pouvoir, les droits des femmes seraient respectés, l'histoire réelle serait officialisée.
La réalisation de ce film était indispensable pour moi. Jan fait partie de ma famille/ Nous ne sommes pas reliés biologiquement, mais il est proche de ma famille et je le connais depuis que je suis née. J'ai ainsi été élevée dans cette atmosphère de lutte pour la vérité, mais aussi de lutte contre son propre déni.
Il y avait tellement d'espoir de démocratie en Pologne que les dix ans de pouvoir de l'extrême droite ont été destructeurs, même pour la diaspora, en tout cas pour moi, et puis pour ma famille. Face à l'espoir de la démocratie, l'autoritarisme en Pologne était insupportable. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à vouloir faire le film. Et puis, j'avais remarqué que Jan, en vieillissant, était de plus en plus intéressant pour sa part mystérieuse. D'ailleurs, il est toujours très mystérieux pour moi. Au sens positif du terme, c'est quelqu'un qui ne dévoile pas tout. Il m'a paru intéressant comme personnage parce qu'il échappe aux catégories. Ce n'est pas un historien au sens strict, il est sociologue, il n’est pas que polonais, mais aussi américain. Il n'est pas juif au sens strict parce qu'une partie seulement de sa famille est juive et il ne se vit pas comme juif. Il représentait cette espèce d'hybridité, d'adhérence avec cette force de vie, cette curiosité, cette générosité.
Cette narration juive de l'histoire de la Pologne avec lui devient universelle. Elle devient l'histoire du déni, l'histoire de la lutte pour la vérité, puis l'histoire des morts qui n'ont pas pu être enterrés. Il s'agit de sortir de la haine, pour rentrer dans la vérité, dans la reconnaissance, dans l'aveu.
C. L. : En continuité avec ton film Révolution école (1918-1939), on retrouve l'enjeu de la transmission auprès des nouvelles générations autour de la figure de passeur que représente Jan Gross.
J. G. : Oui, je pense qu'il y a une leçon. Je crois à la pédagogie, évidemment, mais au sens noble du terme. Je pense que transmettre quelque chose de son expérience, en fait, c'est ça l'éducation, c'est ça éduquer, donc c'est tout le contraire de dépersonnaliser l'éducation, au contraire, c'est porter son expérience.
Dans Révolution école (1918-1939), les pédagogues faisaient infuser une manière d'éduquer où le sujet et l'expérience entrent en ligne de compte dans la transmission et la réception de ce savoir. Aussi, Jan, à cet endroit-là, essaye de trouver une forme pour restituer une expérience de recherche à travers le témoignage. Essayer de croire un témoin, c'est l'entendre, c'est vouloir l'entendre. Et c'est aussi trouver un silence autour pour que cette croyance et cette écoute aient lieu. Cela demande du temps, de la distance, et puis ça demande d'être seul à seul avec quelque chose. Jan Gross parle de solitude habitée par ses nécessités à lui, par la vérité, par l'histoire, par le témoignage, mais quand même une solitude, c'est-à-dire prendre du temps.
La pédagogie, c'est aussi cela, c'est-à-dire se retrouver seul à seul avec un savoir que l'on est susceptible de comprendre, et comment cela résonne en nous, comment cela nous transforme.
Je trouve que Jan est un peu le grand psychanalyste de la Pologne, ou le grand rabbin, pour ceux qui croient en Dieu. Il y a en lui quelque chose d'opposé à l'angoisse, à la névrose, au déni. Jan est un conteur merveilleux. Il se met à la place des gens. C'est un peu la puissance de son récit, de sa parole. Tous les mensonges perpétrés cachent l'ampleur du crime qui s'étend bien au-delà de Jedwabne.
Pour Jan, le film et le livre sont deux choses complètement différentes. Les livres aussi ont un destin et Les Voisins a eu un destin médiatique, politique, intellectuel et collectif.

Agrandissement : Illustration 2

C. L. : D'un film à l'autre, sens-tu ton besoin de comprendre l'Histoire notamment du XXe siècle à travers un regard curieux renouvelé ?
J. G. : Je pense que l'Histoire, c'est un énorme terreau de récits de nos vies quotidiennes. Je ne dis pas que nos histoires individuelles sont prédestinées mais je m'intéresse à la manière dont « les fantômes » représentant le passé agissent en nous. Nous ne nous battons pas seulement contre des tendances « neurologiques » mais aussi avec des fantômes qui nous habitent.
C. L. : Du livre de Jan au film que tu réalises, c'est aussi l'histoire de l'expression d'une problématique transmise d'une génération à l'autre.
J. G. : Je trouvais aussi que cette transmission méritait une existence audiovisuelle puisqu'aujourd'hui, la transmission livresque est complexe, alors que le film, n'importe qui peut le regarder sur un iPhone s'il le souhaite. En fait, des Juifs polonais de France m'ont dit qu'on a vraiment le sentiment qu'enfin cette histoire est sue, parce qu'elle est sue ailleurs que dans les livres. Cela veut dire que même « ceux qui ne savent pas lire », c'est-à-dire qui ne veulent ou qui n'aiment pas lire, peuvent y avoir accès.
C. L. : Est-ce que le film Shoah de Claude Lanzmann t'a donné des clés de mise en scène pour réaliser ton film ?
J. G. : Tout d'abord, Lanzmann parle depuis un endroit où la souffrance, la douleur, le ressenti de cette histoire est incomparablement plus fort. Ce n'est pas comparable. On n'est vraiment pas de la même génération. Lanzmann parle depuis un endroit vraiment de la blessure saignante.
C'est vrai que nous avions en commun les mêmes décors, c'était assez incroyable. Il y a certains villages dans lesquels nous avons été qui n'avaient pas vu de caméra au sujet de la Shoah depuis Lanzmann. J'avais vraiment l'impression d'être dans ses pas. Parfois, c'était très étrange. Il y a vraiment une prégnance de cette histoire avec le fait que l'atmosphère est hantée. C'est hanté parce que le déni est là.
Que faire avec un site comme Treblinka et alentour ? Que faire avec un site où il y a tellement de millions de gens qui sont morts ? Comment y vivre ailleurs que dans le déni ? En fait, c'est vraiment la tâche aveugle de l'Europe. À Treblinka, évidemment, tu ne peux ni manger ni dormir. La grande difficulté de ce sujet et Lanzmann s'y est confronté, les historiens s'y confrontent et quelques cinéastes s'y confrontent encore, c'est que c'est insupportable. Physiquement, c'est un film très difficile à faire.
Peut-être que la seule chose à faire, c'est construire des récits. Et c'est parler à partir de cet endroit de cette vérité-là. C'est une expérience incroyable que de se confronter au lieu où a eu lieu la Shoah. C'est une expérience très forte. Quand je dis « se confronter au lieu » ce n'est pas seulement y aller mais c'est faire quelque chose à partir de cette expérience d'y avoir été.
C. L. : Comment as-tu pensé la manière de raconter dans ton film ?
J. G. : J'ai utilisé les ressources de la fiction parce que les historiens sont quand même des personnages incroyables et des acteurs formidables : on n'est pas dans du cinéma direct, ils jouent en fait pour nous leurs personnages d'historiens. Avec le récit de Shmuel et toute sa dramaturgie j'avais un peu l'impression de monter de la fiction à travers les couches temporelles, révélant la manière dont le passé et le présent s'entremêlent.
C. L. : Quelle est la différence entre les deux versions du film : Pologne contre Histoire prévu pour le cinéma programmé au FID et Juifs de Pologne : un combat pour la vérité diffusé à la télévision ?
J. G. : La différence entre les deux films c'est que Pologne contre Histoire obéit justement à des règles assez fictionnelles alors que Juifs de Pologne : un combat pour la vérité encadre chaque séquence d'explication de manière à ce que le sens soit univoque. Il y a une place laissée au trouble dans Pologne contre histoire, à la dimension mythologique du récit, sans autre commentaire que celui nécessaire à se saisir de l’arène.
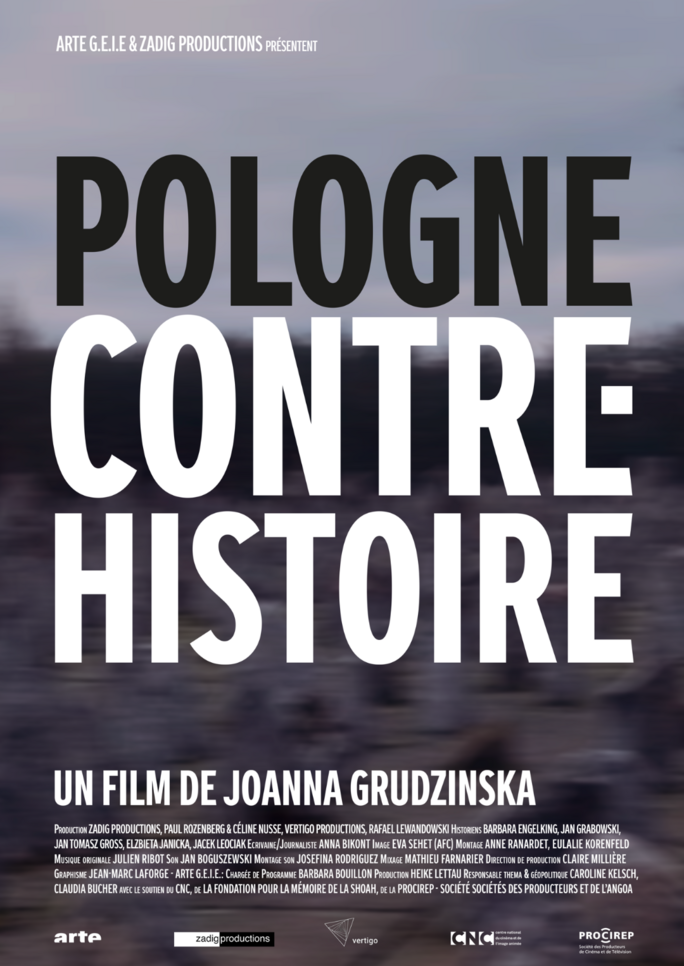
Agrandissement : Illustration 3
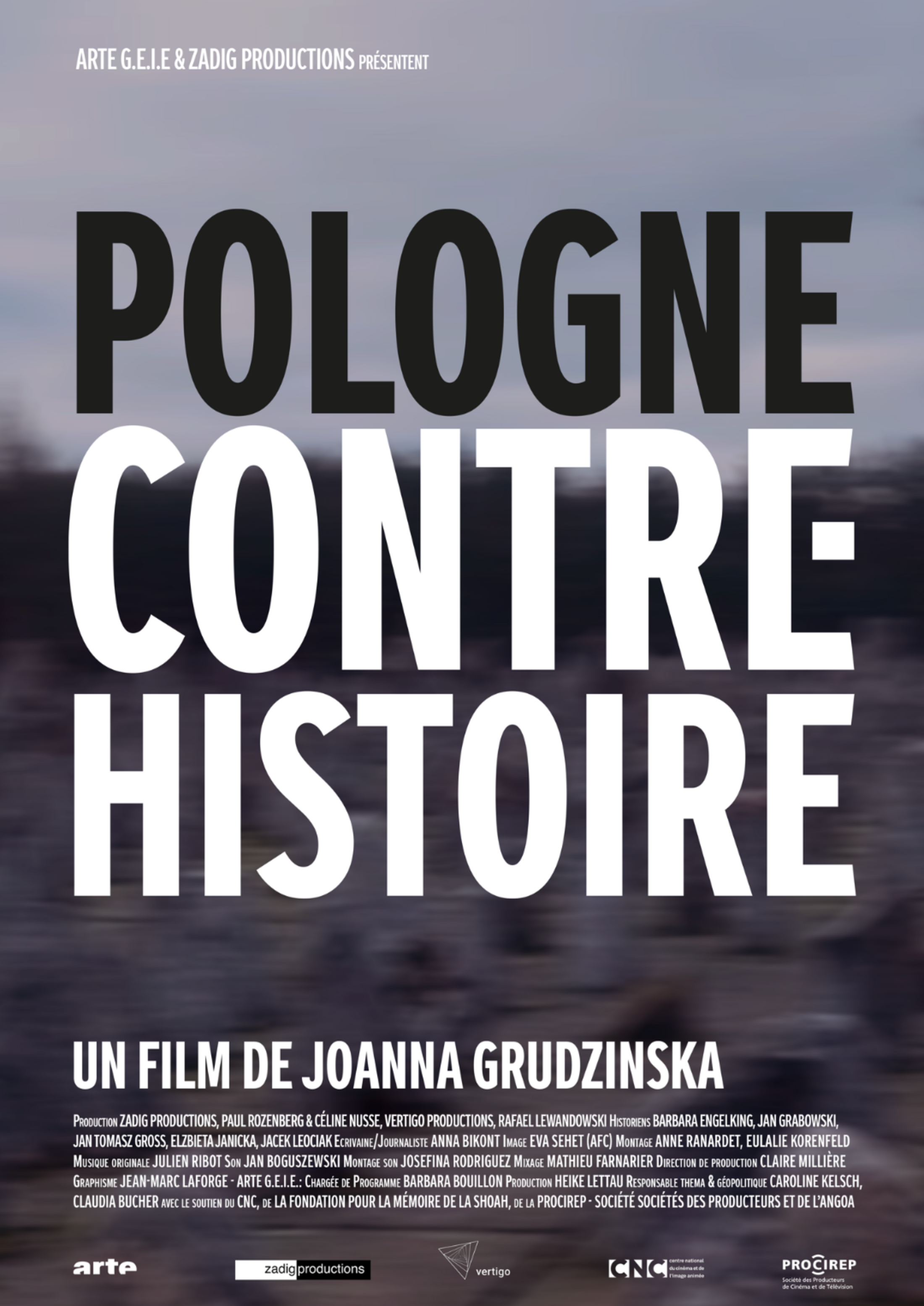
Pologne contre Histoire
de Joanna Grudzinska
Documentaire
70 minutes. France, Pologne, 2025.
Couleur
Langues originales : polonais, espagnol, anglais, hébreu, français
Avec : Jan T. Gross, Jan Grabowski, Barbara Engelking, Jacek Leociak, Elzbieta Janicka, Anna Bikont
Scénario : Joanna Grudzinska
Images : Eva Sehet
Montage : Anne Renardet, Eulalie Korenfeld
Musique : Julien Ribot
Son : Jan Boguszewski
Production : Paul Rozenberg (Zadig Productions), Rafael Lewandowski (Vertigo Films), Céline Nusse (Zadig Productions)



