Cédric Lépine : Pour parler du « cinéma kabyle », quels furent tes choix pour le définir : la langue du film, la production, les lieux de tournage, l’identité du cinéaste, ses intentions ?
Frédérique Devaux Yahi : C’est l’ensemble de ces paramètres qui m’a guidée, mais c’est surtout en accord avec ce qui se définit par lui-même comme cinéma kabyle. Des films sur la Kabylie, faits en Kabylie par des Kabyles, en langue kabyle et qui portent les us et coutumes kabyles, bien au-delà de tout folklore.
Je suis moi-même d’origine kabyle par mon père et je vis depuis quelques années entre la France et la Kabylie ; donc je me suis intéressée naturellement aux productions de cette région. J’assiste régulièrement à des festivals dédiés aux films berbères en Algérie ou au Maroc. Je défends comme tant d’autres le respect pour des populations de plus en plus menacées par la normalisation et les lois d’un hypothétique marché qui ne permet plus à personne de se reconnaître dans sa culture et de la transmettre à travers les traditions et le cas échéant, comme l’illustre le Marocain Mohamed Mernich dans un de ses films, n’autorise plus à rester sur la terre de ses ancêtres.
C. L. : Peux-tu rappeler le contexte qui voit apparaître dans une même décennie trois longs métrages kabyles alors que ce cinéma était inexistant auparavant et que l’Algérie traverse alors une époque très sombre ?
F. D. Y. :Ces films apparaissent au milieu de ce que l’on a appelé la « décennie noire » en Algérie. C’était une période sanglante ayant fait suite à l’annulation des élections législatives de 1990 qui avaient vu triompher le FIS (Front Islamique du Salut). Le Président Bouteflika ayant été mis à la tête du pays en 1999, il a dû répondre aux revendications et au mécontentement et faire quelques ouvertures « démocratiques ». C’est ainsi que s’est achevée d’une certaine manière l’ère étatique dans ce pays. Les cinéastes ont eu la possibilité de faire appel à des productions privées ; les comités de sélection, en cinéma notamment, ont changé ; Bougermouh a reçu l’aval de la nouvelle instance décisionnaire pour l’adaptation en langue native, du roman de Mammeri (La Colline oubliée, écrit lui, en français). Ce cinéaste attendait cet accord depuis 1968 ! Ont suivi deux autres films faits dans des conditions extrêmes de danger puisqu’une partie de l’équipe de La Montagne de Baya a été décimée par une explosion dont on ne connaîtra probablement jamais l’origine (accident ou attentat ?).
Je réponds ici de manière factuelle, car la lutte pour la reconnaissance de la culture amazigh (berbère) est très ancienne. On pourrait même la faire remonter d’une certaine manière au XIXe siècle. Mais pour s’en tenir au XXe siècle, dès les années 1960, les revendications s’amplifient jusqu’à atteindre leur apogée en 1980 lors du « Printemps berbère ».
La Montagne de Baya illustre lui un autre aspect des revendications identitaires ; outre la reconnaissance de la langue, c’est à une inédite historiographie qu’il nous convie en distordant les faits chronologiques pour mieux atteindre son but. Il veut nous donner à lire la persévérance et la lutte kabyle contre l’iniquité et la violence des colons français.
C. L. : Le titre est à la fois porteur d’espoir puisque l’on est heureux de la « naissance » mais en même temps il a fallu un siècle d’histoire de cinéma pour que l’accouchement du cinéma kabyleait lieu.
F. D. Y. : On ne peut pas produire sans argent. Et pour obtenir de l’argent, il faut passer les barrages administratifs. Or, si je reprends l’exemple de Bougermouh, il n’était pas envisageable pour les instances dirigeantes de soutenir un film en langue kabyle, ce qui constituait la condition sine qua non de Bourgermouh. La Kabylie est une région assez pauvre, en tous cas agraire sans beaucoup d’infrastructures ; elle dépend donc du bon vouloir du pouvoir central.
Il n’y a pas non plus, de manière plus large, d’enseignement de l’image et du son en Algérie, mises à part des initiatives personnelles de transmission comme je l’ai moi-même fait bénévolement pendant plusieurs années à l’Université de Bejaia.
Toutefois, les cinéastes dont je parle dans mon ouvrage (les Algériens Bougermouh, Meddour, Hadjadj ont fait leurs études de cinéma à l’étranger, l’Algérien Chaoui Hakkar vit en France, le Marocain Mernich a dû autoproduire certains de ses films) ont réalisé des œuvres variées pour la télévision – où ils étaient fonctionnaires - selon les normes en vigueur et en particulier en langue arabe. Ils n’avaient pas, dans ce cadre, la liberté de mettre en place des œuvres proprement kabyles, même s’ils ont parfois contourné les interdits lors de la diffusion, en réalisant par exemple deux versions l’une en arabe, l’autre en berbère.
C. L. : Cet ouvrage est aussi un encouragement à la nouvelle génération de cinéastes à s’investir dans le cinéma kabyle : qu’en est-il vingt ans après la réalisation de ces trois longs métrages de la mise en images cinématographiques de la culture kabyle ?
F. D. Y. :Oui, je pense que la production doit être encouragée. Il existe désormais de nombreuses réalisations (en grande partie documentaire), mais elles sont le plus souvent faites avec les « moyens du bord », si on excepte des coproductions plus coûteuses.
Les trois premiers films algériens méritent d’être salués, car ils ont ouvert une grande porte sur la possibilité de ne rien renier de ses origines tout en faisant œuvre personnelle dans le cinéma. C’est aussi une des raisons qui m’a fait écrire ce livre.
Il existe d’ailleurs, je l’ai dit plus haut, des festivals dédiés au cinéma berbère : je citerai en particulier pour l’Algérie le Festival du cinéma amazigh et pour le Maroc, le festival d’Agadir.
C. L. : Esthétiquement ou bien à travers la manière de raconter une histoire, peut-on percevoir des liens entre le cinéma kabyle et le cinéma national algérien ? En effet, les cinéastes du cinéma kabyle ont travaillé à un moment donné de leur parcours pour le cinéma algérien.
F. D. Y. : Les cinéastes dont je parle ont fait des études à l’étranger : Bougermouh a été étudiant à l’IDHEC en France, Hadjadj a fait sa thèse avec Jean Rouch, après avoir étudié à l’INSAS à Bruxelles, Meddour a étudié au VGIK à Moscou avec de grands noms comme Michael Romm, Andrei Tarkovsky ; Hakkar vit en France. Bref, chacun d’entre eux a une solide culture cinématographique.
Ce n’est donc pas tant le cinéma algérien – qu’il faudrait définir autrement qu’à travers des frontières - qui les a influencés mais le Cinéma avec un grand C. Il y a à la fois un aspect très classique dans ces réalisations et une parfaite adaptation du langage cinématographique aux us et coutumes de la société berbère. Et quand il y a des « erreurs » éventuelles de raccords ou autres, des manques, cela est dû à l’urgence dans laquelle ont été tournées ces œuvres. Donc leur facture est classique et leur originalité tient à la manière de montrer la société kabyle à travers ces formes qui épousent au plus près les interdits et les transgressions possibles de cette société. Pour en revenir à la culture de ces cinéastes, je rapprocherai davantage le montage d’un Meddour de celui d’un Pelechian que d’un autre cinéaste algérien.
Et puis certains de ces longs métrages sont aussi l’aboutissement d’une trajectoire personnelle et il m’a paru nécessaire de mettre en exergue certains moments de ces parcours individuels avant d’en arriver aux fictions ; je considère ces films comme des baptistaires (des baptistères aussi !) de la cinématographie kabyle. C’est cet aspect qui m’intéresse, davantage que les influences et les rapprochements avec le cinéma algérien ou marocain, car ce serait nier une grande part de leur originalité, même s’il n’existe pas de création ex nihilo, je le sais.
C. L. : Existe-t-il quelques films dans les cinémas algérien, marocain, tunisien ou français, un regard intéressant sur le monde kabyle via notamment ou non des cinéastes d’origine kabyle ?
F. D. Y. : Qui mieux qu’un kabyle peut parler des kabyles ? Jusqu’à l’avènement des ces trois longs métrages - et si l’on excepte un court métrage de 1990 La Fin des Djinns de Cherif Aggoune - le Kabyle, le Berbère était un figurant dans les films algériens ou un personnage exotique descendu de ses montagnes vers la ville, mais jamais il n’avait été le personnage principal de l’histoire (dans le sens de diégèse) ; il n’avait jamais été montré comme un individu porteur de ses propres valeurs culturelles, capable de sortir de l’histoire des autres, de faire avancer l’Histoire (l’Histoire avec sa grande H comme disait Perec), de partager son historiographie, de faire évoluer – ou non - sa communauté face aux aléas de la colonisation, de la Seconde Guerre mondiale, de la tradition têtue et irréfléchie qui perdure dans certaines contrées.
Cela explique sans aucun doute le succès aussi inattendu que quasi phénoménal de ces films à leur sortie, soit en France soit dans leur pays d’origine.
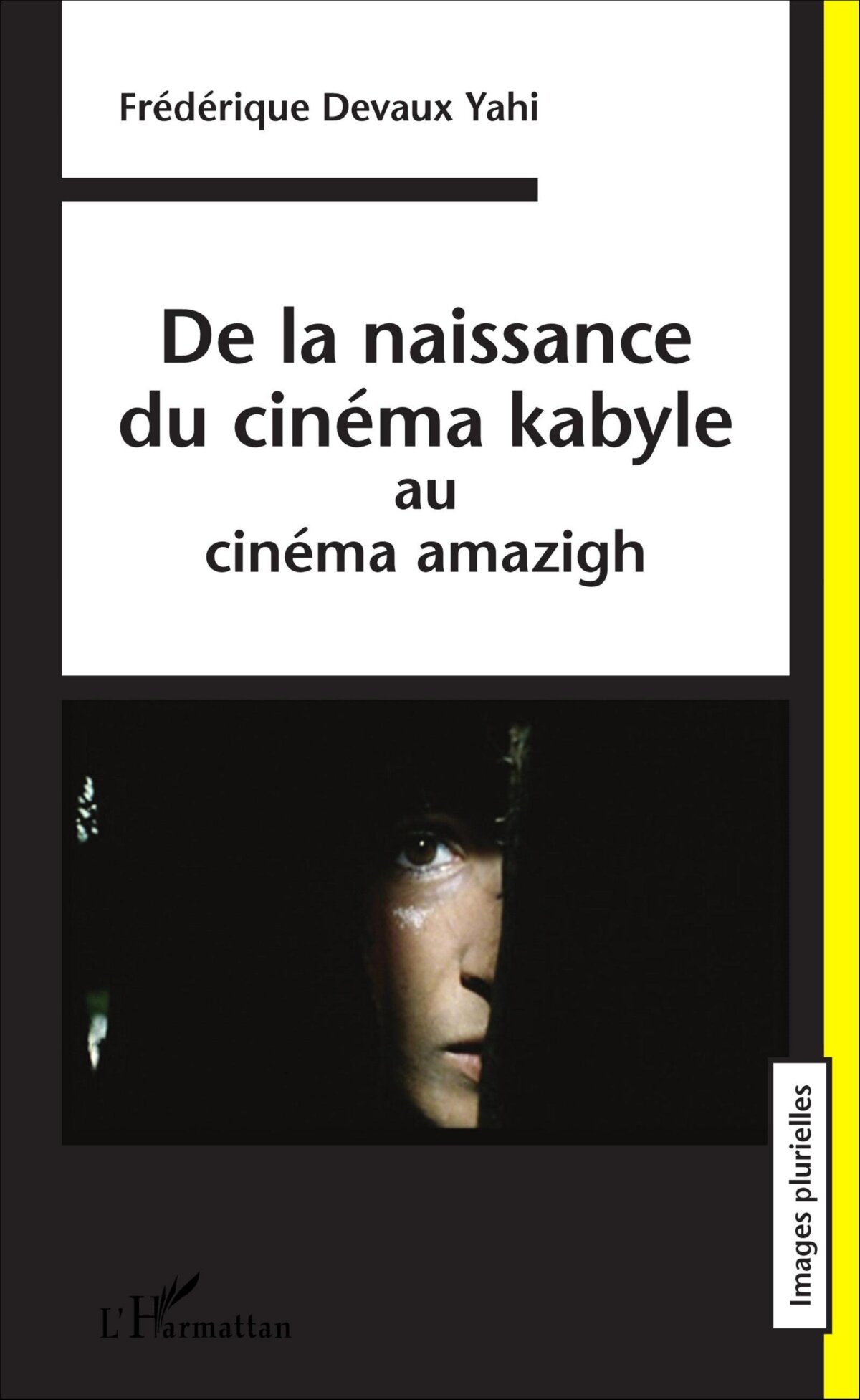
Agrandissement : Illustration 1
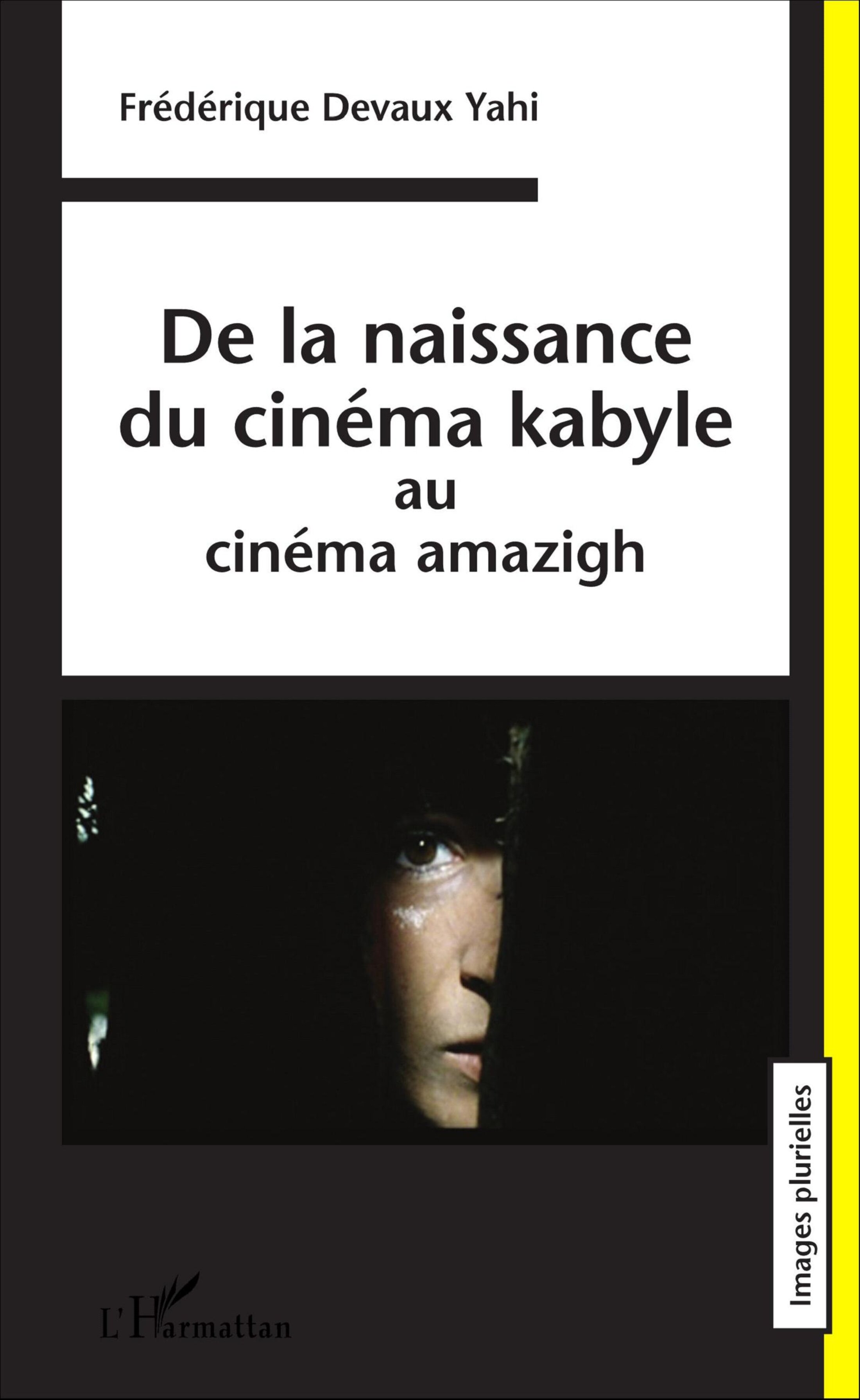
De la naissance du cinéma kabyle
de Frédérique Devaux Yahi
Nombre de pages : 262
Date de sortie (France) : mars 2016
Éditeur : L’Harmattan



