
Entretien avec Bouchera Azzouz, coauteur avec Corinne Lepage du livre « Les Femmes au secours de la République, de l’Europe et de la planète », édité par Max Milo
Comment est apparu le projet d’écrire un livre avec Corinne Lepage ?
Bouchera Azzouz : Nous nous sommes retrouvées après un appel que j’avais lancé avec quelques amis centristes, dans Le Monde en avril 2012 intitulé « Nous, centristes, appelons à voter Hollande ». Dès lors, nous avons réfléchi, et travaillé ensemble sur l’idée de faire émerger un vaste pôle de centre gauche, et une autre manière de faire de la politique. Au final, a été lancé « le rassemblement citoyen » mobilisant la société civile à parité au côté de politiques, pour partir de la base et élaborer un programme politique participatif ancré dans la réalité du quotidien de nos concitoyens.
La rencontre avec Corinne Lepage a-t-elle modifié votre réflexion sur la place des femmes dans la politique ?
B. A. : Oui, certainement. D’abord parce qu’elle est une femme politique qui a été à la fois élue et ministre, c’est donc une expérience très concrète de ce qu’est être une femme dans un milieu dominé depuis des siècles par les hommes. La machine politique fonctionne sur des dynamiques très masculines, être une femme est forcément une contrainte supplémentaire. D’ailleurs, Corinne raconte certaines anecdotes intéressantes dans le livre qui témoignent de la difficulté des femmes à être respectées pour ce qu’elles sont, et ce qu’elles sont en capacité à faire. Les femmes doivent toujours faire la démonstration de leur compétence bien plus que les hommes.
Pourquoi avoir choisi le terme « république » et non pas « démocratie » dans le titre de votre livre ? En effet, l’idée de démocratie reprend l’idée que tout individu peut participer à la construction de la société, femmes et hommes comprises.
B. A. : Nous sommes parties de la République, parce que notre propos dans ce livre était de démontrer que l’exclusion des femmes du champ politique, et leur relégation aux premières heures de la République, a installé pendant des siècles des inégalités structurelles dont on tente encore aujourd’hui de sortir. La République n’est vraiment une démocratie qu’à partir du moment où les femmes ont obtenu le droit de vote, c’est-à-dire en 1945. Avant cette date, elles étaient considérées comme des citoyens passifs, et tous les droits qu’elles ont obtenu sont consécutifs aux luttes politiques pour accéder aux mêmes droits que les hommes. En ce sens le combat féministe est un combat éminemment politique, qui n’est pas seulement pour servir les femmes, mais au service de la République, pour que les valeurs fondatrices soient en cohérence avec l’organisation sociale et politique de la Nation.
Quelle est la volonté qui vous anime lorsque vous vous lancez dans ce projet de livre ? Peut-on y voir un véritable programme politique ?
B. A. : Notre volonté dans ce livre est en effet de remettre le féminisme au cœur de la République, non comme une vision réductrice, mais au contraire comme une critique radicale de la société, permettant de mettre en exergue les inégalités structurelles, qui excluent les plus faibles, les plus reléguées socialement. En cela, c’est en effet un programme politique qui prône que seules les réformes structurelles nous permettront de faire évoluer notre République pour parvenir à un État émancipateur, social et écologique.
Le système politique tel qu’il est mis actuellement en place permet-il en principe l’entrée dans l’espace politique des femmes ?
B. A. : Il est terrible de constater que pour permettre l’émergence des femmes en politique il a fallu mettre en place à la fois des lois, mais pire encore des sanctions financières pour s’assurer que les lois de parité ne soient pas contournées. Malgré tout, on a pu le voir encore récemment, certains partis politiques préfèrent payer cher plutôt que de céder des places aux femmes.
Pour autant, les choses évoluent, mais il me semble que nous devrions, nous les femmes, faire aussi un travail sur nous, pour investir d’avantage l’espace politique. Ce sera une longue bataille, pour changer les esprits, mais aussi changer la manière de faire de la politique. J’ai le sentiment, je dirai même la conviction, que la défiance du peuple à l’égard des politiques fera émerger de nouveaux partis citoyens, davantage préoccupés par l’intérêt général, et bouleversant les vieilles organisations politiques qui semblent à bout de souffle et d’idées.
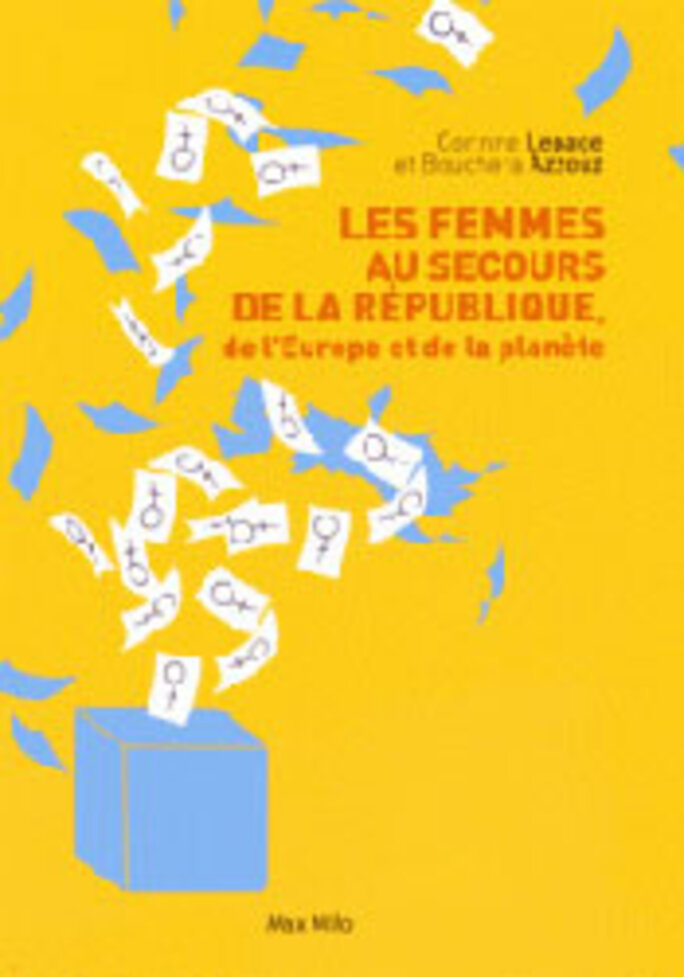
Quelle est la place des réflexions féministes à l’heure actuelle dans les objectifs que ce sont fixés les différents partis politiques en France ?
B. A. : Il me semble que le féminisme est posé à la marge des préoccupations des partis politiques. D’ailleurs, le féminisme est cantonné à la question des violences faites aux femmes, de l’égalité salariale et de la parité dans les conseils d’administration des grandes entreprises. C’est ce que j’appelle une vision à la fois réductrice et volontairement méprisante. Le féminisme, cela n’est pas l’affaire des femmes, à la marge des autres problématiques de notre société. C’est un problème de fond central. Nous vivons dans une société longtemps pensée par les hommes et demeurant essentiellement patriarcale. Dès lors que les femmes ont gagné des droits, elles ont bouleversé l’organisation sociale, en s’affranchissant de l’espace privé et en investissant l’espace public. Mais pour être accompagnées dans cette dynamique émancipatrice, il aurait fallu que les politiques prennent en compte les besoins inhérents à ces changements. Or, on le voit, et les chiffres parlent d’eux-mêmes, la garde d’enfant reste un problème, la prise en charge des personnes en situation de dépendance, vieillissantes ou malades est assumée majoritairement par les femmes (4 millions d’emplois dit gratuits assumés par les femmes), la gestion de la monoparentalité, l’accès au logement, à la formation, à l’emploi, etc.
Aujourd’hui, on balaye la question sociale d’un revers de main, alors que cette question cimente le combat féministe, mais au-delà le combat pour une société plus juste, plus équitable, plus égalitaire.
Dans votre documentaire Nos mères, nos daronnes, vous rendez hommage à la génération féminine de votre mère, leurs combats au quotidien que l’histoire officielle du féminisme n’a pas retenu. Le « féminisme populaire » dont vous avez déjà parlé, est-il une tentative de démocratiser le débat ?
B. A. : Ce film est en effet une manière pour moi de rendre hommage à toute une génération de femmes au côté desquelles j’ai grandi et qui ont forgé ma conscience féministe, à commencer par ma mère, Rahma. Je ne suis pas devenue féministe par militantisme, ou en lisant les grandes œuvres sur ce sujet. Je suis peu à peu devenue une féministe engagée parce que j’ai compris au contact quotidien de ces femmes, que le simple fait de réagir aux différentes formes d’oppression qui nous assignent parce qu’on est femmes, est l’essence même du féminisme. Dès lors, nos mères, nos daronnes, sont des féministes. Elles ont mené leurs combats à la marge des grandes luttes médiatisées, pour autant leurs luttes silencieuses et modestes, à l’échelle de leur vie, sont pour nous, filles, ou femmes des quartiers populaires, un héritage dont on doit avoir conscience et que la société doit reconnaître.
Votre hommage sincère et émouvant aux « daronnes » témoigne-t-il de la nécessité de lutter contre les fractures générationnelles ?
B. A. : La mémoire et la transmission vont de pair. Je crois que nous souffrons de la non reconnaissance des dynamiques positives qui existent dans les quartiers. Ces générations de femmes qui ont construit nos quartiers populaires au début des années 1970, sont des mères, des grands-mères, qui ont participé à écrire une part de notre histoire commune. Mais dans l’imaginaire collectif, elles incarnent autre chose : des femmes soumises, malheureuses, mélancoliques, or, on le voit dans le film, elles sont aux antipodes de cela, manifestant un lien entre les générations. Indéniablement, elles ont construit un féminisme d’urgence, un féminisme de débrouille, qu’on peut appeler un « féminisme populaire » qui leur est propre.
On retrouve dans les peintures de votre mère, un constat très proche du film Fatima de Philippe Faucon (librement adapté du récit autobiographique “Prière à la Lune” de Fatima Elayoubi) : lorsque l’on ne maîtrise pas les mots, il faut trouver d’autres moyens d’expression pour communiquer avec son entourage, familial ou plus éloigné. Est-ce également ce qui vous amène à multiplier les supports médiatiques : livre et documentaire audiovisuel ?
B. A. : Avoir la chance de pouvoir m’exprimer est déjà beaucoup. Avoir la chance de pouvoir utiliser de multiples moyens pour le faire, c’est extraordinaire. Mais quel que soit le support, je me vois avant tout comme une militante qui a des combats à mener, des idées à faire avancer, et pour cela j’utilise tous les moyens à ma portée. Et puis les choses se font aussi grâce aux rencontres, et ce documentaire je le dois à une formidable rencontre avec une femme exceptionnelle, Caroline Glorion qui a cru dans ce film, tout comme Fabrice Pucheaud, le responsable des documentaires de France 2. Vouloir ne suffit pas, il faut aussi avoir la chance de croiser les bonnes personnes pour faire avancer nos combats.
Comment imaginez-vous votre place dans la politique actuelle ? Quelle forme de lutte souhaitez-vous mener pour continuer à mettre sur la place publique les questions qui vous animent ?
B. A. : Je reste une militante et je n’ai pas envie de sortir de ce cadre. Un jour un ami m’a dit « si tu veux faire de la politique, il faut que tu commences par accepter que 1+1 font 3. » Je crois avoir compris ce qu’il voulait dire. Depuis j’essaye de faire à ma manière de la politique tout en m’assurant que 1+1 font 2 !! j’ai fait un si long chemin pour me libérer de mes chaînes, que l’idée d’en choisir de nouvelles fussent-elles en or massif, ne m’enchante guère !!
Ce premier documentaire m’a vraiment convaincu dans mon envie de poursuivre à faire passer mes luttes au travers de films, soit documentaire, soit fiction. J’ai déjà amorcé plusieurs projets, dont un long métrage pour le cinéma.
Je crois que c’est vraiment dans cette voie que je veux me perdre, tout en continuant à rester viscéralement attacher à mes convictions.



