Sortie Blu-ray de Funny Games U.S., de Michael Haneke
Ann, George et leur fils Georgie arrivent paisiblement dans une maison de vacances en bord de lac. Un jeune homme frappe à leur porte pour leur demander quelques œufs. La demande est insistante et Ann finit par perdre patience. Arrive alors Paul, le comparse du jeune homme, aux sombres intentions. Très vite, la famille se retrouve entre les mains des deux jeunes hommes, prêts à toutes les tortures pour arriver à leurs fins.

Dix ans après la version autrichienne, Michael Haneke réalise le remake américain de son propre film. Les plans se retrouvent à l’identique, comme le scénario. Alors que son film originel tentait de viser le public américain consommateur de violence, force est de constater pour le cinéaste autrichien qu’il ne pouvait arriver à son objectif qu’en filmant en anglais, aux États-Unis, avec des acteurs US et surtout une star de l’aura de Naomi Watts. Cette dernière se prête très bien aux expérimentations du cinéaste comme elle avait précédemment eu l’audace et le courage de le faire auprès de David Lynch dans Mulholland Drive (2001). Ce choix d’actrice était important à la fois en termes de communication (pour toucher un plus large public) et surtout de mise en scène, puisque le film progressivement met en place un face-à-face entre la mère de famille (Naomi Watts) et son bourreau (Michael Pitt). Le choix de Tim Roth dans le rôle du père de famille émasculé très rapidement (il se retrouve dès le début dans l’impossibilité d’être l’homme d’action classique sauvant sa famille à l’instar d’un John McClane dans Die Hard) n’est pas anodin, car l’on pense au cinéma de Tarantino où il est apparu (Reservoir Dogs, Pulp Fiction) : c’est aussi aux spectateurs de Tarantino que ce film s’adresse, interrogeant leur fascination pour la violence. On imagine très bien un dialogue houleux mais passionné entre Michael Haneke et Quentin Tarantino concernant la représentation de la violence au cinéma et la position du spectateur face à celle-ci. Car cette dernière est au centre de tout le film d’Haneke : par de nombreux regards-caméra, le bourreau vient souligner la complicité entre le spectateur et les auteurs de cette violence. Les intentions des bourreaux se trouvent finalement hors-champ, au cœur de la psychologie du spectateur, révélant l’accord tacite éhonté passé entre un cinéaste et son public. Michael Haneke n’hésite pas à briser celui-ci, affirmant la suprématie d’un cinéma d’auteur sur un cinéma de consommation, où la violence est un objet comme un autre. Si certains le trouveront manipulateur, Michael Haneke a du moins l’intelligence de poser la question nécessaire de la responsabilité quant à la production d’images violentes à l’écran : à ceux qui les produisent ou à ceux qui les consomment ? Le cinéaste ne s’épargne pas dans ce interrogation : à plusieurs reprises la caméra subjective épouse le regard du bourreau, dans une association dérangeante bourreau-metteur en scène-spectateur. De même, le choix de représenter une famille de la classe aisée victime des massacres n’est pas non plus gratuit : cela renvoie à une idéologie de la pornographie où le spectateur peut assouvir ses désirs de revanche vis-à-vis d’une société inaccessible aux privilèges innombrables. La violence au cinéma serait-il ainsi un moyen de rétablir l’ordre social dans l’inconscient collectif en satisfaisant les plus bas instincts du spectateur confronté dans la réalité à une hiérarchie sociale elle-même imposée par la violence physique ou symbolique ? C’est une des pistes que propose ce film et dont il serait quelque peu irresponsable de ne pas en prendre la mesure, au-delà de l’adhésion ou non au film.
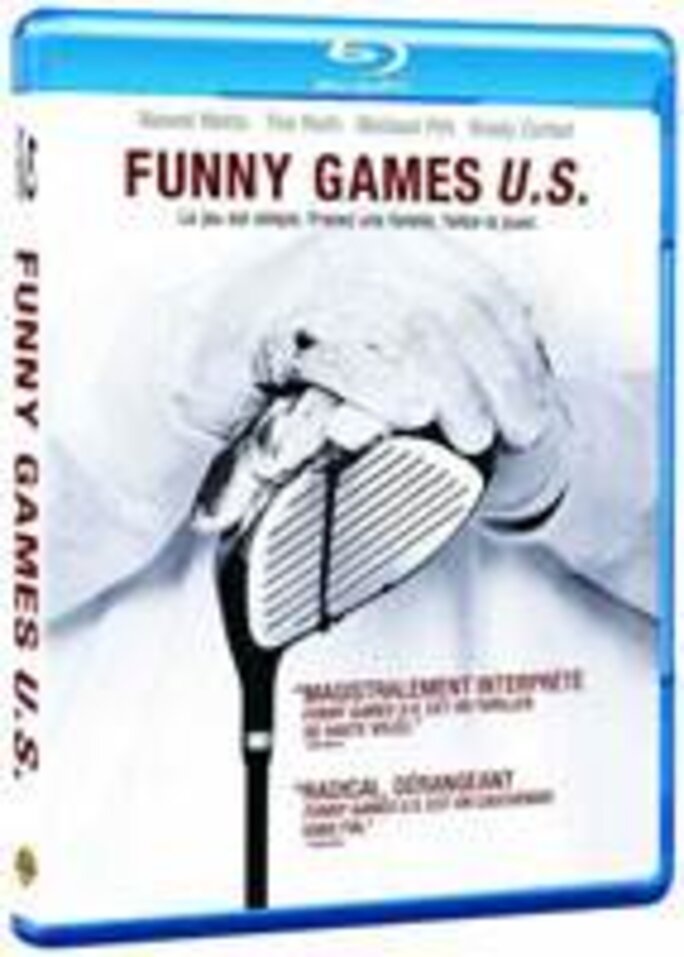
Funny Games U.S.
Funny Games U.S.
de Michael Haneke
Avec : Naomi Watts (Ann), Tim Roth (George), Michael Pitt (Paul), Brady Corbet (Peter), Devon Gearhart (Georgie), Boyd Gaines (Fred)
États-Unis – France – Royaume-Uni – Autriche – Allemagne - Italie – 2007.
Durée : 111 min
Sortie en salles (France) : 23 avril 2008
Sortie France du DVD : 2 mai 2014
Format : Scope – Couleur
Langue : anglais - Sous-titres : français.
Éditeur : Warner Bros.



