Sortie DVD de Tout est permis, de Coline Serreau

Agrandissement : Illustration 1

Après Solutions locales pour un désordre global, Coline Serreau poursuit sa veine documentaire avec Tout est permis. À travers ces deux films, la cinéaste interroge la société contemporaine quant à ses responsabilités et ses prises de décisions. Cela l’amène à identifier la morale de chaque individu, plus particulièrement dans la société française actuelle dans Tout est permis. Elle s’est ici intéressée aux stages de récupération de points comme lieu où se joue et s’exprime un certain sens du rapport à l’autre, de la prise de conscience de faire partie d’une communauté. Lors de ces stages payants et obligatoires afin de pouvoir récupérer les points perdus sur son permis, c’est la déviance de chacun vis-à-vis des règles imposées par la sécurité routière qui est mise en question. La route étant un espace social où la déviance peut entraîner la mort de l’autre, il s’agit pour les formateurs de réapprendre à chacun le sens des règles imposées (limites de vitesse, taux d’alcool dans le sang, interdiction du téléphone portable au volant, etc.) dans un esprit civique de vivre ensemble. En équipe réduite pour mieux s’intégrer au groupe, Coline Serreau filme elle-même ces stages. La plupart du temps, sa caméra épouse complètement le point de vue du formateur : elle avoue elle-même être fascinée par l’importance de leur travail, après être passée du côté des « élèves ». La limite de ce dispositif est d’adopter un ton trop proche du sermon : les personnes assistant à ces stages sont filmées dans leurs contradictions, leurs présupposés, leurs erreurs. Il n’y a donc pas de dialogue véritable entre eux et le formateur : la seule parole à suivre est celle de ce dernier. C’est ce que veut faire comprendre ce documentaire, comme un relais hors de ces lieux de stage. Plusieurs témoignages extérieurs de « spécialistes » viennent ponctuer ces moments pour compléter et donner plus de conviction aux propos des formateurs. Or, ces spécialistes ne sont pas systématiquement présentés identifiés à l’écran par un sous-titre. D’autres fois, on peut s’étonner de la présence d’un maire UMP pour représenter à lui tout seul la pensée de l’élu local. Un autre travers de la mise en scène « moralisatrice » du documentaire apparaît clairement lorsqu’est identifié enfin un sombre et grand ennemi de tous quant à la sécurité routière : les alcooliers. La musique vient accentuer un témoignage pour symboliser le mal. Même si leurs responsabilités quant aux crimes organisé sur la route est indéniables, cela mériterait une investigation à part entière, sujet d’un autre documentaire, plutôt que de s’en servir ici le mal qui explique tout le désordre, dans un monde conséquemment manichéen.

Le documentaire, en offrant aux formateurs une place privilégiée ne souffrant d’aucune critique, oublie d’interroger leur statut. Alors qu’il est indiqué à un moment que les stages sont organisés par des sociétés privées, qui engrangent des bénéfices du fait de la déviance des citoyens, jamais n’est questionnée cette délégation, cet abandon de l’État à des entreprises privées pour partager son sens de la citoyenneté et du vivre ensemble. Comme si l’État décidait de privatiser complètement l’éducation publique sans que personne ne soucie des conséquences quant à l’apprentissage de la sociabilité. Dès lors, l’État incarne la règle, la répression à travers ses agents, alors que le fruit des infractions sont gérées par des sociétés privées (caméras sur autoroute, les autoroutes elles-mêmes, les stages, etc.) en pleine expansion. Ainsi, l’État, en privatisant à outrance ses responsabilités vis-à-vis de la population qu’il incarne, finance son propre rejet, pour ne pas dire sa haine et donc son autodestruction. Les conduites individualistes des mauvais conducteurs les plus emblématiques de ce film en sont le criant symptôme. Il n’en reste pas moins que le documentaire traite un sujet passionnant, permettant de réfléchir sur les responsabilités des conducteurs, sans pour autant se cacher dans l’idée que « le problème c’est l’autre ». Tout est permis, en poursuivant un véritable travail d’investigation, aurait pu être en mesure de brosser le portrait de la société française actuelle placée dans le contexte des idéologies économiques productivistes où la croissance est au centre (cette idée n’est hélas qu’à peine évoquée dans l’association entre le désir de puissance du commercial et sa conduite automobile). Comme sur la route, il est essentiel qu’un documentaire garde une nécessaire distance vis-à-vis de son sujet, pour mieux l’appréhender, en voir toutes les facettes et proposer un regard synthétique, loin de l’ivresse de la fascination d’un discours.
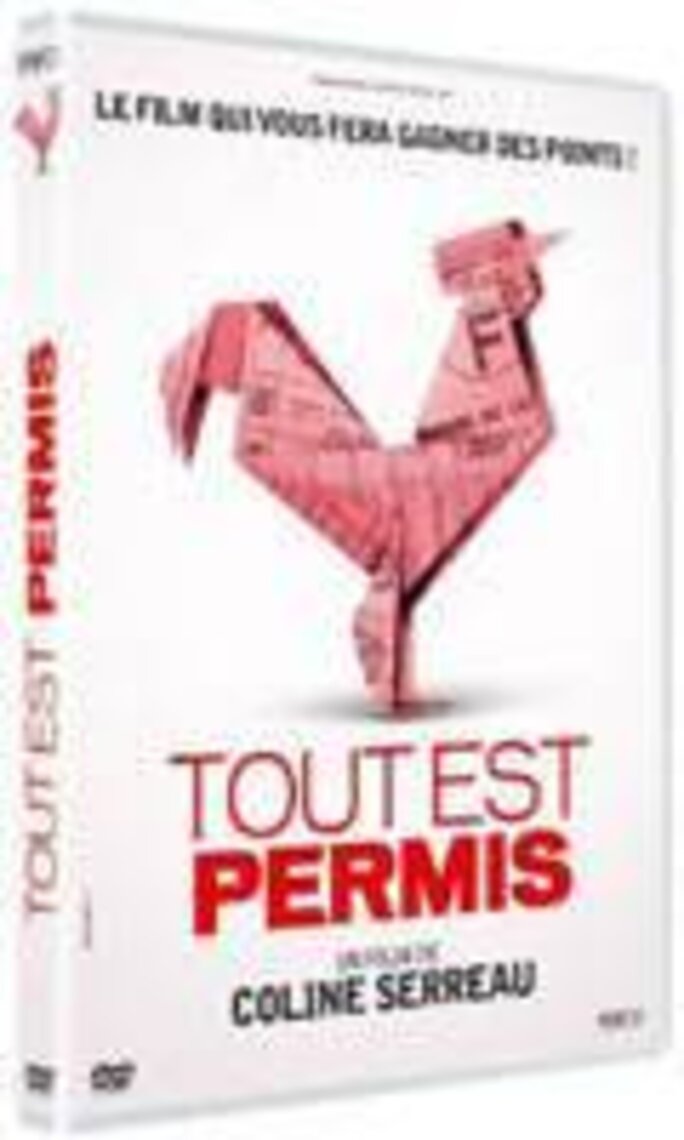
Tout est permis
de Coline Serreau
France - 2014.
Durée : 96 min
Sortie en salles (France) : 9 avril 2014
Sortie France du DVD : 9 septembre 2014
Format : 1,77 – Couleur
Langue : français.
Éditeur : BAC Films



