
Sortie DVD de La Maison de la radio, de Nicolas Philibert
Avec Raymond Depardon, Nicolas Philibert partage ce statut d’auteur du cinéma documentaire à la filmographie conséquente, dont on a autant plaisir à découvrir ses nouveaux sujets de découvertes que son univers et sa sensibilité. L’objet de son film est ici entièrement contenu dans son titre : La Maison de la radio, ce lieu où sont produites la plupart des émissions de Radio France. Ce lieu, il le filme comme à son accoutumée de l’intérieur, révélant ainsi au spectateur l’invisible. Comprenant tout l’intérêt de ce lieu qui serait comme une grande usine productrice de voix, sa démarche consiste ici à filmer la voix : c’est là son personnage principal et dès lors toute la dramaturgie du film en découle. Il n’est donc pas question de comprendre comment s’organise les relations sociales au travail, comment les uns travaillent avec les autres, les rivalités, les complicités, les relations de pouvoir, etc. Ainsi, on ne trouvera aucun sous-titre ni voix off précisant les identités et les fonctions des personnes filmées. À l’exception de Frédéric Lodéon (et aussi Joël Colado mais qui lui figure en bonus, et non dans le film proprement dit) filmé dialoguant face caméra avec celle-ci pour justifier l’ordre de son bureau, ce sont les images et les situations qui parlent d’elles-mêmes. De la même manière que les voix de la radio s’immiscent au cœur de l’intimité des vies de chacun, la caméra de Nicolas Philibert invite le spectateur à s’immiscer discrètement dans cette ruche d’hommes et de femmes au travail, sans que sa présence ne vienne interrompre leur mouvement. Ainsi, le film satisfait le plaisir coupable de voyeurisme dans chaque auditeur : voir pour ajouter une touche de plus au plaisir d’entendre.

Tourné sur six mois, Nicolas Philibert a choisi un montage où le récit se déroule telle une journée, ce qui renforce son regard entomologiste tentant d’appréhender le bourdonnement énergique de la ruche dans le cycle de 24 heures. Ainsi, les personnages devant la caméra se succèdent avec l’effervescence des abeilles dévouées à la vie de la ruche, sans distinction individuelle. Il s’agit là d’un véritable parti pris de Nicolas Philibert de ne pas mettre en avant les « stars » de la radio, ne faisant pas de concession aux attentes du spectateur tenté de voir ce qu’il connaît déjà. Toutefois Marguerite Gateau et Marie-Claude Rabot-Pinson sont deux personnages récurrents, l’une dirigeant la fiction et l’autre au bocal d’Inter. Ces deux personnages servent surtout à la diégèse du film, participant à l’écoulement du temps (de la journée pure fiction) et mettant en valeur deux missions apparemment distinctes de la radio : la fiction et l’information. De là émerge l’idée que les deux sont étroitement nourris l’un de l’autre. La fiction est hyper maîtrisée alors que l’information est sélectionnée après avoir ri des sujets les plus sordides et catastrophiques. Le sérieux se trouve paradoxalement dans la construction de la fiction plutôt que dans l’information alors que le résultat à l’antenne semble supposer le contraire. Une véritable odyssée dans le labyrinthe des couloirs étroits de Radio France dont on ne voit pas la sortie à cause des courbes du bâtiment. En cela aussi, Nicolas Philibert a bien su utilisé les potentialités du lieu pour servir la sensibilité de son regard et son histoire qu’il a choisi de raconter. Au final, il en résulte un beau documentaire sur la production du son et son hyper contrôle. Parfois il semble que la production incessante de sons la plus parfaite possible soit plus importante que le contenu intelligible desdits sons. Ce regard critique apparaît là où on ne l’attendait pas, puisque le film apparaît à première vue comme un hommage à un média dominant dans l’hexagone, où tout esprit critique est rapidement évacué (cf. Stéphane Guillon, Didier Porte, Daniel Mermet et son équipe, etc.). Le regard de Nicolas Philibert est fin, sensible et toujours proche des intentions de son premier documentaire : La Voix de son maître. Un bel exercice de sa caméra au service de son éthique.
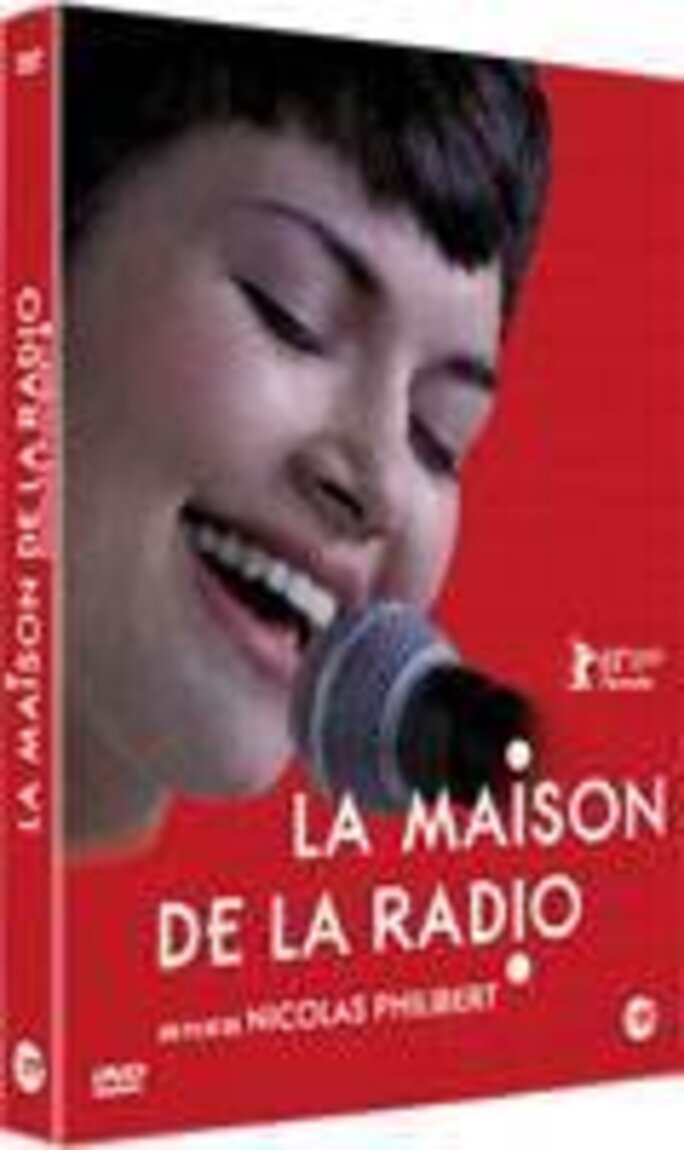
La Maison de la radio
de Nicolas Philibert
France - 2013.
Durée : 103 min
Sortie en salles (France) : 3 avril 2013
Sortie France du DVD : 5 novembre 2013
Couleur
Langue : français.
Éditeur : Éditions Montparnasse
Bonus :
- Joël comme Collado – 12 min
- France Culture au Festival d’Avignon : « Forcenés » – 38 min



