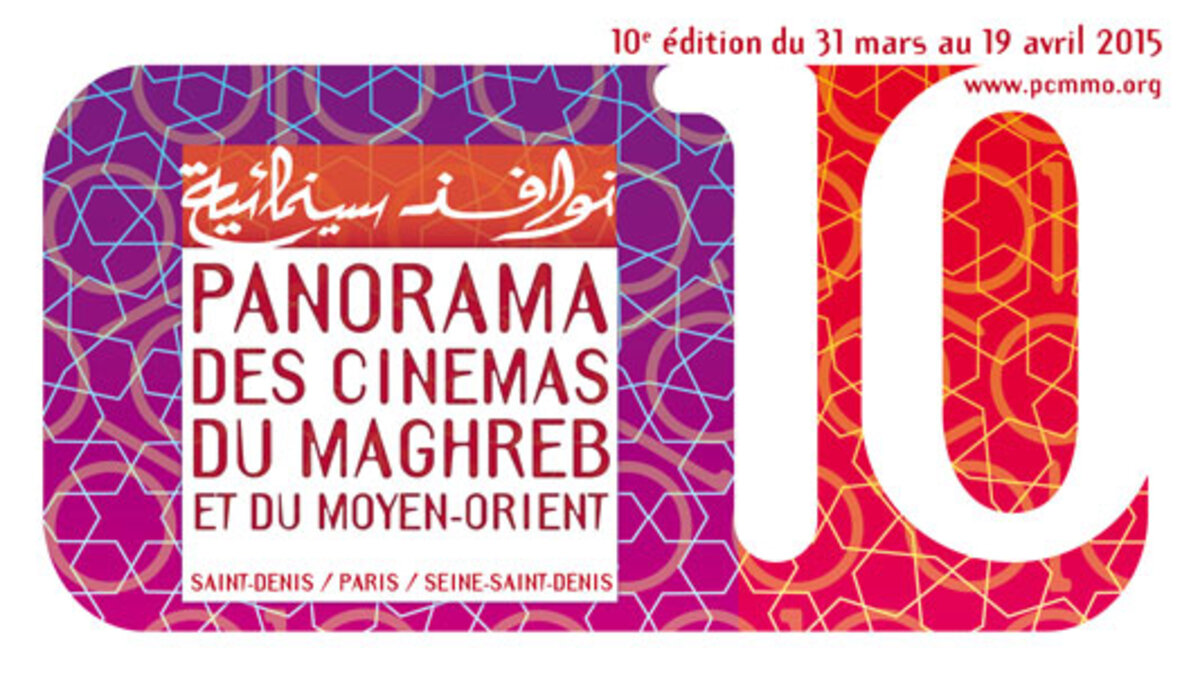
Du 31 mars au 19 avril 2015 s’est tenue la 10e édition du Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, dans les salles de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis et à Paris. Pour présenter ce festival de cinéma, Emma Raguin, directrice artistique et coordinatrice générale, a bien voulu répondre aux questions suivantes, avec l’appui d’Abdel Benchenna, Maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris 13, coanimateur (avec Patricia Caillé et Nolwenn Mingant) du séminaire Mena cinéma et modérateur de la table ronde sur le thème de La Diffusion des cinématographies du Sud qui s'est tenue au cinéma l'Écran de Saint-Denis le 3 avril 2015 durant le festival.
Quelle est la ligne éditoriale du festival ?
Emma Raguin : Le Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient a pour vocation de promouvoir la belle variété et la qualité des productions cinématographiques de ces régions. Nous sommes très attachés à faire connaître les différents talents émergents de ces pays dont la créativité autant en documentaire qu'en fiction est foisonnante. Nous avons à cœur également de revenir lors de chaque édition sur d'anciens films majeurs de ces cinématographies à l'instar cette année de Beyrouth, la rencontre de Borhane Alaouié, et l'an passé Avoir 20 ans dans les Aurès de René Vautier ou Mirage d'Ahmed Bouanani. La ligne éditoriale se définit aussi avec les films qu'on reçoit, cette partie du monde est bouillonnante et en pleine mutation. Nous recevons beaucoup de films qui promeuvent des valeurs universelles et humanistes, qui défendent la justice sociale, la liberté d'expression, le droit à la liberté de conscience, l'émancipation des femmes et des peuples.

Dans quel contexte est apparu le festival il y a dix ans ?
Emma Raguin : Kamal El Mahouti, le fondateur est lui-même réalisateur. À la faveur d'un projet de long métrage au Maroc, son pays d'origine, il a été frappé par la quantité et la qualité de la production nationale à l'époque, à l'instar de Mille mois de Faouzi Ben Saïdi (Un certain Regard) et Les Yeux secs de Narjiss Nejjar (La Quinzaine des Réalisateurs), les deux présents au Festival de Cannes en 2003. On parlait d'une Nouvelle vague marocaine. Kamal a proposé à Latif Lahlou, le président du Garp (Groupement des auteurs réalisateurs producteurs) et au centre cinématographique marocain d'organiser ensemble trois jours dédiés au cinéma marocain. Ils ont donné leur accord. Puis Kamal, dionysien, a proposé le projet à Boris Spire, le directeur du cinéma l'Écran de la ville de Saint-Denis. L'intérêt a été immédiat et c'était parti pour une première édition en 2006 qui a rencontré un succès public important et qui nous a donné la motivation pour continuer !
Quels furent les évolutions majeures du festival au fil des années ?
Emma Raguin : Deux évolutions majeures : un éventail géographique plus large avec l'ouverture au Maghreb et au Moyen-Orient et des collaborations avec de nouvelles salles partenaires en Île-de-France
1 - un éventail géographique plus large
Dès la deuxième édition, il y a eu une fenêtre ouverte sur le cinéma algérien avec notamment Rome plutôt que vous de Tariq Téguia et d'un commun accord avec nos partenaires, nous avons ouvert aux cinémas du Maghreb dès la troisième édition, puis à ceux du Moyen-Orient, à la septième. Cela nous a permis d'avoir un éventail de choix plus large et par conséquent de proposer une belle qualité en terme de sélection. Cela a également enrichi la programmation en terme de contenus. Cette large zone géographique comprend une richesse et une diversité en termes de peuples et de langues (berbère, arabe, persan, turc...), de cultures et de religions. Si le monde rural est très présent, il y a une grande vitalité de la création contemporaine dans les grandes villes.
2- des collaborations avec de nouvelles salles partenaires
Le berceau et le cœur de festival est le cinéma l'Écran de Saint-Denis : nous travaillons en étroite collaboration avec Boris, le directeur, Catherine Haller, la programmatrice et Carine Quicelet, la programmatrice jeune public. Notre public dionysien est nombreux, fidèle et très varié (abonnés du cinéma l'Écran, familles de quartier, étudiants en cinéma...) et nous suit également hors festival dans nos séances coups de cœur pour accompagner la sortie de films que nous soutenons (Omar de Hany Abu-Assad, C'est eux les chiens de Hicham Lasri, L'Oranais de Lyes Salem, Iranien de Mehran Tamadon...).
Très vite, nous avons également eu comme partenaires plusieurs salles du département. Dans la continuité, se sont ajoutées des salles à Paris telles que Le Louxor, L'Entrepôt, et plus récemment l'Institut des cultures d'islam et l'Institut du monde arabe. Nous en sommes très heureux car cela donne l'occasion aux films d'être vus plus largement et c'est le but du festival !

En quoi le festival peut-il être le reflet de l’état du cinéma au Moyen-Orient et au Maghreb ?
Emma Raguin : Nous sommes en contact étroit avec les professionnels de cinéma de ces régions et nous diffusons leurs films. Nous recevons des films dont les conditions de production sont très variables, certains sont autoproduits, d'autres ont bénéficié de soutien en production au niveau national ou à l'international par les biais de financements en soutien aux projets du Sud à l'instar de Doha Film Institute qui remet des bourses au développement, à la production ainsi qu'à la post-production. Notre festival est un reflet d'un état du cinéma de ces régions mais ne peut témoigner de toute la diversité des situations d'un pays à un autre. Nous sommes une petite équipe à l'année et nous recevons environ deux cents films alors que la production totale est plus importante encore.
Comment les films sont sélectionnés ? Quelles sont les conditions ?
Emma Raguin : Nous recevons des films sous forme de liens ou de DVD tout au long de l'année. Les cinéastes ou les productions peuvent nous contacter par mail et nous envoyer leurs propositions de films. Notre manifestation commence à être bien ancrée dans le paysage des festivals d'autant plus que certains films ont trouvé un distributeur grâce à leur diffusion au PCMMO. Par ailleurs, nous sommes très attentifs aux sélections de nos festivals partenaires à l'international tels que le festival international de Dubaï, le festival international de Doha ou encore celui de Genève. Enfin l'équipe de programmation suit l'actualité de ces cinématographies et se rend aux avant-premières et à des projections privées dont ils ont connaissance par les réseaux professionnels.
Il y a une première sélection faite par l'équipe puis les films retenus sont visionnés par tous. Nous avons plusieurs réunions de discussions avec les chargé-e-s de programmation et le choix final se fait au mois de janvier.
Dans le domaine cinématographique, y a-t-il eu selon vous un avant et après « Révolutions du monde arabe » ?
Emma Raguin : Indéniablement, en particulier pour les productions tunisiennes et égyptiennes. Nous avons reçu énormément de documentaires qui ont suivi les mouvements pendant la révolution et juste après. Les productions nationales se sont démocratisées et de nombreux cinéastes ont eu envie de témoigner des bouleversements en profondeur de leurs pays. Il y a eu une importante production de films à caractère politique qui dénonçaient la censure, les conditions sociales des plus démunis, la corruption, les États sourds aux souffrances de leur peuple. Dans d'autres pays comme le Maroc, suite à l'Instance Équité et Réconciliation (IER) mise en place en avril 2004, plusieurs films sur le sujet des années de plomb ont vu le jour. Pour ce qui est de la Syrie, le pays est en proie à la guerre. Il y a quand même des projets qui voient le jour, souvent des documentaires ainsi que des web-documentaires qui tentent de partager au jour le jour les conditions terribles de vie de la société civile.

Quels sont les pays au sein du Moyen-Orient et du Maghreb dont la production de films annuelle est la plus importante ?
Abdel Benchenna : Deux pays peuvent être cités. D’un côté, vous avez l’Égypte qui produit en moyenne 34 films par an pour la période 2002-2011. De l’autre, le Maroc, avec 20 longs métrages en moyenne par an depuis 2010. Notons que l’histoire de la production cinématographique en Égypte est ancienne. La naissance de l’industrie cinématographique en Égypte remonte aux années 1930 et le développement d’un véritable cinéma commercial commence à prendre forme dès les années 1940 alors qu’au Maroc, les premiers longs métrages ont été produits douze ans après l’Indépendance, en 1956.
Et inversement, les pays dont la production cinématographique est quasi inexistante ou qui a du moins beaucoup de difficultés à exister ?
Abdel Benchenna : La production d’un film reste un parcours du combattant pour une majorité de réalisateurs dans la région. Faute de véritables producteurs, les réalisateurs sont souvent obligés de produire leur film et donc de créer leur propre maison de production, souvent éphémère. L’absence d’aide et de soutien à la production dans beaucoup de pays engendre une production faible en nombre de films par an comme en Tunisie avec 3 à 4 longs métrages ou l’Algérie avec 2 à 3 films par an. Mais attention, ce n’est pas parce qu’il y a des dispositifs de soutien à la production, dans certains pays comme au Maroc, par exemple, que cela se traduit forcément par des films de qualité.
Notons également l’apport des aides européennes, et plus particulièrement la France, qui permet à certains réalisateurs, surtout Maghrébins, de réaliser leur film.
Enfin, nous observons, ces dernières années, un intérêt soutenu de certains pays du Golfe à l’industrie cinématographique dans la région. Ceci se traduit par la multiplication des festivals et des fonds d’aides qui bénéficient, entre autres, à des réalisateurs de la région.
En somme, la production cinématographique dans la région est en pleine mutation, pour ne pas dire la totalité de la filière. Cette mutation est complexe à saisir. C’est la raison pour laquelle un séminaire de recherche (cf. http://cinemamena.hypotheses.org) a été lancé par des chercheurs français. L’objectif est de diffuser des recherches scientifiques sur les cinémas en présence au Maghreb et au Moyen-Orient et mettre en réseau les chercheurs travaillant sur cette question.
Quelles sont les raisons qui expliquent les disparités entre pays ?
Abdel Benchenna : Les disparités trouvent leur origine dans plusieurs facteurs. Le plus important d’entre eux est la volonté politique des États et donc la présence ou l’absence de politiques d’accompagnement de la filière cinématographique, depuis la production jusqu’à l’exploitation en salles, en passant par la distribution. Dans certains pays, il y a une absence totale de politique en la matière, comme l’Algérie, la Tunisie. Dans d’autres, on observe une focalisation sur une partie de la filière. Pendant plusieurs années, au Maroc, par exemple, tous les efforts ont été mis sur la production de films tout en négligeant les questions de la distribution et l’exploitation des films dans les salles. Beaucoup de films marocains n’ont jamais connu d’exploitation dans les salles de cinéma.
Comment s’est déroulée cette 10e édition de 2015 ?
Emma Raguin : Le plébiscite du public pour la programmation nous réjouit. Nous avons reçu des retours chaleureux au fur et à mesure des séances ainsi que sur notre page Facebook, de plus la fréquentation, en nombre de spectateurs, a augmenté.
Au cinéma l'Écran, cœur de festival, jeune public et scolaires inclus : 3000 spectateurs pendant le festival, 3500 avec les séances coups de cœur, 4000 en tout à Saint-Denis avec les séances dans les maisons de quartiers, médiathèques de Plaine Commune, université, librairie, théâtre Gérard-Philipe.
1500 de plus avec les salles partenaires de Seine-Saint-Denis et de la région Île-de-France. Enfin environ 500 pour les séances en régions ou à l'étranger dans les centres culturels français, soit un total de 2000.
Cela fait pour cette année déjà 6000 spectateurs dont les deux tiers dans notre berceau la ville de Saint-Denis et on en est très heureux !
Il reste des séances partenaires en mai au musée du Quai Branly et à Cannes Visions Sociales, j'en profite pour remercier ce festival organisé par la CCAS qui va permettre la présence des cinémas de la région cette année car il y a peu de films d'Afrique et du Moyen-Orient dans les sélections officielles.
Quels perspectives à venir pour le festival ?
Emma Raguin : Plus que jamais, il nous semble important et nécessaire de faire connaître la belle créativité des cinémas d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient et de leurs diasporas. Ces films sont l'occasion de débats passionnants entre les cinéastes et le public. De nombreux spectateurs jeunes et moins jeunes nous font des retours très émouvants sur les modifications profondes de leur perception face aux cultures de ces régions du Monde. Des préjugés tombent, des voiles se lèvent et les états d'esprit s'ouvrent au dialogue. Le cinéma permet d'aller à la découverte et à la rencontre de l'autre dans son altérité mais aussi dans son humanité et dans son universalité. Montrer des œuvres de ces régions et en discuter ensemble est de salut public. Cela permet aux cinéastes d'ici ou là-bas de faire entendre la singularité de leurs voix et points de vue.
Pour autant, l'enjeu va être de renforcer le festival d'un point de vue structurel. Nous avons le souhait et l'urgence d'embaucher une deuxième personne à l'année pour assister à la coordination générale et s'occuper en particulier de la médiation culturelle afin d'ouvrir encore le champ des publics.
site du festival : www.pcmmo.org
et la page Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Panorama-des-cin%C3%A9mas-du-Maghreb-et-du-Moyen-Orient/410373805723747
Équipe du 10e PCMMO
Kamal El Mahouti, fondateur
Président de l'association
Emma Raguin
Direction artistique, coordination générale
Tiphanie Le Baut
Chargée de coordination, assistante de programmation
Olivier Hadouchi, Nadia Meflah, Emna Mrabet
Chargé-e-s de programmation
Géraldine Cance
Attachée de presse
Pierre-François de Malézieu
Chargé de production
Zakaria El Ahmadi
Assistant de production + déco
Perrine Leclere-Bailly
Scénographe
Isabelle Bonnet
Graphiste
Ilhem Aouidad, Mohamed El Khadiri, Fatima Kaci
Stagiaires



