À propos du livre L'Éthique du gangster au cinéma de Sophie Djigo
La figure du gangster a traversé le siècle du cinéma, tout autant que les pays et la littérature en général. Pourquoi cette fascination ? Qu’est-ce que cet attrait exprime et met en place comme type de dialogue entre le public et un réalisateur, notamment ? Sophie Djigo, agrégée et docteur en philosophie, spécialiste d’éthique et de philosophie morale, pose un regard inattendu sur le cinéma, aussi passionnant pour les cinéphiles que les philosophes et les autres lecteurs ne répondant pas nécessairement à ces étiquettes exclusives. La démarche de l’auteure consiste à aller donner la parole à l’humanité qui se cache derrière cette image de hors-la-loi hors normes qui réinterroge profondément, peut-être, l’ordre établi. Pas d’idéalisme dans cette analyse, mais une appréciation de personnages cinématographiques qui évoluent avec leur temps mais qui restent le plus souvent des destinées tragiques ne réussissant jamais à trouver une cohérence entre leur vision du monde et leurs pratiques. Le bouclier gilet pare-balles du gangster reste à n’en pas douter son éthique qui ouvre une fructueuse réflexion, surtout lorsque Sophie Djigo fait intervenir la pensée de Robert Musil, Bourdieu, Foucault, Emerson (Ralph W.), Aristote, Descartes, Murdoch (Iris), Schopenhauer, Kant, Wittgenstein, Platon, Simone Weil, Dos Passos… ainsi que l’analyse des films Sur les quais d’Elia Kazan, Le Cercle rouge de Jean-Pierre Melville, Ghost Dog de Jim Jarmush, Les Affranchis de Martin Scorsese, Little Caesar de William Wellman, Scarface d’Howard Hawks, Le Parrain de Coppola, Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, Traquenard de Nicholas Ray ainsi que la série The Wire de David Simons et Ed Burns. Les références cinématographiques sont ainsi majoritairement étatsuniennes et qui plus est en absence de réalisatrices. On ne s’étonnera pas à ce sujet comme le constate Sophie Djigo que l’univers cinématographique décrit dans ces films de gangsters soit essentiellement misogyne et par là n’interroge l’individu et son rapport à la ville (espace où évoluent systématiquement les gangsters) que par cet angle très spécifique. Il ne s’agit pas à travers ce livre de faire une analyse de l’évolution de la figure du gangster dans l’histoire du cinéma à travers le monde, l’auteure n’ayant aucune prétention à l’exhaustivité, mais plutôt de suivre quelques cas emblématiques et plus facilement connus de l’histoire du cinéma ayant une prétention d’auteur, afin d’inviter à une réflexion philosophique sur l’état de la société à travers des personnages symptomatiques de penchants refoulés qui animent les individus dans leurs espaces respectifs. Sophie Djigo démontre avec une belle perspicacité que la philosophie est un outil bien à propos pour qui veut continuer l’aventure spectatorielle, humaniste et citoyenne du cinéma.
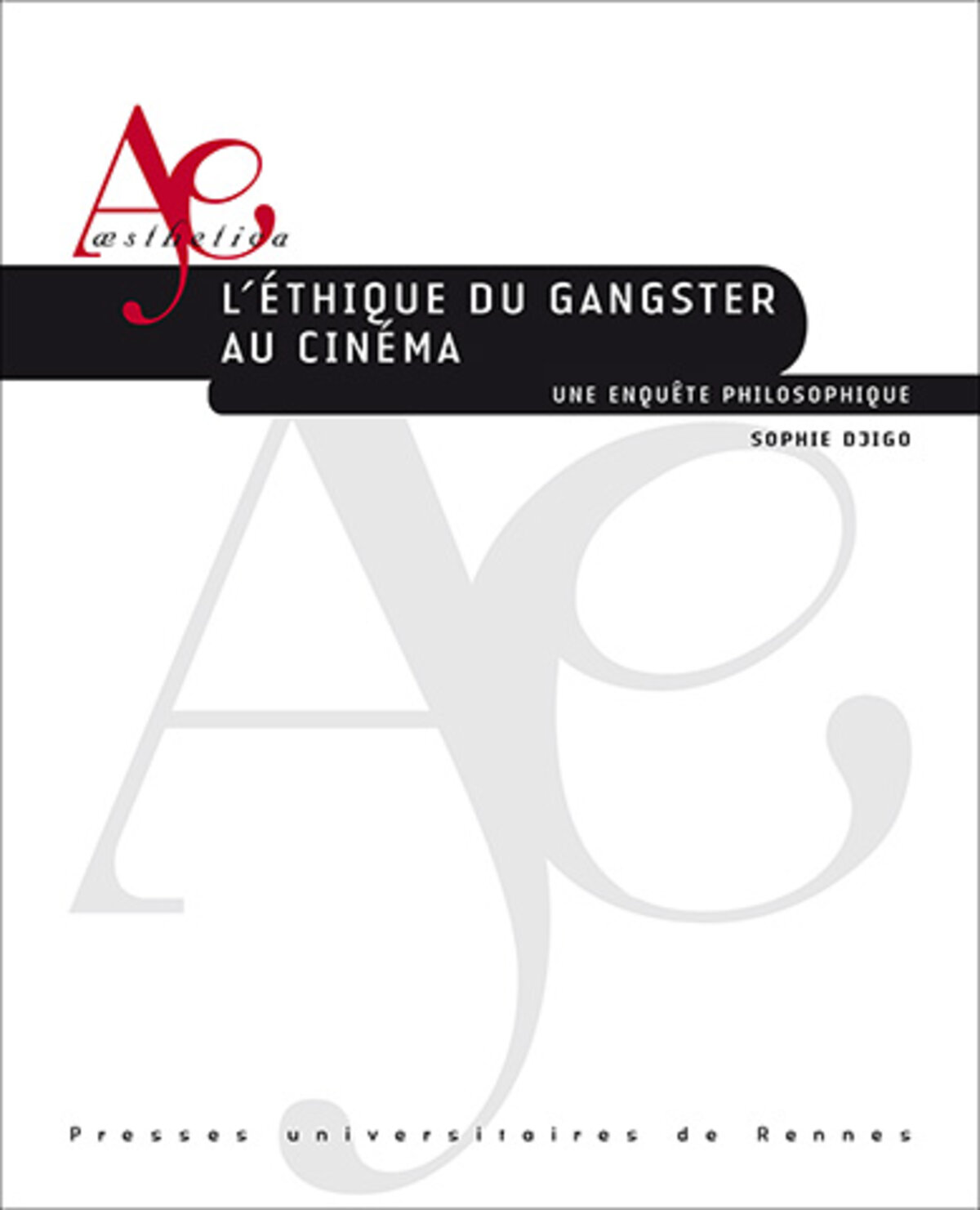
L'Éthique du gangster au cinéma. Une enquête philosophique
de Sophie Djigo
Nombre de pages : 184
Date de sortie (France) : 16 juin 2016
Éditeur : PUR (Presses Universitaires de Rennes)
Collection : Æsthetica



