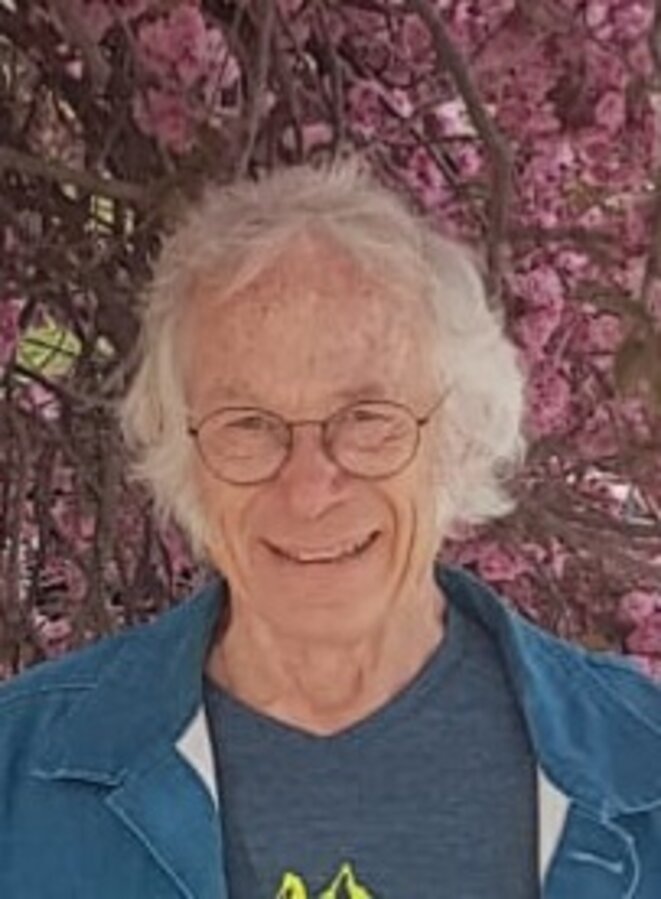Je reproduis ici l'article "Une inclusion de qualité, notre positionnement syndicaliste pour réhumaniser le monde" paru sur le site de la CGT Educ'action 95 le 14 juillet 2025. Les injonctions hiérarchiques d'implantation d'une ULIS Troubles de la Sphère Autistique dans une école du Val d'Oise ont accéléré une prise de conscience des enjeux démocratiques et de développement humain autour de l'inclusion scolaire.
J'ai rédigé la seconde partie sur le "contenu qualitatif de l'inclusion". Cette écriture m'a permis de faire un point d'étape dans ma réflexion sur le développement de l'enfant et son inscription dans une perspective Politique.
Nous avons obtenu que la direction des services départementaux de l'Education Nationale reporte d'un an l'ouverture de l'ULIS. Le travail de préparation commence donc ! Nous sommes à la recherche de partenaires dans cette construction !
Notre positionnement syndicaliste sur une inclusion de qualité pour réhumaniser le monde.
Pourquoi avons-nous lutté pour obtenir le report de l’implantation d’une ULIS TSA à l’école Paul Cézanne de Pontoise ?
Après avoir, fin février, annoncé sans aucune consultation préalable l’ouverture d’une ULIS-TSA à l’école Paul Cézanne, puis le 1er avril, annulé sa décision d’ouverture dans cette école disant tenir compte des alertes de l’équipe et de la demande unanime de l’intersyndicale, le DASEN du 95 est revenu brutalement sur sa décision le 5 mai et en a décrété l’ouverture pour la rentrée prochaine. Il s’ensuivit une grève totale de l’école le 3 juin, des ateliers de mobilisation et d’expression sur l’inclusion scolaire avec la participation d’une soixantaine de parents, enfants et acteurs de l’éducation AESH et enseignant·es, une manifestation sonore dans la ville et des délégations reçues par la mairie et le DASEN. En conséquence, le 12 juin, le DASEN faisait annoncer par ses IEN dans l’école qu’il reportait l’ouverture de l’ULIS d’un an.
En dehors du quartier des Cordeliers, sur les réseaux sociaux, beaucoup d’incompréhension s’est exprimée sur la nature de cette lutte. S’agissait-il d’un refus assumé de l’inclusion en milieu ordinaire ? Evidemment non.
Comment comprendre ce qui s’est passé ? quelles leçons pouvons-nous en tirer ? Maintenant, comment avançons-nous ?
Sommaire
- Que l’on parte de la question du sens et de l’organisation du travail, ou de celle d’une conception optimiste de l’enfance et du peuple scolaire, c’est bien la démocratie qui devient centrale dans cette affaire.
- Le second enjeu démocratique porte sur le contenu qualitatif de l’inclusion.
- Leçons de la lutte
- Et maintenant ?
- Références bibliographiques citées
Que l’on parte de la question du sens et de l’organisation du travail, ou de celle d’une conception optimiste de l’enfance et du peuple scolaire, c’est bien la démocratie qui devient centrale dans cette affaire.
Force est de constater avant tout, par le prisme de cette lutte, la puissance d’un tabou, dont les termes sont installés et entretenus efficacement par l’institution scolaire et sa chaîne hiérarchique. Ce tabou s’impose de fait dans toutes les écoles sur tous les aspects du sens du travail éducatif. On pourrait le résumer par un « Silence dans les rangs, l’institution pense pour votre bien, contentez-vous d’exécuter ses injonctions et ses recettes ! ». Or, elles ont toutes en commun de considérer chaque partie de la constellation éducative – enfants, familles, enseignant·es et AESH – comme des vides à remplir.
Pour chacune de ces parties, ce tabou subi est une clé de voûte de l’empêchement du travail vivant, déployé afin de maximiser le travail subordonné, sous contrôle doctrinaire hiérarchique. Il n’a pas de légitimité en soi, il matérialise la dérive autoritaire et réactionnaire d’un ministère néolibéral. Appliqué au domaine de l’inclusion, ce tabou déploie toute sa violence institutionnelle sur un ressort managérial utilisé à plein régime, celui de la culpabilisation morale autour d’une polarisation rhétorique artificielle qui n’admet aucune nuance, aucune contradiction : soit vous adhérez à la version ministérielle de l’inclusion, soit vous êtes contre l’inclusion elle-même, et donc contre les enfants en situation de handicap. L’expression des familles et des professionnel·les est muselée, réduits qu’ils sont à absorber une doxa absurde, dans un silence pesant.
Dans un tel contexte, seule la question – bien légitime évidemment – de la pénurie flagrante des moyens humains (soignant·es, AESH, enseignant·es spécialisé·es) parvient à émerger lors des quelques luttes qui ont éclaté ici et là sur la question de l’inclusion. Il est évident que l’aggravation de la logique austéritaire appliquée à l’acte II de l’inclusion dégrade brutalement le climat scolaire des écoles (en témoigne l’inflation de fiches SST). Pénurie et empêchement du travail vivant nourrissent et individualisent alors un sentiment de plus en plus perceptible d’échec et de rejet de l’inclusion en milieu ordinaire. Ce serait au mieux à d’autres de s’en occuper exclusivement, mais en milieu spécialisé (IME…)
Il y a évidemment, de notre point de vue, urgence à repenser l’articulation entre milieu ordinaire, milieu spécialisé et soins (lieux et nature des soins pour reconstruire les CMPP par exemple en redonnant une place à la psychothérapie, ou amener psychologues et psychomotriciens dans l’école au quotidien). Mais on ne saurait pour autant résoudre les problèmes de l’inclusion à cette seule approche quantitative liée aux moyens, que cette approche soit séparatiste ou non, à moins de ne pas penser la société future.
Pour ce qui concerne l’organisation du travail, durant ces 4 mois de lutte à l’école Cézanne, jamais la communauté éducative (familles, professionnel·les, mairie) n’a été associée à la moindre réflexion, à la moindre discussion pour définir un projet d’inclusion. Pour la hiérarchie managériale, le label administratif « ULIS-TSA » semble donc se suffire à lui-même, tel un totem du tabou. On confond alors des termes clés, « formation » avec information, « accompagnement des équipes », avec endoctrinement et surveillance.
Penser l’inclusion ne serait donc du ressort ni des AESH, ni des enseignant·es, et surtout pas des familles. Quant aux enfants, ils n’auraient pas leur mot à dire. L’ARS et la Haute Autorité de Santé fixent le cadre doctrinaire et budgétaire, la MDPH notifie, et l’inspection ASH de la DSDEN s’occupe d’appliquer le tout. La course à l’inflation de dispositifs (Ulis, DAP-PMS, etc.) et de démarches administratives est alors présentée comme manifestant les «’indicateurs » du sérieux des managers dans leur préoccupation du handicap et de l’inclusion. La rigueur de leurs tableaux excel donne alors des éléments de langage imparables pour une communication d’affichage efficace : oui, grâce à eux, l’Éducation nationale peut s’enorgueillir de pratiquer une véritable inclusion. Les esprits chagrins qui en doutent sont donc des réfractaires à la cause du handicap, des réactionnaires ! Il suffit de consulter les commentaires à l’emporte-pièce sur les réseaux sociaux et les médias locaux en écho à cette grève pour s’en convaincre. (Comment ?! Cette école ose une grève pour refuser un dispositif ULIS ?! Quelle honte !) Que la démarche psychothérapeutique soit tabouisée par le ministère de la Santé, au profit du tout diagnostic, et d’un comportementalisme de contention passe alors sous les radars de la critique.
Ces éléments sont bien constitutifs d’une maltraitance institutionnelle généralisée, puisque cette organisation très autoritaire et injonctive du travail n’offre aucun interstice de discussion et d’élaboration, ni aux familles, ni aux soignant∙es, ni aux professionnel·les de l’Éducation. Il en résulte un morcellement extrême qui « objéifie » et isole chaque élément de cette constellation, l’enfant, sa famille, l’éducateur∙trice (enseignant·e ou AESH) et dresse des murailles invisibles. La souffrance au travail de toute cette communauté éducative s’amplifie.
Le mode d’organisation du travail revendiqué et porté par notre syndicat doit conduire au contraire à la reconquête du travail vivant et à son développement maximal. C’est d’autant plus urgent et fondamental sur la question de l’inclusion. Ce qu’ont porté sans faillir cette école et ce quartier se résume en une phrase : l’inclusion, oui, mais de qualité et sous contrôle collectif des familles, des enfants et des professionnel·les ! C’est cela le premier enjeu de démocratie par l’école.
Le second enjeu démocratique porte sur le contenu qualitatif de l’inclusion.
Si, dès le départ, nous nous sommes positionné∙es sur le fond : oui à l’inclusion, mais une inclusion de qualité, il reste encore à la définir !
La qualité repose sur un regard pointu, actuel et révolutionnaire sur le développement de l’enfant.
Révolutionnaire n’est pas un terme galvaudé, et ce, à deux titres.
En premier lieu, parce que guetter, valoriser, répondre aux manifestations même les plus infimes des initiatives, des apports des enfants dès la naissance tout en leur offrant un cadre qui les mette en sécurité affective et matérielle, forment des jeunes qui ont du désir (Laznik, 2025). Quel que soit leur bagage initial, à condition que leurs questions et leur vision du monde aient été écoutées, ils peuvent être sûrs d’eux-mêmes et apaisés, confiants dans leur entourage et coopératifs, émancipés et révolutionnaires. Garder leur esprit d’enfant justicier et questionneur ! Il est essentiel que l’éducateur ait en permanence cette vision de l’enfant, pour lui permettre d’advenir. Ce qui ne veut pas dire que l’enfant en sera capable tout de suite.
Cette vision de l’enfant menant en synergie son développement affectif et intellectuel est corroborée depuis la fin du 20ème siècle par les avancées de la neurologie qui ont montré qu’aucune zone du cerveau ne fonctionne indépendamment. Certains neurologues dits connexionnistes (T. de Schotten, 2022) vont même dans le sens où les réseaux de neurones sont au moins aussi importants que les unités qui les composent, le cerveau fonctionnant comme un tout (n’en déplaise à Stanislas Dehaene et ses neurones de la lecture, et à l’obsession neuroscientiste du ministère néolibéral).
Nous nous situons ainsi dans la perspective de celles et ceux qui, restant scientifiques dans la tradition de la discussion, ayant le courage du doute, suggèrent que l’enfant, dès son plus jeune âge, apprendrait non en étant rempli par ses canaux sensoriels, tel un entonnoir, mais parce que « le cerveau interagit, en fonction de ses motivations, avec le monde par ses actes. » (A Berthoz, Y Coello 2024). L’enfant va chercher, expérimente le monde.
En second lieu, révolutionnaire évidemment aussi parce que cette vision du développement de l’enfant est occultée par tout le discours lobbyiste qui a intérêt à vendre de la connaissance (industries de l’Intelligence Artificielle, de l’édition des manuels…) et non à investir dans l’humain nécessaire pour faire advenir des sujets et non des objets à remplir. Car un sujet pense, agit pour faire société, et peut exercer par exemple une démocratie directe sur le sens et la finalité du travail (Cf Brochure de la CGT Educ’action 95 – Sens du travail et pédagogie critique, 2024).
Ensuite, nous avons démontré que ces belles idées étaient travaillées dans les classes de cette école. C’est là que la double besogne a montré son efficacité ! Penser l’action d’ici et maintenant en fonction de ce que nous voulons pour demain et partout est un réflexe naturel pour tou∙tes les professionnel∙les de l’éducation cohérent∙es ! La double besogne conçue par le syndicalisme révolutionnaire en 1906 (Charte d’Amiens), puis particulièrement par le syndicalisme CGT des instituteurs·trices (École Emancipée, Comités Syndicalistes-Révolutionnaires (CSR) de l’Éducation) situe ce choix permanent dans la perspective du changement de société. Et nous voulons d’une société réellement inclusive !
À l’école Cézanne, l’une des enseignantes déléguées par ses collègues a partagé son savoir d’expérience acquis avec les enfants réputés autistes. Elle a détaillé son approche de la lecture basée sur la compréhension du monde de l’écrit par un enfant particulier et non sur l’application de normes didactiques. Chacun a pu mesurer le temps, la disponibilité et la charge mentale nécessaires pour détecter « sans préjugé »…« le niveau d’intelligence cachée d’un enfant » (Georgief, 2017).
Humainement, un tel travail n’est possible qu’avec un nombre restreint d’élèves. De plus, dans cette école, les enfants à besoins particuliers, familles vivant dans des conditions de vie précaires, enfants nouvellement arrivés en France, enfants placés dans un foyer de l’ASE s’ajoutent aux 9 enfants diagnostiqués autistes hors dispositif déjà prévus pour l’année prochaine. Accueillir en plus dix enfants réputés autistes en ULIS rend évident qu’un tel travail de broderie fine ne sera plus possible, sans compter la souffrance au travail induite. Souffrance de bien de nos collègues. Car c’est bien cette souffrance au travail qui s’est généralisée, du fait de ne pas garantir aux équipes, aux familles, aux enfants, ce cadre de travail.
Garder l’optimisme envers les enfants et la structure ULIS suppose un vrai accompagnement des adultes, vécu comme un compagnonnage entre pairs qui permette de décoller des problèmes, d’échanger en profondeur les points de vue sur les élèves et d’approcher de leur logique pour envisager des actes qui les remettent en développement.
Tous ces points ont été présentés le 3 juin lors de la réunion avec le DASEN.
Un point de bascule du bras de fer a été la prise de conscience par la mairie et par les parents d’élèves de la volonté de l’inspection de mettre dans d’autres écoles 5 enfants réputés autistes déjà présents à P. Cézanne mais hors secteur et hors dispositif, voire de faire basculer arbitrairement des diagnostics ou des notifications, afin de présenter des chiffres plus convenables. Aussitôt, la position des enseignant·es a été très claire : il est hors de question que ces enfants soient exclus de leur école. Ils en font partie au même titre que les autres. Expulser des enfants dont le premier besoin est de croire dans les liens humains, ce qui pour eux est particulièrement difficile, est un risque majeur de régression, leur réaction pouvant être de mettre ce monde à distance comme trop dangereux.
La gravité de cette tentative d’exclusion par la DSDEN pour des enfants aux liens si fragiles a provoqué la prise de position de la mairie : nous accepterons, dit-elle, les dérogations nécessaires pour que ces enfants puissent rester dans leur école, et nous soutenons votre demande de report d’une année de l’ouverture de l’ULIS pour la préparer activement.
Sans doute, y a-t-il eu aussi une intervention du recteur de Versailles interpelé par notre Union Académique CGT et par la maire, et agacé par les vagues de son sous-chef…
Leçons de la lutte
La vision de l’« Enfant » respecté dans son existence de sujet, dans sa fragilité, dans ses liens, dans la reconnaissance de l’universalité de sa condition au-delà des « réputations », cette vision s’est révélée profondément fédératrice des aspirations des parents d’élèves. À la faveur notamment de la réunion publique d’information du 16 mai, leur sentiment diffus du bien-être de leurs enfants fréquentant l’école s’est transformé en adhésion dans un projet porté par celle-ci. Les familles vivant dans des conditions précaires n’en ont que davantage la conscience de ce qu’il faut pour leur enfant. À nous de leur préparer l’espace médiatique pour qu’elles s’expriment, de leur réserver un espace collectif dans l’école pour l’organiser.
Les parents ont vécu en direct le management des inspections. Ils en ont tiré leurs conclusions à partir de l’intérêt de leurs enfants. Ils ont pris position en faveur d’une école émancipée.
Cette recherche de la logique de l’enfant pour qu’il trouve son élan de vie est le sens même du travail des professionnels de l’école (Lévine 2009, Mellier 2018). Elle est profondément fédératrice pour les actrices et acteurs de l’éducation.
La recherche des enseignant·es au plus près de l’enfant semble s’approcher des recherches médicales actuelles sur l’autisme, notamment celles qui ne le définissent plus par rapport au fonctionnement normal, que ce soit par défaut ou par excès, mais le voient comme une différence à découvrir. Ce qui les amène à faire comme avec les autres enfants, mais encore mieux.
L’action ne doit pas se focaliser sur une théorie mais laisser libres les acteurs avec le sujet complexe qu’est l’enfant.
L’action éducative réfléchie est irréfutable par les inspections, parce qu’elle part de l’enfant vrai et des savoirs nés de l’action, a contrario d’un enfant théorique et de la doctrine médico-scolaire dominante en matière d’autisme (P. Delion, 2022).
Principes d’action (intangibles):
- Faire cause commune autour des enfants, de leurs intérêts, sur le chemin d’émancipation dont l’adulte doit être le garant.
- Abattre les cloisons du morcellement construites par d’autres qui considèrent l’enfant comme un être à soumettre.
- Ne pas faire un pas sans cadre et décision collective démocratique
- Considérer chacun·e comme un·e intervenant·e légitime. La hiérarchie pourrait avoir pour rôle de tenir cette éthique et de garantir ces principes d’action.
Et maintenant ?
C’est aux professionnel·les de cette école, aux parents de décider de la suite. Nous pouvons seulement donner quelques pistes :
- Donner de la force aux savoirs nés de l’action des professionnel·les et des parents. Les répertorier, les classer, les échanger entre pairs.
- Les travailler avec le SESSAD John Bost, École et famille, l’AGSAS…
- Obtenir une salle d’apaisement, de calme, sorte de sas pour les enfants, les professionnel·les, animée par un·e psychologue clinicien·ne présent·e à temps plein.
- En penser son équipement, son environnement compte-tenu des besoins particuliers, de sensibilités particulières.
- Constituer et maintenir un collectif de travail (enseignants, AESH, psychologues, psychomotriciennes…) où, sans rechercher qui a raison ou qui a le pouvoir, ses membres tentent d’articuler les points de vue différents autour de l’enfant dans le but de lui assurer une sécurité telle qu’il puisse développer sa vie affective et intellectuelle (Delion, 2024, O Rey, 2019). Dégager de l’action les valeurs éducatives partagées.
La formation n’est pas une liste de bonnes conduites des acteurs de l’éducation. La formation passe par un long état des lieux interactif des connaissances des acteurs, puis par leur formation à l’observation des initiatives de l’enfant, et aux connaissances pluridisciplinaires sur l’autisme et l’éducation. Elle doit être centrée sur le développement psycho-affectif d’un enfant et présenter l’autisme par une approche plurielle – pédopsychiatrie et psychanalyse / fondements des psychothérapies, échos des parcours de vie pour dépasser le cadre du diagnostic et de la contention comportementaliste (symptômes/diagnostics/contentions et pharmacologie).
- Obtenir que les cadres hiérarchiques tiennent compte des réseaux d’enseignants existants (O Rey, ib).
- Obtenir des temps d’accompagnement, de compagnonnage entre pairs sur le temps de travail qui permettent de décoller des problèmes, d’échanger en profondeur les points de vue sur les élèves et d’approcher de leur logique pour envisager des actes qui les remettent en développement.
Références bibliographiques citées
– Bébés fragiles et risques en cascade, comment soigner ?, Laznik, Érès, 2025
– Dans le cerveau, ce sont les connexions qui commandent !, T de Schotten, journal du CNRS 2022
– Corps, cerveau et processus mentaux, A Berthoz préf, Y Coello dir, Dunod, 2024.
– Les paradoxes de l’autisme, Nicolas Georgief, Perspectives Psy, Volume 56, N o 4, octobre-décembre 2017, p. 308-319.
– Prévenir les souffrances d’école, J Lévine, J Moll, ESF, 2009.
– La vie psychique des équipes, D Mellier, Dunod, 2018.
– La constellation transférentielle, P Delion, Érès, 2024
– Pilote et pilotage dans l’éducation, O Rey, Édupass, IFÉ, 2019
– La politique de l’autisme en France ou le retour de tragique de la ligne Jdanov, art. Pierre Delion, 2022