Sophia Rosenfeld fait partie d’une nouvelle génération d’historiens aux Etats-Unis. Son dernier livre, paru en France au début de l’année, est intitulé Le Sens commun. Histoire d’une idée politique. Elle y montre que le sens commun, si cher à Hannah Arendt, est, depuis le 18e siècle, un des fondements de la démocratie mais aussi l’une des armes utilisées pour contester et limiter celle-ci. Devenu, depuis une trentaine d’années, le quasi-monopole de la droite réactionnaire, aux Etats-Unis comme en France, le sens commun peut redevenir, plaide Sophia Rosenfeld, une idée progressiste et émancipatrice ; au prix d’une redéfinition des institutions et des finalités de la démocratie moderne, qu’il appartient à la gauche d’assumer.
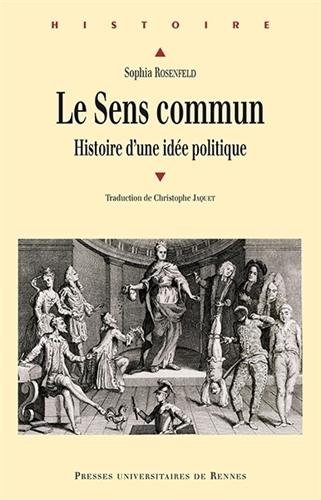
Sophia Rosenfeld, vous montrez dans votre livre que l’idée de « sens commun » joue, depuis plus de deux siècles, dans le monde occidental, un rôle politique central. Pourriez-vous donner une définition politique du sens commun.
Je dirais que le sens commun suppose une croyance dans l’autorité ou dans la justesse du jugement ordinaire des gens ordinaires, notamment sur les problèmes auxquels est confrontée la société dans son ensemble. Il convient d’ajouter qu’une définition politique du sens commun nécessite l’acceptation d’un certain nombre d’hypothèses ou présupposés quant à la capacité intellectuelle des gens ordinaires et la nature de la politique ; et que ces présupposés, s’ils ont des racines profondes dans la pensée européenne, ne sont apparus qu’à « l’âge des révolutions ».
Et en quoi consiste ce rôle ?
Le sens commun joue en effet, depuis le 18esiècle, un grand rôle dans l’imaginaire politique de ce qu’on appelle l’Occident. A l’origine, l’idée que le peuple possédât une sorte de sagesse collective a été essentielle pour l’invention et la légitimation de la politique démocratique moderne, même si la question de savoir qui incarnait précisément le sens commun et ce qu’il représentait a toujours été controversée. Aujourd’hui encore, cela fait partie de la mythologie de la démocratie, de la politique « par et pour le peuple » : le sens commun est une autorité alternative à celle des monarques, des religieux, des textes sacrés ou des élites. Mais l’idée de sens commun constitue aussi une menace pour les démocraties, et surtout pour les démocraties représentatives et leurs institutions, une fois que celles-ci sont établies, en particulier parce que ce que nous appelons la démocratie moderne, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, prend aussi la forme d’un régime constitutionnaliste et technocratique qui paraît souvent hostile au sens commun. Pour le dire autrement, le sens commun nourrit le populisme, au sens positif comme au sens négatif du terme.
Avant de dire que le sens commun alimente le populisme, peut-être faut-il rappeler qu’il est aux racines de l’ordre démocratique, par opposition à l’ordre monarchique/théocratique/traditionnel. Et qu’il révèle que l’ordre démocratique est fondamentalement basé sur les contradictions entre les idéaux qu’il porte et les institutions sur lesquels il est bâti ?
Le populisme apparaît – et l’Union européenne en offre un bon exemple aujourd’hui – quand le peuple (ou, plus souvent, un représentant charismatique du peuple) découvre le fossé séparant, disons, l’idée de la démocratie et les institutions et pratiques sur lesquelles celle-ci est bâtie. C’est alors, aussi, que le sens commun devient une idée politique.
Toutes les caractéristiques du populisme – à savoir 1. que « le peuple » possède une sorte de savoir intuitif propre né de l’expérience ordinaire et quotidienne de la vie ; 2. que les question politiques, dans la mesure où elles portent sur le monde réel, peuvent être susceptibles d’être comprises par ce que l’on peut appeler la pensée de comptoir ou de café du commerce ; 3. que si l’on se débarrasse des « experts », des technocrates et des politiciens professionnels, et qu’on donne au peuple la réelle possibilité de diriger les affaires, les conflits politiques prendront fin et les problèmes de gouvernance trouveront des solutions consensuelles et pragmatiques – reposent sur une foi préexistante dans quelque chose appelé le « sens commun » ou le « bon sens », qui serait un guide fiable vers ce qui est bien et vrai. On peut ainsi dire que le sens commun, si l’on n’en discute que rarement, est un concept central de la politique moderne.
En Angleterre ou aux Etats-Unis, on parle généralement de « sens commun » (common sense) ; en France, l’expression consacrée est plutôt le « bon sens ». S’agit-il de deux concepts différents, ou sont-ils, du point de vue politique, identiques ?
Il y a certaines différences entre le bon sens et le sens commun, mais elles sont subtiles. Il est tout à fait vrai que le bon sens, ou « good sense », est bien moins fréquent dans le discours politique anglo-américain que dans le discours politique français. La différence me semble porter sur la dimension collective (au double sens de partagé et de populaire) propre au « sens commun » ; le « bon sens » est une notion plus individualiste voire plus élitiste, au sens où il est supposé ne pas être partagé par tous. Cela étant dit, c’est à l’époque de la Révolution française que le « bon sens » et même le « gros bon sens », comme on le disait à l’époque, sont apparus, en France, dans la rhétorique politique. Et je remarque que ces deux notions sont encore d’une forte efficacité dans la politique française aujourd’hui, en particulier à droite (j’y reviendrai plus loin), qu’il s’agisse de la « force du bon sens » de Marine Le Pen (le slogan officiel du Front national aux dernières municipales) ou du mouvement Sens Commun, qui, au sein de l’UMP, entend incarner une « droite » à la fois « sociale, populaire, humaniste » et, bien sûr, « judéo-chrétienne ».
L’ouvrage politique le plus célèbre sur ce sujet est le fameux pamphlet de Thomas Paine de 1776, Le Sens commun, qui prône l’indépendance des Etats-Unis d’avec la Grande-Bretagne colonisatrice. A l’époque, le « sens commun » avait donc un sens émancipateur, voire révolutionnaire. L’a-t-il encore aujourd’hui ?
A mon avis, l’idée de sens commun a joué un rôle fondamental – dans les colonies britanniques à l’origine des Etats-Unis en 1776 et au début de la Révolution française en 1789 – dans la légitimation de l’autorité du « peuple collectif » par opposition à celle du roi ou d’autres instances (la religion, la tradition, etc.), et dans la détermination de ce qui est bien, vrai et sage. A l’époque, c’était une idée révolutionnaire, qui fut cruciale pour l’apparition sur la scène politique des idées et idéaux démocratiques. Des féministes révolutionnaires du 18esiècle aux socialistes du siècle dernier, le sens commun a également fourni un espace conceptuel et rhétorique à partir duquel de nouvelles voix, y compris des voix généralement exclues de la sphère plus exclusive de la raison, ont eu le droit et la capacité de s’exprimer en leur nom et au nom de leurs congénères.
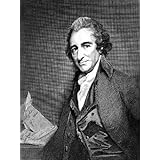
Alors, oui, à partir de Thomas Paine, le sens commun a été doté d’un fort potentiel émancipateur (Paine lui-même, à la fois révolutionnaire et anticlérical, a longtemps été le saint patron de la gauche aux Etats-Unis). Mais il est difficile de dire que c’est encore le cas aujourd’hui, malgré les efforts de groupes comme Occupy Wall Street pour le remettre au cœur de la vie politique. Ces trente dernières années (c’est-à-dire, en gros, dans le contexte états-unien, depuis Ronald Reagan), la rhétorique du bon sens ou du sens commun est largement devenue l’apanage de la droite.
Pendant la Révolution française, vous montrez que les réactionnaires se réclamaient du « bon sens » du peuple pour justifier le retour à l’Ancien régime, et que les révolutionnaires invoquaient le « sens commun » pour légitimer la disparition de la monarchie. Y aurait-il un « bon sens » de droite et un « sens commun » de gauche ?
Je ne crois que la distinction entre un bon sens de droite et un sens commun de gauche soit aussi simple que cela. Après tout, les origines de l’usage du bon sens à des fins politiques remontent à Descartes et au baron d’Holbach, qui n’étaient pas particulièrement des réactionnaires. Mais il est vrai aussi qu’une droite populiste s’est constituée à partir de 1790 en France autour de l’idée d’un bon sens traditionnel, incarné en particulier dans la figure de la mère paysanne et catholique (la fameuse « Mère Duchesne »), pour faire contrepoids à la pseudo-logique abstraite irréaliste et parfois jargonneuse d’un Robespierre !
Lors des dernières élections municipales en France (mars 2014), le Front national avait pour slogan : « La force du bon sens. » Cela veut-il dire que le « bon sens » serait désormais de droite ou d’extrême droite ?
Dans la mesure où le populisme, en Europe et aussi aux Etats-Unis, est largement devenu, depuis quelques dizaines d’années, un phénomène de droite, le « bon sens » semble en effet se rattacher presque exclusivement à la famille conservatrice et réactionnaire. L’appropriation récente du terme par le Front national est particulièrement habile, car elle fait écho à plusieurs thèmes populistes que le FN espère voir triompher dans l’opinion et dans les médias : notamment, qu’il n’est pas un parti de droite ou de gauche ; qu’il ne fait que représenter le véritable peuple français, les « vrais gens » honnêtes et travailleurs (c’était aussi la rhétorique de Nicolas Sarkozy, et cela reste celle d’une large partie de l’UMP) ; qu’il est la cible permanente des idées destructrices et folles des intellectuels, des technocrates, des élites, des politiciens de carrière, des étrangers et des marginaux de tout poil (notamment des musulmans), qui domineraient aujourd’hui l’espace politique au détriment du « vrai peuple de France » et qui seraient la cause de la crise nationale que vit le pays.
Le FN veut ainsi faire croire qu’on ne pourra résoudre la crise que par l’introduction ou la restauration en politique du bon sens du véritable « peuple français ». On le voit, et on l’a déjà vu par le passé, l’évocation du bon sens par un parti politique aux dépens des autres est souvent de la démagogie. Et même sous une forme plus bénigne, elle tend à donner des solutions très simplistes à des problèmes complexes, du type : « Si le gouvernement est à court d’argent, il n’a qu’à ne pas en dépenser » ou « Tout emploi occupé par un étranger prive de travail un ‘‘vrai’’ Français, donc il faut expulser les étrangers ».

D’un autre côté, personne ne veut que la démocratie soit synonyme de technocratie ou d’oligarchie managériale. Le défi auquel la gauche doit faire face est donc de trouver un moyen de reconstruire un lien avec le « peuple » et de proposer une vision qui s’inspire du sens commun de celui-ci. Cela peut sans doute se faire autour des questions de justice, de solidarité et d’égalité ; la gauche doit aussi prendre au sérieux la question de la participation des gens ordinaires à la prise de décision politique, et réfléchir à la manière d’élargir l’action citoyenne au-delà du seul exercice du vote. Ce n’est pas impossible ; comme j’espère le montrer dans mon livre, par le passé, le bon sens ou le sens commun peut appartenir et a appartenu à la fois à la gauche et à la droite. Mais cela ne sera pas facile dans le climat actuel.
L’adoption du mariage homosexuel a réveillé en France une droite réactionnaire qu’on croyait d’un autre temps. Celle-ci s’est réclamée, dans ses diverses actions pour contester l’égalité des droits des homosexuels et des hétérosexuels, de la « France du bon sens ». Que vous inspire ce type de slogan ?
Le bon sens, généralement, est une idée qui ne fait pas peur : elle est et se veut même rassurante. Qui, après tout, peut se dire opposé au bon sens ? Etre du côté du bon sens, c’est, tout simplement, montrer qu’on est « sensé ». L’expression « bon sens » suggère ainsi l’opposé de ce qui est politique, au sens partisan du mot. Les adversaires du mariage homosexuel, avec leur rhétorique du bon sens ou du sens commun, entendent affirmer qu’ils ne représentent pas un camp dans un combat idéologique (alors que c’est évidemment le cas), mais qu’ils ne font que représenter la position normative du peuple français contre une position qui serait irrationnelle ou révolutionnaire (ce qui n’est bien sûr plus le cas, l’opinion publique ayant grandement évolué dans une grande partie du monde depuis au moins deux décennies). Cette posture remonte cependant à une longue tradition politique, et à une tradition philosophique et rhétorique encore plus ancienne.

Vous montrez enfin que le sens commun a été, pour Hannah Arendt, une des pierres angulaires de sa réflexion sur les origines de la démocratie et sur son avenir. Hannah Arendt était-elle optimiste sur ce sujet ? Et sa pensée offre-t-elle des moyens de lutter contre le populisme autoritaire (pour reprendre un terme de Stuart Hall) qui tend à dominer le climat politique français depuis une dizaine d’années ?
Je ne suis pas sûre que Hannah Arendt nous propose beaucoup de solutions politiques concrètes. Elle était par ailleurs plutôt pessimiste sur l’avenir de la vie politique, ce qui n’a rien d’étonnant compte tenu de son expérience du totalitarisme européen, mais aussi de la déception qui fut la sienne quant à la nature de la démocratie pratique aux Etats-Unis après la Seconde Guerre mondiale, où elle vécut jusqu’à sa mort. Ses idées sont cependant suffisamment originales et inhabituelles pour qu’elle nous amène à réfléchir sur des choses qui sont trop souvent considérées comme allant de soi, comme, par exemple, la valeur du sens commun. Arendt nous rappelle notamment, pour la fondation d’une « véritable » démocratie, qu’il est important qu’existent une base ou un terrain commun, ou encore des idées et des représentations partagées. Elle suggère que le sens commun est également un des principaux produits de ce que peut et doit être une démocratie participative, dans laquelle la discussion et le débat entre citoyens sont tout aussi importants dans la vie politique que la pratique du vote. En d’autres termes, elle ne croit pas que le sens commun soit nécessairement réactionnaire ou conservateur : pour elle, le sens commun était « le sens politique par excellence ». On peut espérer qu’à la suite d’Arendt, d’autres figures soient à même d’imaginer un moyen de canaliser le sens commun vers des objectifs progressistes ou, tout au moins, qu’ils n’abandonnent pas entièrement à la droite le domaine de l’épistémologie populaire ou collective.
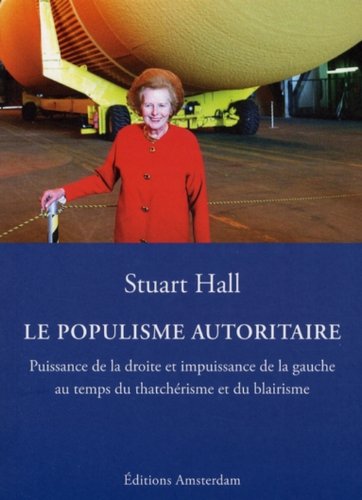
Hannah Arendt, Essai sur la révolution, trad.M. Chrestien, Gallimard, 1967.
Thomas Paine, Le Sens-commun, ouvrage adressé aux Américains, et dans lequel on traite de l’origine et de l’objet du gouvernement, de la Constitution angloise, de la monarchie héréditaire, et de la situation de l’Amérique Septentrionale, Paris, Gueffier, 1791.
Sophia Rosenfeld, Le Sens commun. Histoire d’une idée politique, trad. Ch. Jaquet, Presses universitaires de Rennes, 2014.
Quatrième de couverture :
« Le sens commun a toujours été étroitement impliqué dans la politique démocratique du monde atlantique. En 1776, le pamphlet fondateur de Thomas Paine, qui porte ce titre, fut à l’origine de la révolution américaine. En 1790, la même idée contribua au lancement de la contre-révolution en France. Aujourd’hui, enfin, le sens commun – la sagesse des gens ordinaires, le savoir dont l’évidence dispense même d’en parler – reste un idéal politique puissant. Il n’est cependant pas évident de dire d’où vient notre foi dans le sens commun, et comment sa logique populiste a façonné la démocratie moderne. Le Sens commun. Histoire d’une idée politique est le premier ouvrage qui explore ce phénomène politique essentiel de la modernité.
« L’histoire commence au lendemain de la Glorieuse Révolution, en Angleterre, quand le sens commun devint pour la première fois un idéal politique pour lequel il valait la peine de se battre. L’ouvrage éclairant de Sophia Rosenfeld parcourt deux continents et plusieurs siècles pour nous parler des individus exceptionnels qui se sont approprié cette vieille idée, apparemment universelle, du sens commun et pour révéler les usages stratégiques dont il fut l’objet. Thomas Paine s’est peut-être vanté que le sens commun était toujours du côté du peuple et opposé à l’autorité des rois, mais Sophia Rosenfeld démontre ici qu’il a souvent été utilisé pour encourager autant la souveraineté populaire que la démagogie et l’exclusivité. Elle nous offre un récit inédit des Lumières transatlantiques et de l’ « âge des Révolutions » et nous propose une lecture neuve de ce que le xviiie siècle a légué au ferment politique de notre époque. Bien loin d’aller de soi, l’histoire du sens commun s’avère pleine de paradoxes et de surprises. »
Sophia Rosenfeld est professeure d’histoire à l’Université de Virginie. Elle est aussi l’auteure de A Revolution in Language : The Problem of Signs in late Eighteenth Century France (2001) et de plusieurs articles sur la culture et les idées en Amérique et en France au 18e siècle. Elle travaille actuellement à une histoire des processus de décision comme élément central de la liberté moderne.
Cet ouvrage a reçu le prix Mark Lynton History 2012 de l’Ecole de journalisme de l’Université de Colombia et de la Fondation Nieman de l’Université de Harvard, ainsi que le prix 2011 de The Society of Historians of the Early American Republic.



