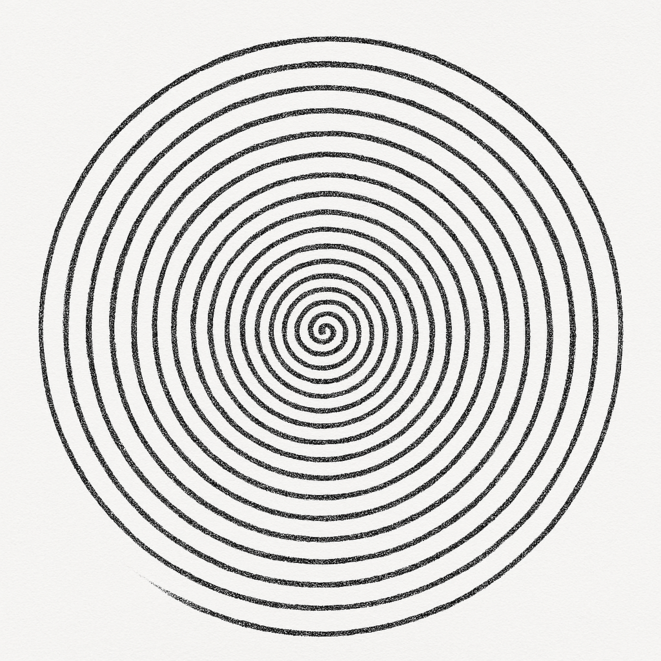I. Quelque chose étouffe le monde.
Pas un évènement, pas un régime politique, pas même une idéologie : une transformation plus profonde, lente, ancienne, qui agit comme une amputation silencieuse du réel. Nous vivons dans des sociétés qui parlent de performance, de transparence, de rationalité, mais ce langage ne décrit plus rien : il remplace, il couvre, il dissout. Une forme d’appauvrissement métaphysique s’est installée : une réduction du monde à ce qui peut être calculé, codifié, évalué.
Le reste — la parole, le conflit, la lenteur, la présence — devient un bruit inutile. Il n’y a pas besoin de chercher loin. Dans les entreprises, les administrations, les services publics, les familles, une même structure réapparaît : la substitution du réel par ses protocoles, du vivant par ses catégories, de l’expérience par sa mesure. Ce n’est pas un complot : c’est un glissement anthropologique. La pensée ne disparaît pas sous la censure : elle s’éteint sous le calcul.
Ce qui a disparu, c’est peut-être la liberté sous sa forme la plus élémentaire : la contingence. Entendons par là que la possibilité même d’être surpris par le réel est devenue insupportable. À force d’organiser le monde en procédures et en données, nous avons arraché à l’existence son caractère d’événement — ces “petits riens” qui viennent troubler, ouvrir, décaler nos quotidiens.
Là où il devrait y avoir de l’incertitude — donc du sens possible — nous avons installé la maîtrise, la prévisibilité, le management. Or, sans possible : disparition du rêve.
Là où il devrait y avoir du commun — donc du conflit fécond — nous avons mis des grilles, des formulaires, des éléments de langage. Or, sans commun : effacement de l’autre dans l’anonymat.
Là où il devrait y avoir une rencontre, un dialogue — donc transformation réciproque — nous avons produit du “contact”, du “lien”, du “feedback”. Or, sans rencontre : solitude.
Ce n’est pas le réel qui s’est appauvri : c’est notre manière de l’habiter qui a été réduite à un squelette opératoire.
II. Les trois amputations silencieuses
1. L’amputation de la contingence : quand plus rien n’arrive
Le premier appauvrissement est invisible, mais total : nous avons perdu la contingence, c’est-à-dire la capacité du réel à surgir, déborder, déjouer nos prévisions. Le monde contemporain est construit pour qu’il n’arrive plus rien. Chaque sphère — travail, famille, administration, éducation — a été recomposée comme un système de maîtrise totale. Tout doit être anticipé, modélisé, sécurisé, optimisé. Même les existences individuelles sont absorbées par des routines, des conduites prescrites, des scripts comportementaux. Et c’est précisément ces prescriptions qui permettent la porosité entre les différentes sphères, nous menant vers une totalisation délétère.
Quand plus rien n’arrive vraiment, plus rien ne se pense vraiment. Parce que la pensée naît de ce qui déraille, de ce qui résiste, de ce qui oblige à réinterpréter, elle prend sa source dans l’imprévu — parce que c’est l’imprévu qui questionne, pas la routine. En supprimant l’imprévu, on supprime la possibilité même du sens.
La contingence n’est pas un luxe existentiel : c’est le moteur de la vie consciente.
2. L’amputation du logos : quand la parole ne relie plus
La deuxième amputation touche le langage dans sa fonction la plus fondamentale : celle de créer un monde entre les individus. Le langage est le médium par lequel le réel se dit. Or, le langage contemporain n’est plus un espace où quelque chose se cherche ; c’est un espace où quelque chose doit être conforme. Nous parlons dans des formats : protocoles, éléments de langage, scripts managériaux, injonctions psychologisantes.
Le logos — la parole vivante — s’étiole :
• elle n’est plus dialogique, elle est transactionnelle ;
• elle n’est plus interrogative, elle est “appropriée” ;
• elle n’est plus risquée, elle est sécurisée ;
• elle n’est plus commune, elle est individualisée.
Ce n’est pas une censure : c’est une aseptisation. Une parole qui ne peut plus déborder n’est plus une parole : c’est une fonction.
Une démocratie — et je me permets de le dire avec toute la gravité que cela implique — ne peut survivre à l’assèchement du logos. Car ce qui reste, alors, ce n’est pas le débat : c’est le décor.
3. L’amputation du monde vécu : quand il n’y a plus que des données
La troisième amputation est la plus sourde : l’effacement du monde vécu au profit du monde mesuré. Ce que nous percevons, ressentons, comprenons, est remplacé peu à peu par ce que nous devons remplir, quantifier, tracer, normaliser.
Le monde vécu — le monde phénoménologique, humain, incalculable — est déclassé au profit du monde procédural.
Ce que nous vivons importe moins que ce qu’il faut inscrire dans un formulaire.
Ce que nous éprouvons importe moins que les cases à cocher.
Ce que nous partageons importe moins que ce qu’il faut “remonter” à nos supérieurs.
Ainsi, la réalité devient secondaire : ce n’est pas elle qu’on écoute, c’est sa traduction administrative ou numérique. Le réel cesse d’être une expérience pour devenir un contenu vidé de sa substance.
On peut tout mesurer — sauf ce qui nous faisait exister.
III. Un monde inhabitable : comment cette triple amputation s’impose
1. Un monde où l’humain devient un risque
Une fois la contingence supprimée, la parole neutralisée et l’expérience remplacée par la mesure, quelque chose se renverse : le vivant devient un problème. L’humain, avec sa lenteur, ses contradictions, ses hésitations, sa vulnérabilité, n’est plus perçu comme la norme, mais comme une défaillance potentielle. Ce n’est pas l’autoritarisme classique, qui impose et sanctionne. C’est un autoritarisme ontologique : tout ce qui échappe au calcul analytique devient suspect en soi. Dans ce cadre, exister autrement que dans les cases prévues n’est plus une liberté : c’est une anomalie.
2. Pourquoi la structure tient : parce qu’elle rassure
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce monde appauvri ne s’impose pas par la force : il s’impose parce qu’il rassure.
La disparition de la contingence est vécue comme une protection.
La disparition du logos est vécue comme un apaisement.
La disparition du vécu est vécue comme une simplification.
Nous vivons dans une époque où l’incertitude est devenue intolérable. Les crises s’enchevêtrent, les repères vacillent, les institutions chancellent, la vérité a plié bagages. Dans ce contexte, tout ce qui promet de réduire l’épaisseur du réel apparaît comme une solution.
On choisit la procédure car elle est plus simple que le conflit.
On choisit le protocole car il est plus clair que le monde.
On choisit l’indicateur car il est plus sûr que l’expérience.
Ainsi, l’appauvrissement du réel devient désirable : il dispense de l’effort d’être au monde.
3. Pourquoi ça rend malades : la vie ne supporte pas d’être “optimisée”
Une vie réduite à ses seules fonctions finit par se retourner contre elle-même. Le vivant réclame de l’opacité, du jeu, du temps, du raté, de l’événement.
Un enfant ne grandit pas dans un protocole.
Un adulte ne respire pas dans un tableau de bord.
Une relation ne se vit pas dans une procédure.
On ne rencontre personne sur un réseau social.
Une pensée ne s’écrit pas dans une grille.
À force de vouloir un monde sans friction, nous avons fabriqué un monde sans épaisseur — et ce monde assèche :
• il assèche l’attention ;
• il assèche le rapport à soi ;
• il assèche la confiance ;
• il assèche la conflictualité féconde, celle qui fait mûrir.
Partout, les mêmes symptômes apparaissent : épuisement, perte de sens, anxiété diffuse, sentiment d’irréalité.
4. Le cœur du problème : un monde amputé ne produit plus de monde
Ce qui est en jeu n’est pas un dysfonctionnement social, mais une mutation anthropologique : nous avons remplacé l’être-au-monde par l’être-dans-des-procédures. Or un être humain n’existe que dans un monde qui résiste, surprend, se laisse interpréter. Sans contingence, sans logos, sans expérience, le réel cesse d’être habitable.
Un monde où tout est calculé est un monde où plus rien n’a lieu.
Un monde où tout est codifié est un monde où plus rien n’est partagé.
Un monde où tout est mesuré est un monde où plus rien n’est vécu.
Ce n’est pas seulement notre liberté qui se réduit : c’est notre capacité d’habiter notre propre monde. Et de l’habiter ensemble.
IV. Comment retrouver un monde — non pas en revenant en arrière, mais en réouvrant le réel
Il n’y a pas de retour possible vers un hypothétique monde “d’avant”. Laissons cela à l’extrême droite : toute nostalgie est un piège, car elle reconduit exactement ce qu’on critique — un passé figé, maîtrisé, fantasmatique. La question n’est pas de réparer ce qui s’est perdu : la question est de réouvrir l’accès au réel. Et pour cela, trois gestes simples — conceptuellement simples, politiquement difficiles — s’imposent.
1. Rendre à la contingence sa dignité
Le réel doit recommencer à advenir. Cela suppose de réhabiliter ce que nos sociétés ont méthodiquement tenté d’effacer :
la surprise, l’imprévu, le conflit, l’événement, la possibilité de dérailler. Ce n’est pas du chaos : c’est la condition du vivant.
Un monde qui refuse l’incertitude refuse la naissance de quoi que ce soit. On ne crée pas dans un protocole ; on n’aime pas dans un formulaire ; on ne pense pas dans un tableau Excel. Réintroduire la contingence, c’est rouvrir l’espace de la liberté — non comme slogan, mais comme phénomène.
2. Rendre au langage sa fonction première : faire monde
Le langage n’est pas un outil de communication, mais une manière d’habiter le réel, de le dire, de le faire advenir dans toute la complexité de sa structure et de ses singularités. Quand les mots sont réduits à des éléments de langage, du management, du performatif, c’est le monde lui-même qui se rétrécit. Réhabiliter le logos, ce n’est pas défendre un discours savant : c’est permettre à la parole vivante de retisser du sens.
Un échange qui ne transforme personne n’est pas un dialogue : c’est un protocole. Une société qui ne produit plus d’interlocution ne produit plus de politique. Une société sans politique est une société morte.
3. Rendre à l’expérience sa valeur originaire
À force de tout vouloir mesurer, nous avons désappris à voir. L’expérience — ce qui se vit avant d’être analysé — est devenue un résidu.
Retrouver un monde suppose de remettre la primauté là où elle n’aurait jamais dû cesser d’être : dans ce qui se vit, pas dans ce qui se comptabilise.
La vérité ne passe pas par l’indicateur. Le réel ne passe pas par la procédure. Ce qui fait monde passe par l’expérience, le regard, la lenteur, le geste, le conflit, la résonance.
4. Pas un programme, mais une respiration retrouvée
Ce texte ne propose pas une politique publique. Il propose une manière de décrire ce qui manque : une respiration.
Ce qui étouffe le monde n’est pas un ennemi : c’est une réduction, une erreur épistémologique. Et c’est cette erreur qui a donné naissance au lieu à partir duquel l'ennemi a pu advenir.
Ce qui redonnera de la profondeur ne sera jamais une réforme, mais un déplacement intérieur : accepter d’être exposé à ce qui advient — parce que cela advient, et parce que cela ne se calcule pas. Retrouver un monde, ce n’est pas corriger nos procédures : c’est consentir à la part du réel qui échappe. C’est dans cet espace — fragile, incertain, indomptable — que quelque chose comme une vie simplement humaine peut reprendre.