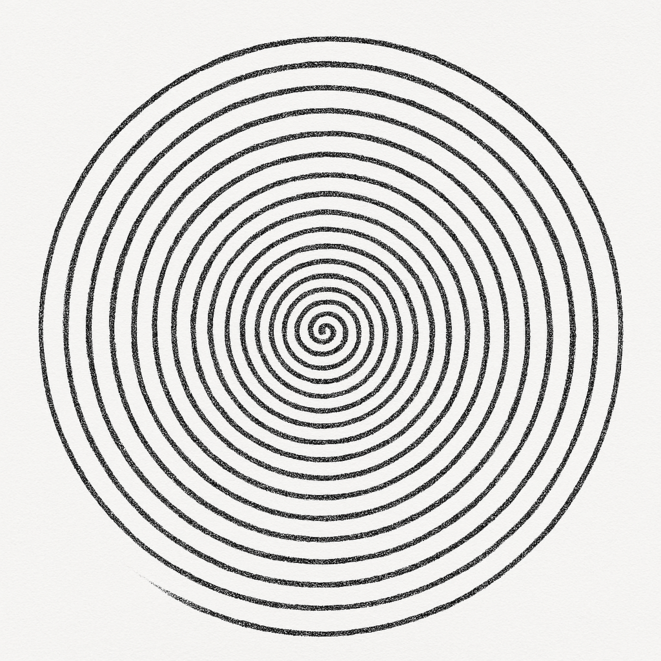Des faits bruts qui défont un ordre fragile
Dans la nuit du 2 au 3 janvier, l’administration américaine franchit un seuil.
Sous couvert de « lutte contre le narcotrafic » et de « sécurité régionale » — des justifications avancées dans le débat public — Washington bombarde le Venezuela, fait capturer le président Nicolás Maduro et son épouse, les transfère sur le sol américain et les fait comparaître devant la justice des États-Unis pour trafic de drogue et possession d’armes automatiques.
Dans le même mouvement, la Maison Blanche adresse un avertissement à la présidence intérimaire vénézuélienne : se soumettre aux exigences de Washington ou subir un sort encore plus radical que celui du président renversé. Le message est limpide : la continuité de l’État vénézuélien ne tient plus ni à sa Constitution ni à son peuple, mais au bon vouloir de l’exécutif américain.
Un pas supplémentaire est franchi lorsque ce même exécutif déclare : « Nous allons diriger le pays jusqu’à ce que nous puissions nous assurer d’une transition sûre, appropriée et avisée », et annonce la prise en main directe des ressources pétrolières du pays. La souveraineté vénézuélienne est traitée comme une variable d’ajustement ; ses hydrocarbures, comme un actif sous gestion.
En parallèle, la même administration relance ses menaces sur le Groenland, territoire déjà convoité par Donald Trump quelques années plus tôt. Après l’échec d’une approche présentée alors comme pseudo-transactionnelle (« acheter » une partie du Danemark), la logique se durcit : la puissance militaire et l’importance stratégique de l’Arctique servent désormais de levier de pression sur un territoire pourtant intégré à un État membre de l’OTAN.
Ces gestes ne sont pas les « dérapages » d’un individu « hors contrôle ». Ils s’inscrivent dans une cohérence : celle d’un pouvoir qui ne se reconnaît plus lié par l’architecture internationale qu’il prétendait incarner – Charte de l’ONU, interdiction de l’usage unilatéral de la force, respect formel de la souveraineté des États, protection des dirigeants en exercice.
La question géopolitique devient secondaire, voire inappropriée (« que veut Washington au Venezuela et au Groenland, quel lien avec la Chine, la Russie, etc. ? ») ; elle est bien plus radicale, bien plus vertigineuse, et devient injonctive : qu’est-ce que ces actes disent de notre idée même de civilisation ?
Civilisation ou barbarie : ce que révèle l’enlèvement d’un président
On peut appeler « civilisation », dans l’ordre international, tout ce qui limite la brute disponibilité du monde à la force des plus puissants.
Ce n’est pas d’abord une question de « valeurs » proclamées, de culture ou de niveau technologique, mais de règles qui arrachent les relations entre États à la pure loi du plus fort :
- la reconnaissance minimale que chaque État, aussi faible soit-il, ne peut être bombardé ou mis sous tutelle à discrétion ;
- l’interdiction de renverser militairement un gouvernement sans mandat collectif clair issu d’un consensus rationnel ;
- la séparation entre la justice pénale et l’arbitraire du vainqueur ;
- la distinction entre guerre, police et justice, entre conflit armé et poursuites judiciaires.
Quand Washington fait enlever un président étranger, l’inculpe pour narcotrafic et prétend gérer le pays jusqu’à stabilisation, il détruit simultanément plusieurs de ces barrières :
- Confusion entre force et droit
Le droit n’est plus ce qui limite la puissance, mais ce que la puissance fabrique pour justifier ses actes. Accuser un chef d’État de trafic de drogue n’est pas, en soi, illégitime. Mais lorsque cette accusation sert de prétexte à un enlèvement organisé par une armée étrangère, le message est clair : c’est parce que je peux t’arracher à ton pays en toute impunité que je te juge.
- Négation de la souveraineté comme principe commun
En déclarant vouloir diriger le Venezuela jusqu’à nouvel ordre, l’administration américaine nie le principe même sur lequel reposait l’ordre d’après-guerre : l’égalité juridique des États, au moins formelle. Le Venezuela n’est plus un sujet souverain, mais un objet de gestion.
- Réduction des ressources naturelles à un butin
Assumer publiquement la « gestion » des ressources pétrolières d’un autre pays revient à dire de manière ostentatoire ce que les interventions des dernières décennies signifiaient souvent sans le dire : la guerre comme instrument d’appropriation économique directe.
C’est ici que le mot « barbarie » retrouve un sens rigoureux.
Est barbare non pas celui qui serait « étranger » entendu comme le bárbaros grec ou « non-occidental » (nous sommes une seule et même civilisation humaine), mais celui qui refuse toute limite à l’exercice de sa propre puissance. Celui qui, ayant les moyens de s’imposer par la force, rejette l’idée même d’une règle commune qui le contraindrait.
De ce point de vue, l’administration américaine se comporte aujourd’hui comme ce qu’elle prétend combattre : elle agit en prédateur, exhibe son mépris des règles, montre qu’aucune frontière, aucun traité, aucune fonction (même celle de chef d’État) ne constitue un obstacle sérieux dès lors que ses intérêts sont en jeu.
Le Groenland, dans cette perspective, n’est pas un « autre dossier » : c’est la même logique appliquée à un territoire stratégique du Nord. Un pays membre de l’OTAN, des ressources minérales et énergétiques considérables, une position clé sur les routes arctiques : autant de raisons de tester jusqu’où on peut pousser la remise en cause de la souveraineté d’un allié.
La barbarie, ici, n’est pas à nos portes, elle est déjà là, et paradoxalement elle s’installe au centre de ce qui se présentait comme le cœur civilisé du système.
Quand le centre se décivilise : ce qui recule vraiment
On pourrait être tenté de conclure que « tout cela prouve » que le droit international n’a jamais été qu’une fiction. Ce serait précisément absoudre cette barbarie en la déclarant inévitable, donc contextuellement nécessaire.
Car l’édifice construit après 1945 – Charte de l’ONU, conventions, tribunaux, multilatéralisme – a bien produit des effets réels : il a limité certains conflits, encadré certaines interventions, fourni des outils de contestation aux pays les plus faibles. Des coups d’État, des guerres, des occupations ont été évités ou au moins rendus plus coûteux politiquement.
Dire aujourd’hui que « tout cela n’était qu’une illusion » revient à avaliser la thèse de ceux qui veulent précisément s’en débarrasser.
Ce que montre la séquence ouverte par les bombardements au Venezuela et les menaces renouvelées sur le Groenland, c’est autre chose :
- non pas l’inexistence de la civilisation,
- mais la décision d’une puissance centrale de se soustraire délibérément à cette civilisation.
Les États-Unis ont largement contribué à mettre en place l’ordre d’après-guerre. Aujourd’hui, leur administration agit comme si cet ordre ne valait plus pour elle.
C’est un mouvement de décivilisation du centre :
- les mécanismes de retenue (consultation, mandat, alliances, procédures) sont court-circuités ;
- l’usage spectaculaire de la force remplace la recherche de légitimité ;
- le langage même des droits et de la démocratie est vidé de son contenu, réduit à un décor pour opérations de police impériale.
Pour les « petits » pays, le signal est terrible : si un État membre de l’ONU peut voir son président enlevé, son territoire bombardé, ses ressources mises sous gestion étrangère sans autre forme de procès que celle organisée par le vainqueur, alors la souveraineté n’est plus qu’un mot.
Pour les alliés européens, et notamment pour une Union européenne qui se veut encore puissance normative, le dilemme est brutal : continuer à feindre que rien ne s’est produit, opposer une contestation vague et rapide au prix de sa propre crédibilité, ou reconnaître que l’allié principal est devenu l’agent d’une décivilisation qu’il faudra bien, tôt ou tard, nommer pour ce qu’elle est.
Enfin, pour les sociétés civiles – au Venezuela, aux États-Unis, en Europe, au Groenland –, la question se déplace : ce qui est en jeu n’est plus seulement la dénonciation d’un « abus de pouvoir », mais la défense d’une idée minimale de civilisation : celle selon laquelle il existe des choses qu’un État ne fait pas, même s’il en a les moyens.
La barbarie commence quand cette phrase cesse d’avoir un sens.
Le moment que nous vivons – où un président peut être enlevé, un pays mis sous tutelle, un territoire menacé d’annexion de facto – est peut-être l’un de ces moments-là.
Reste à savoir si nous en parlerons comme d’un « incident » de plus, ou comme d’un basculement : le moment où l’Empire a cessé de se raconter comme porteur de civilisation, pour assumer à visage découvert ce qu’il faisait déjà – prendre parce qu’il peut prendre.