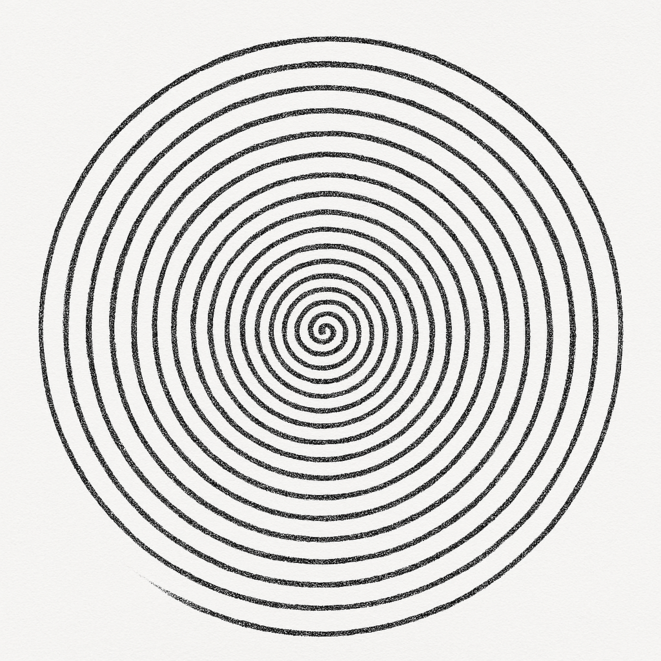Si l’on prend pour point de départ une donnée désormais difficilement contestable — environ 10 % des personnes subiraient un inceste au cours de leur vie —, alors le trauma ne peut plus être envisagé comme une aberration isolée dans la structure, mais comme une manifestation régulière de cette même structure. Ce fait statistique oblige donc à une relecture ontologique du trauma : il ne survient pas dans l’être comme une fissure dans une totalité saine, il révèle au contraire un être déjà corrompu, déjà travaillé de l’intérieur par la violence.
Le trauma doit être compris comme un fait culturel structurel, inscrit dans une histoire longue de la rationalité occidentale. Cette histoire s’ancre dans l’apparition d’une première grande dissociation entre l’âme et le corps, entre le monde des idées et celui du sensible, fondant ainsi une hiérarchie ontologique et épistémologique qui traverse toute la tradition. Cette dissociation sera reprise, redoublée, radicalisée par la modernité jusqu’à devenir l’ossature même de la rationalité : une rationalité dissociative, qui sépare la pensée du vécu, l’universel du singulier, le logos du pathos.
C’est à ce moment que s’opère, avec la modernité, l’avènement du sujet comme principe d’organisation du savoir et de la légitimité. Mais le sujet qui émerge — d’abord cartésien, puis transcendantal kantien — est un sujet abstrait, désincarné, sans affect, sans monde. Un sujet sans corps. Et c’est précisément cette abstraction fondatrice qui porte en elle une pathologie originelle : en prétendant universaliser une condition humaine réduite à sa seule dimension cognitive, elle exclut d’emblée le vécu, la relation, la mémoire, la souffrance — tout ce qui résiste à la formalisation. Ce sujet mutilé devient pourtant la mesure de l’humain : il fonde la normativité du savoir, légitime la disqualification des autres formes de rationalité, et constitue le socle épistémique d’une organisation hiérarchique du monde.
Cette dissociation n’est pas un échec secondaire de la pensée moderne : elle en est le cœur opératoire. C’est elle qui rend pensable, et donc praticable, la domination : domination du masculin sur le féminin, de la culture sur la nature, du logos sur le corps, de l’Europe sur le reste du monde. Le colonialisme, le patriarcat, l’extractivisme, l’écrasement des singularités — tous procèdent de cette même architecture dissociative, où l’universalité est confisquée par une figure de sujet qui ne représente qu’elle-même. Ce n’est pas la raison en tant que telle qui est en cause, mais sa clôture sur elle-même, son incapacité structurelle à se penser comme située, incarnée, historiquement déterminée.
Ce que révèle cette critique, c’est que la rationalité moderne ne s’est pas construite en dialogue avec la complexité de l’être, mais contre elle. Elle n’a pas cherché à comprendre, mais à réduire. Elle n’a pas visé le lien, mais la maîtrise. Et c’est cette logique de séparation — de soi, des autres, du monde — qui produit le terrain favorable aux violences systémiques, en les rendant pensables, invisibles, admissibles.
Dans cette configuration, le trauma — et en particulier les violences incestueuses ou familiales — ne relèvent pas de l’accident, mais d’une fonction latente de la structure. Le trauma devient un révélateur, un symptôme du système de pensée qui organise le réel. Ce n’est pas la société en tant que telle, mais la structure organisatrice des rapports humains qui est en cause : elle n’est pas perverse parce qu’elle échoue, mais parce qu’elle fonctionne selon une logique dissociative, qui hiérarchise, qui nie les affects, et donc qui rend possible — voire nécessaire — leur mise en scène violente à travers les corps.
C’est dans ce sens qu’il faut comprendre le caractère systématique des abus. Il ne relève pas d’une exception, mais d’un mécanisme de reproduction sociale inscrit dans la logique même des institutions, du langage et des représentations.
Ainsi, penser ensemble l’écoféminisme et l’herméneutique du trauma, ce n’est pas rejeter en bloc la rationalité héritée des Lumières ou de la modernité scientifique, mais en dévoiler les limites profondes lorsqu’elle devient exclusive, abstraite et dissociative. Cette rationalité, en tant qu’outil de connaissance, a permis des avancées indéniables, mais elle a été construite sur une dissociation fondamentale entre le corps et l’esprit, le sujet et le monde, le logos et le pathos, la nature et la culture, le féminin et le masculin.
C’est précisément cette dissociation devenue structurelle qui rend aveugle aux affects, aux vécus et aux corps souffrants. L’écoféminisme et l’herméneutique du trauma ne proposent pas de remplacer cette rationalité par une autre purement émotionnelle ou mythique, mais d’ouvrir l’espace d’une rationalité élargie, intégrative : une rationalité qui accueille l’émotion comme moment de vérité, le corps comme lieu de savoir, la relation comme modalité première de l’être au monde.
Penser une rationalité élargie, ce n’est pas seulement élargir le champ des objets considérés, c’est reconnaître d’autres formes de saisie du réel comme également légitimes. Avant tout concept, il y a ce contact brut où le corps saisit le monde : non comme sensation à traduire, mais comme vérité donnée, irréductible à toute médiation du langage. Cette saisie immédiate — singulière dans sa forme, universelle dans sa nature — appartient déjà à ce qui fonde le vrai.
La reconnaître ne retire rien au logos ; elle en déplace les frontières pour qu’il accueille enfin ce qu’il avait exclu. Cette complémentarité ouvre sur une nouvelle ontologie où la justesse ne se réduit pas à l’abstraction froide, mais se mesure à sa capacité à rendre justice à l’expérience, à relier, à incarner. Une ontologie relationnelle, symbolique et vécue, qui ne nie pas la science mais la recontextualise, qui ne supprime pas le logos mais le réinscrit dans le vivant. C’est dans cette conjonction — et non dans une substitution — que peut émerger une forme de justesse, et avec elle, cette justesse ontologique qui ne sépare plus l’être, le savoir et le sentir, mais qui donne à voir la complexité de ce qui est : une réalité qui excède les modèles mathématiques, qui déborde toute hiérarchisation sèche du savoir, et qui réclame une pensée à la mesure de la complexité humaine elle-même. Et parce qu’elle redonne droit de cité à ce qui avait été exclu — le corps, l’affect, la relation —, cette justesse n’est pas qu’une idée : elle ouvre à une autre manière d’habiter le monde, de l’organiser, de le partager. Ce n’est qu’en transformant ce que l’on considère comme connaissable, dicible, pensable, que l’on peut transformer ce que l’on juge légitime, gouvernable, acceptable. Le geste ontologique devient ainsi geste politique.
Dans cette perspective, chaque binarité héritée (corps/esprit, masculin/féminin, nature/culture, logos/pathos) peut être envisagée non seulement comme un lieu de fracture, mais aussi comme un point de passage possible : un seuil symbolique permettant d’esquisser une pensée de la réconciliation, une pensée de la relation. Loin de maintenir l’opposition, il s’agit d’habiter ces tensions, de les transformer en dynamique herméneutique, en espaces d’interprétation vivants et ouverts.
C’est cette logique de transformation, de passage et de relation qui fonde la pertinence d’une ontologie élargie — une ontologie du lien, qui prend au sérieux le réel tel qu’il se manifeste dans les corps, dans les récits, dans les affects, dans les résistances aussi. Une ontologie du “tenir ensemble”, contre la dislocation méthodique opérée par des siècles de rationalité dissociative.
Dans ce cadre, l’expérience du trauma n’est plus à penser seulement comme souffrance individuelle à réparer, mais comme lucidité douloureuse sur le monde. Et cette lucidité, parce qu’elle passe par le corps, par l’affect, par la pensée, et leur articulation progressive et réciproque, ouvre une autre voie possible : une réinscription de soi dans le monde qui ne soit ni acceptation de la norme, ni révolte aveugle, mais vérité vécue.
Et c’est cette vérité, parce qu’elle s’élabore dans le langage – dans le langage que nous sommes, dans le langage que nous entretenons avec autrui – qui rejoint le geste herméneutique. À condition d’entendre “autrui” au sens large : non seulement l’autre humain, mais l’autre qu’est tout ce qui est. Le dialogue herméneutique n’est pas réservé à l’échange intersubjectif ; il engage une relation au monde dans sa totalité. Nommer, c’est déjà entrer en dialogue. Nommer une fourmi, c’est déjà la reconnaître comme altérité, comme interlocutrice possible, même muette.
C’est ici que s’opère l’articulation avec l’écoféminisme : dans cette reconnaissance d’un tissu de relations symboliques et réelles, entre l’humain et le non-humain, entre le langage et le vivant, entre le féminin et la terre, entre le corps et le monde. La lucidité traumatique, lorsqu’elle se dit, devient écoute. Et cette écoute, en tant qu’acte ontologique, transforme la place du sujet : il n’est plus hors du monde, mais inscrit en lui comme une résonance. Le trauma n’est plus isolement, il devient interrelation.
Ainsi, l’herméneutique du trauma et l’écoféminisme convergent vers une pensée relationnelle, incarnée, qui réinscrit la subjectivité dans un monde signifiant, à rebours de la dissociation moderne. Le langage redevient geste de reliance. Et c’est dans cette relation que peut émerger une ontologie de la vérité vécue.
Il y a alors une correspondance puissante entre ce que cherche à penser l’écoféminisme — la réconciliation du vivant avec lui-même, dans une logique non-violente, non-extractive, non-hiérarchique — et ce que permet une telle traversée du trauma. Un monde où l’on ne survit pas à un pseudo-être abstrait, mais où l’on peut redevenir sujet : sujet incarné, sujet cité, sujet relié.
C’est là le sens profond de cette conjonction. Elle exige une refonte de notre épistémologie, aujourd’hui désespérément partielle, mutilante, réductrice. Non parce qu’elle serait fausse, mais parce qu’elle s’est constituée en excluant tout ce qui ne se pliait pas à sa logique : les corps, les affects, les relations, les symboles. C’est une épistémologie qui a mis l’être sur un lit de Procuste. Et les femmes, comme toutes les altérités, sur le bûcher. Les sorcières, les déviantes, les insoumises : on les a brûlées. Littéralement. Historiquement. Et symboliquement.
Ce que dévoile la rencontre entre écoféminisme et herméneutique du trauma, c’est la possibilité d’une ontologie réparée, d’une ontologie relationnelle, incarnée, vécue, où la vérité ne relève plus de l’abstraction froide, mais de la justesse de ce qui relie. Une ontologie qui ne nie pas le logos, mais qui l’ouvre à ce qu’il avait écarté : le corps, l’affect, la mémoire, la blessure et la parole. Une ontologie qui redonne place à la parole de celles et ceux qu’on a dépossédés de tout.
Et l’on comprend alors ce que signifient vraiment ces 10 % d’inceste : non une anomalie à corriger dans un système globalement sain, mais l’indice d’un fonctionnement ordinaire de la structure. Ce chiffre, à la lumière de cette traversée, ne dit plus seulement l’étendue d’une souffrance, il dit la vérité d’un monde. Il atteste que le trauma n’est pas une exception, mais un langage : celui d’un être en déliaison, d’un logos amputé de sa chair, d’une rationalité oublieuse de sa dette envers la vie.
Dès lors, faire droit à ces 10 %, ce n’est pas seulement faire place à des victimes ; c’est refonder une épistémologie. C’est reconnaître que ce qui fait fracture peut aussi faire vérité. Et que toute vérité, si elle veut être juste, devra désormais passer par là.
On pourra objecter, contester, détourner. On pourra tenter de réduire ces lignes à un effet de style, à un excès militant, à une exagération statistique. Peu importe : chaque fois que ces arguments reviennent, ils reconduisent la dissociation que ce texte dénonce. Alors autant leur répondre d’avance, frontalement, point par point, pour que le débat, s’il a lieu, se fasse enfin sur le fond, et non dans les marges confortables de la mauvaise foi. D’où l’appendice qui suit :
1 - “Les 10 % d’inceste, c’est exagéré”
Ce chiffre ne sort pas d’un chapeau. Il vient d’enquêtes institutionnelles comme celles de la CIIVISE, de l’INSERM ou de l’OMS. Et c’est une estimation basse. Pourquoi ? Parce que le silence pèse plus lourd que les mots. Parce que la peur, la honte, le déni familial et social étouffent la parole. Parce que la justice ne reconnaît qu’une partie des violences.
Si l’on additionne la non-parole, la non-reconnaissance et la non-prise en charge, on dépasse largement les 10 %. Ce chiffre ne dit pas qu’il s’agit d’un accident : il dit que c’est structurel. Et ce que l’on nie, on l’organise.
2 - “Vous rejetez la raison et les Lumières”
Non. Ce texte ne jette pas la raison à la poubelle, il attaque sa clôture. La raison moderne, lorsqu’elle se croit universelle en excluant le corps, l’affect, la mémoire, devient mutilante. Ce n’est pas du relativisme : c’est une exigence d’universalité réelle.
L’histoire de la philosophie est remplie de penseurs qui ont vu ses limites : Kant, Nietzsche, Foucault. Ce que je propose, c’est de rouvrir le logos à ce qu’il avait expulsé. Non pour le détruire, mais pour le guérir.
3 - “L’écoféminisme et le trauma n’ont rien à voir”
Faux. Les violences sexuelles et la destruction écologique naissent d’une même logique : dissocier pour dominer. Dissocier corps et esprit, masculin et féminin, nature et culture.
Le patriarcat et l’extractivisme partagent le même geste : traiter certains corps — humains ou non — comme exploitables, muets, disponibles. L’écoféminisme le montre depuis cinquante ans : ces oppressions se tiennent. Les penser ensemble, c’est voir la structure entière au lieu d’en examiner un seul pilier.
4 - “Vous essentialisez le féminin”
Non. Dire que le corps, l’affect ou la relation doivent être réintégrés dans l’universel, ce n’est pas dire qu’ils sont “naturellement féminins”. C’est dire que l’histoire les a assignés au féminin pour mieux les exclure.
L’objectif est l’inverse de l’essentialisme : sortir ces dimensions de la case “féminin” pour en faire des dimensions de l’humain. Ce que le patriarcat avait étiqueté, on le rend à tout le monde.
5 - “C’est trop sombre et totalisant”
Pointer une structure n’est pas accuser chaque individu. C’est nommer le terrain où poussent certaines violences, parfois sans que personne ne les ait “voulu” consciemment.
Critiquer le capitalisme ne veut pas dire que chaque capitaliste est un monstre ; critiquer la structure dissociative ne veut pas dire que chaque sujet moderne est un bourreau. Mais si l’on refuse de voir le terrain, on laisse la graine intacte.
6 - “C’est beau mais inutile, pas concret”
Ce que l’on ne pense pas, on ne peut pas changer. Ce que l’on ne nomme pas, on ne peut pas combattre.
Chaque révolution sociale a commencé dans les mots, dans un changement de perception : l’abolition de l’esclavage, les droits des femmes, l’écologie politique.
Penser autrement, ce n’est pas perdre son temps : c’est ouvrir la porte par laquelle l’action pourra passer. Ce texte est cette porte.