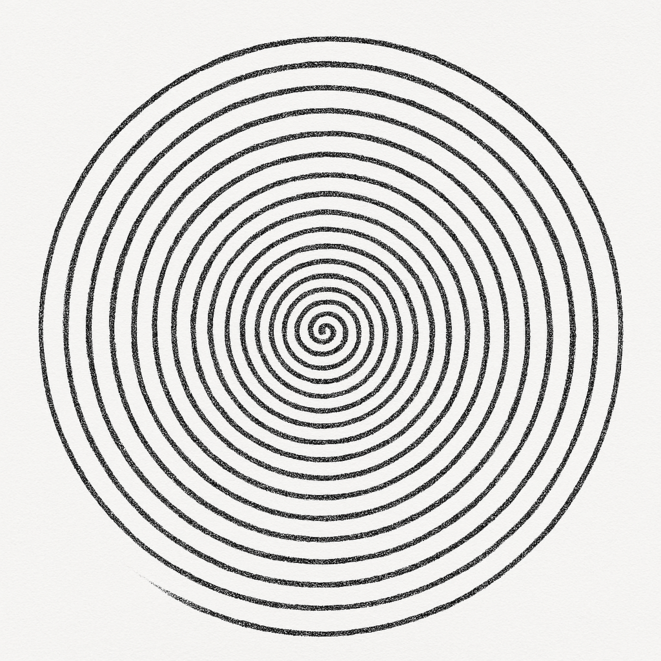Il est devenu banal de dire que l’Éducation nationale traverse une crise.
On en parle en termes de moyens, de rémunérations, de réformes successives.
Mais on passe souvent à côté de ce que les enseignants et nos enfants vivent réellement dans les établissements : une transformation profonde de la manière de gouverner l’école, une mutation silencieuse des mécanismes de pouvoir.
Ce qui s’installe aujourd’hui n’a rien de spectaculaire. Il n’y a ni grands discours idéologiques, ni doctrine affichée. Ce qui est précisément sa force : un pouvoir sans doctrine explicite est un pouvoir dont la doctrine réelle se trouve partout et nulle part, donc impossible à contester. C’est quelque chose de plus insidieux, de plus froid, de plus difficile à nommer, quelque chose qu’on pourrait, sans trop manquer le phénomène, nommer : autoritarisme procédural.
Il ne s’exprime pas par des slogans, mais par des entretiens “informels”. Pas par des menaces, mais en invoquant des “cadres”. Nulle injonction directe, mais des formulations administratives prudentes, dans lesquelles chaque terme a été poli, vidé de sa substance, jusqu’à perdre toute friction avec le réel.
C’est un pouvoir qui n’a plus besoin de dire “tais-toi”. Il lui suffit de dire : “Ceci n’est pas le lieu pour en parler.”
Autoritarisme procédural : un régime de contrôle sans idéologie affichée
Contrairement aux fantasmes politico-médiatiques, le danger pour l’école n’est pas le retour d’une forme de fascisme déclaratif — encore moins une logocratie, un pouvoir exercé par ceux qui « maîtriseraient » le logos ou tout du moins son lieu d’émergence.
Au contraire : ce qui se déploie aujourd’hui est un système où le logos est désactivé par avance. Dans les couloirs d’un lycée, dans une salle des profs, penser devient presque un risque professionnel, non pas parce qu’un pouvoir politique dicterait une ligne idéologique, mais parce qu’un protocole standardisé neutralise toute possibilité de singularité. Or, par définition, la doxa ne pense pas.
Ce pouvoir ne passe pas par la conviction, mais par la procédure ; pas par une figure charismatique, mais par des chaînes de courriels ; pas par des discours, mais par un care managérial qui se met lui-même hors de critique.
Comme l’avait montré Hannah Arendt, les formes de pouvoir les plus efficaces ne sont pas celles qui imposent leur idéologie, mais celles qui transforment l’espace même où une pensée pourrait se former. Sans jamais établir de parallèle disproportionné, on peut reconnaître dans l’autoritarisme procédural un mécanisme voisin : la neutralisation de la pensée par la procédure, qui remplace le jugement par l’obéissance formelle.
À ce stade, plusieurs manières de décrire ce phénomène se présentent : on peut dire que le logos est désactivé, rendu inopérant ; on peut dire qu’il est amputé, privé d’une part essentielle de ses conditions d’apparition ; et l’on pourrait même évoquer une forme d’“allogocratie”, un régime où la parole vivante se trouve expropriée au profit de dispositifs extérieurs. Ces trois images ne disent pas des choses différentes : elles désignent trois entrées vers un même phénomène.
S’il fallait risquer un terme, on pourrait parler, au sens littéral du mot, d’une forme d’« allogocratie » : un régime où le logos est empêché, où la parole vivante se trouve remplacée par des dispositifs extérieurs — procédures, cadres, « reporting » — qui dictent ce qui peut ou non être dit. Ce terme n’est pas consacré, et je l’emploie ici dans une acception descriptive, pour désigner un régime où la parole est expropriée.
Mais tâchons de rester sobre : le mot exact, philosophiquement tenable, est autoritarisme procédural.
Comment fonctionne cet autoritarisme procédural ?
Il s’articule autour de plusieurs mécanismes qui, pris séparément, semblent anodins, mais qui, combinés, produisent un système de contrôle diffus et extrêmement efficace.
-Il opère un brouillage entre l’informel et le formel. Les directions d’institutions modernes utilisent de plus en plus des espaces dits “informels”, “non cadrés”, “exploratoires”. Mais ces espaces produisent des effets réels sans jamais offrir les garanties du contradictoire. Ce glissement évite soigneusement les responsabilités explicites : ce qui n’est pas formel n’est jamais vraiment contestable, ce qui produit des effets n’est jamais reconnu comme décision. Il en résulte que l’individu se trouve alors face à des “échanges” qui n’en sont pas vraiment, mais dont les conséquences, elles, sont bien réelles.
-La procédure comme principal instrument de légitimation. Le conflit ne porte plus sur les idées, les pratiques ou les faits. Mais il porte sur : la conformité aux protocoles, la trace écrite, la “bonne posture communicationnelle”, la “justesse de l’expression”, la capacité à “rentrer dans le cadre”. De telle sorte que l’argumentation rationnelle, le logos, la pensée vivante ne sont plus des ressources opérantes : elles deviennent presque suspectes, car impropres à entrer dans le format procédural.
-La production d’un imaginaire du risque. Sans être jamais précisément défini, le “risque” se diffuse. La structure évoque : des “inquiétudes”, des “remontées”, des “attentes”, des “incertitudes”, des “retours”. Ces termes souvent qualifiés de « valises » n’ont pas besoin de contenu pour fonctionner. Ils amorcent un climat où l’individu doit se justifier d’un risque qui n’est jamais établi. Car le pouvoir n’accuse jamais frontalement : il suggère, il insinue, il évoque. Et c’est suffisant pour déplacer le centre de gravité : ce n’est plus l’institution qui doit prouver ; c’est l’individu qui doit rassurer.
-L’effacement progressif du logos. La parole vivante — celle qui interroge, qui raisonne, qui déstabilise — devient peu à peu inadaptée. Elle est remplacée par : la communication, la “réassurance”, le “dialogue constructif”, le “travail sur la posture”, les éléments de langage. Le logos n’est pas interdit, ce serait tellement facile : il est rendu inaudible, obsolète, par un régime discursif où seuls comptent les formats validés. Ce n’est pas la critique qui est réprimée, c’est la pensée qui est progressivement débranchée de son élan.
-L’individualisation systématique des tensions. Au lieu d’interroger les dynamiques collectives (conditions de travail, organisation, pression hiérarchique), tout problème est systématiquement renvoyé à l’individu. A son “stress”, à son “inadaptation”, à sa “communication”, à sa “gestion de la situation”, à son “rapport aux équipes”. C’est ainsi que l’individu devient le lieu exclusif de la défaillance. Jamais la structure. C’est là peut-être la signature de l’autoritarisme procédural : le pouvoir est partout, mais toujours nulle part assignable.
-La substitution du réel par le discours administratif. Dans ce type de régime, la réalité des situations finit par être moins importante que le récit institutionnel, la version écrite, la chaîne mail validée, la conformité lexicale. La parole humaine — complexe, ambiguë, vraie — est remplacée par le texte administratif — clair, propre, mais ontologiquement amputé.
Ce sont là les éléments constitutifs d’une dérive vers cet autoritarisme procédural, un régime où le logos, ce qui fait monde entre les individus, est remplacé par un langage qui n’a plus pour fonction de dire ce qui est, mais d’organiser ce qui doit paraître.
Une rupture anthropologique
Ce qui s’étiole dans l’école, ce n’est pas la discipline ou l’autorité, les corps y sont de toute façon matés. Ce sont les conditions mêmes du dialogue qui tendent à disparaître, c’est le langage qui y est attaqué.
L’école française a longtemps reposé sur un rapport vivant au savoir, sur un logos qui se déploie dans la rencontre entre une parole et un public. Or, c’est précisément cette rencontre que l’autoritarisme procédural fait disparaître. Il ne reste plus que des “situations”, des “retours”, des “cadres”, des “postures”, c’est-à-dire un langage administratif, procédural, qui se substitue au langage humain.
Pourquoi c’est grave.
Parce que cette transformation s’accompagne d’un basculement plus large : la dépolitisation de la pensée (donc sa disparition), la pathologisation du rapport critique, la suspicion envers toute singularité intellectuelle, la réduction de l’enseignant à un opérateur de conformité.
La dangerosité de ce système, c’est qu’il n’a pas besoin de réprimer la pensée pour l’éteindre : il suffit de lui enlever son espace de respiration.
À quoi reconnaît-on un autoritarisme procédural qui s’installe ?
À ceci qu’on ne vous dit jamais que vous avez tort mais que “ce n’est pas le bon cadre”. On ne vous y reproche pas vos idées mais votre “posture”. On ne vous oppose pas d’argument mais on vous renvoie à un “ressenti”. On ne vous sanctionne pas mais on vous “accompagne”. On ne vous demande pas de vous taire, on vous demande de remplir un formulaire.
Ce qui se joue n’est pas une affaire individuelle
Ce texte ne parle pas d’un cas particulier.
Il parle d’une structure de pouvoir, d’une mutation institutionnelle, d’un glissement du sens au sein de l’école.
Le réel point de rupture, celui qui devrait inquiéter tout citoyen, est simple : on ne sanctionne plus les dérives pédagogiques, on régule les écarts par rapport à une norme implicite du silence.
Et cet effacement progressif du logos — cette « allogocratie » larvée — n’est pas un accident. C’est le signe d’une structure qui, parce qu’elle a perdu toute forme de signifiance, cherche refuge dans la procédure silencieuse. Une école sans langage n’est déjà plus une école. Une démocratie sans langage n’est déjà plus une démocratie.