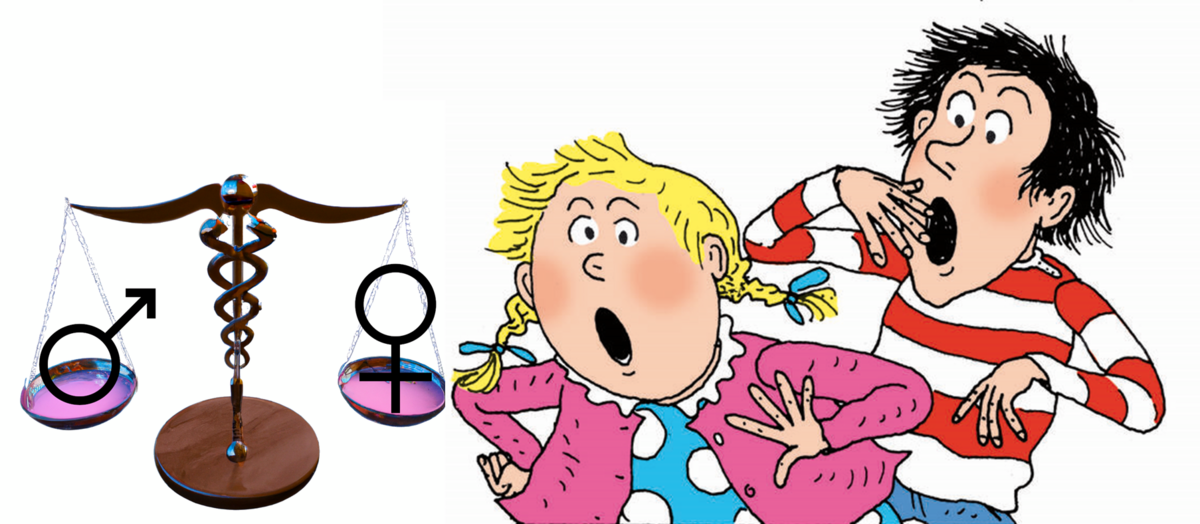
Agrandissement : Illustration 1
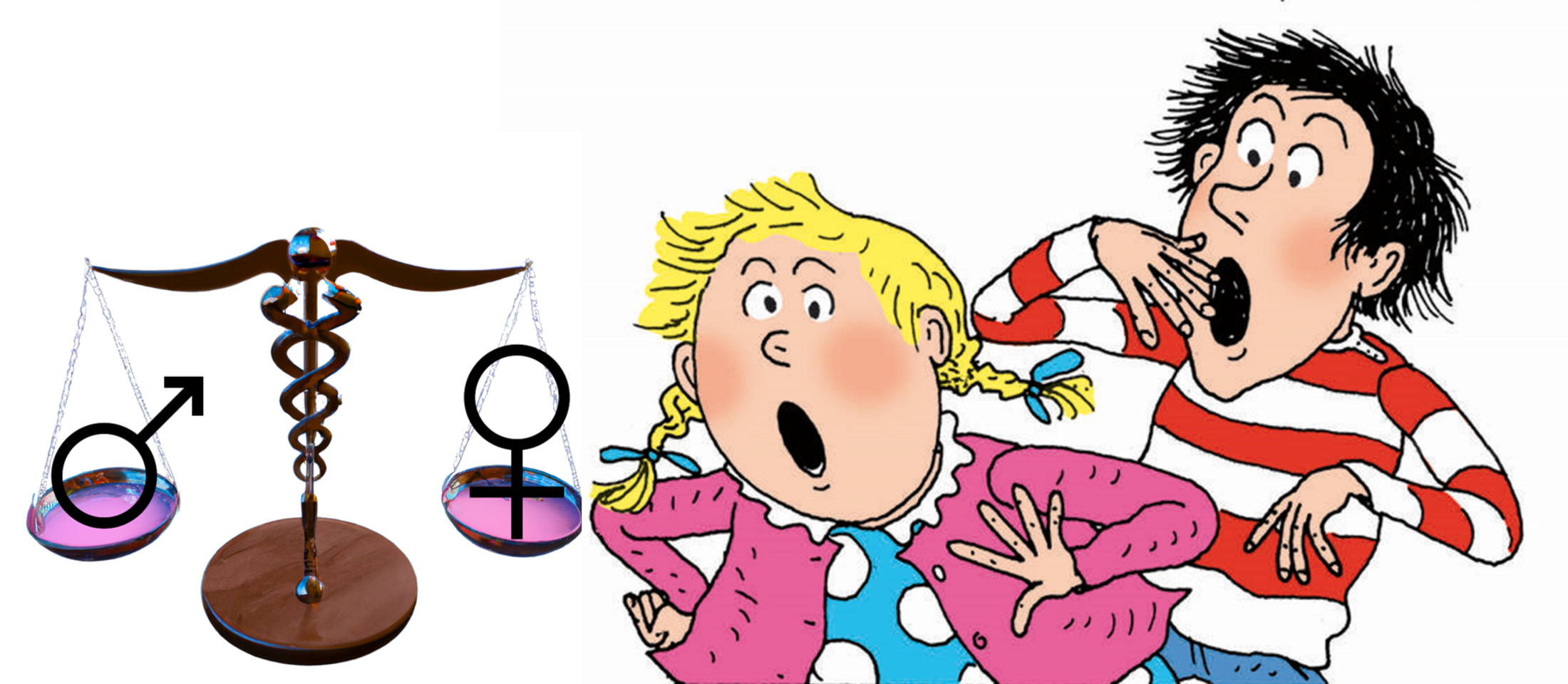
Nana : Bonjour Tom-Tom !
Tom-Tom : Oh bonjour Nana, tu tombes bien je pensais à toi ! Peux-tu me dire ce que tu penses de l’autodétermination des mineurs trans, sachant que moi je suis contre ?
Nana : Ok c’est vraiment super, mais tu es contre quoi exactement ?
Tom-Tom : Je pense que le principe d’autodétermination des personnes trans, et particulièrement des mineurs, entre en contradiction avec le principe de protection de l’intégrité physique : si on laisse les ados décider par eux-mêmes les soins qu’ils veulent, sans contrôle médical - par exemple les bloqueurs de puberté, les hormones ou les chirurgies - on intervient alors sur un corps sain avec des effets irréversibles et stérilisants, et cela ne doit être possible que pour répondre à une souffrance, et de façon proportionnée.
Nana : Mon cher Tom-Tom, je ne suis pas d’accord avec toi, déjà parce qu’on ne partage pas la même définition de l’autodétermination. Pour moi, l’autodétermination, c’est que toute personne est seule à pouvoir définir son identité de genre. Cela veut dire qu’un psychiatre par exemple, ne pourra jamais dire : « non toi tu es un garçon » ou « non toi tu es une fille ». Ce qu’implique l’autodétermination, c’est que nul n’est en position de réprimer la transition sociale d’une personne trans. Partant de là, il est souhaitable d’accompagner positivement ces transitions sociales. Non pour des raisons de santé, quoi que la transition sociale soit également bénéfique à la santé de celles et ceux qui la souhaitent, mais pour des raisons de principe, et plus clairement de droits humains. Pour autant, l’autodétermination, dans cette définition-là, n’implique pas que les ados trans ont par principe un droit aux soins trans-spécifiques, qui est une question beaucoup plus complexe.
Tom-Tom : Ok, mettons que l’autodétermination justifie les transitions sociales, sans supervision médicale, mais ne justifie pas pour autant les transitions médicales. Je suis d’accord avec ça. Toujours est-il que pour les transitions médicales, il y a atteinte à l’intégrité corporelle, et que les traitements doivent dans ce cas répondre à une nécessité médicale. C’est l’article 16-3 du code civil. Autrement dit, il faut caractériser la souffrance dans laquelle se situe l’ado, et les traitements pourront alors être prescrits, sous condition qu’ils permettent de remédier à cette souffrance de façon proportionnée à leur invasibilité et irréversibilité. Or j’ai l’impression que cette balance des bénéfices et des risques n’est pas systématiquement recherchée par les médecins, qui prescrivent au final toujours ce que demandent les ados.
Nana : Ce que tu souhaites, c’est le paradigme de la pathologisation, qui prévaut en France depuis la décision de l’Ordre des médecins de soutenir les équipes hospitalières en 1979 !
Tom-Tom : Non, pas nécessairement. On peut tout à fait encadrer médicalement les demandes, sans psychopathologisation.
Nana : Certes, sans psychopathologisation, mais pas sans psychiatrisation ! Ce n’est peut-être pas la même chose mais ça porte les mêmes effets. Car comment comptes-tu objectiver la souffrance exactement ? D’accord, il existe des instruments de mesure en santé mentale. Ils pourront aider un médecin à savoir si un traitement a été bénéfique à une personne. Mais le problème médical que tu poses, c’est d’avoir la capacité de mesurer, à l’avance, si un traitement va être bénéfique à une personne en particulier, et avec quelle magnitude. Autrement dit, il s’agit d’être capable d’estimer la variation de santé anticipée du traitement, en intégrant à cette estimation ses bénéfices attendus pour la personne mais aussi ses coûts, en termes d’effets secondaires, et de pertes de fonctionnalité attendues, et ce dans les trois dimensions de la santé selon la définition de l’OMS – physique, mentale et sociale. Or imposer un tel calcul au médecin, non seulement contrevient au principe éthique de justice, c’est-à-dire qu’il n’est pas exigé aux ados cis qui demandent des traitements similaires, mais en plus met en péril l’existence même de ces traitements, en raison de l’absence véritable de moyens d’estimation de ce calcul bénéfices-risques. C’est exactement le piège bioéthique dans lequel se trouvent des centaines d’ados trans en France : leurs médecins ne sont pas des devins, et pourtant on leur demande de savoir à l’avance quel va être l’impact en termes de santé des traitements. Ils peuvent le savoir en moyenne pour l’ensemble de leur file active trans, car les études démontrent les effets bénéfiques de ces traitements en général. Mais ne les sachant pas en particulier pour chaque individu, ils laissent tous les ados en observation, ne leur disant jamais « non » pour ces demandes de soins, mais les convoquant tous les 6 mois en consultation psychiatrique pour ne faire que constater la dégradation de leur santé mentale, et ce jusqu’à ce que les jeunes atteignent 18 ans. Ce que tu proposes n’est pas l’interdiction des soins pour les mineurs trans, mais y converge dans ses effets.
Tom-Tom : Peut-être que ce n’est pas idéal, mais c’est le seul moyen d’être en conformité avec la loi.
Nana : Réellement ? Car je ne vois pas où est l’atteinte à l’intégrité corporelle des bloqueurs de puberté, ni des hormones par ailleurs. Ce motif n’est jamais invoqué pour les ados cis qui prennent ces traitements. Encore une fois, c’est une entorse au principe éthique de justice.
Tom-Tom : Concentrons-nous alors sur la question des torsoplasties chez les ados transmasculins. Tu es quand même d’accord qu’il y a atteinte à l’intégrité corporelle dans ces cas-là non ?
Nana : Au sens de l’article 16-1 du code civil, le corps est inviolable. Mais si la personne consent aux modifications corporelles, cela change tout.
Tom-Tom : Pas tant, le consentement est effectivement une exception à l’inviolabilité du corps humain, mais seulement en cas de nécessité médicale pour la personne. C’est bien ça qu’il faut caractériser : l’intérêt médical pour la personne dont l’intégrité corporelle est atteinte.
Nana : Tu cites l’article 16-3 du code civil à nouveau. Je te signale que quand il a été écrit, lors de la première loi bioéthique de 1994 – adoptée au passage par un gouvernement et une majorité de droite – l’un des buts était de faire barrage à toute forme de GPA. Tout occupé à légiférer contre la solidarité entre femmes, le législateur ne s’est pas rendu compte que l’écriture de l’article 16-3 interdisait en pratique le prélèvement d’organe sur vivant. Toi qui défends le respect de l’intégrité corporelle sauf en cas d’intérêt médical pour la personne, tu es donc forcément opposé à ce que je donne un de mes reins à une personne qui en a besoin ?
Tom-Tom : Effectivement, c’est un oubli de la loi de 1994, mais sans effet sur les pratiques d’alors, et qui a été corrigé avec la loi bioéthique de 2004. Le prélèvement d’organe, j’y suis favorable, car il y a un intérêt thérapeutique pour autrui.
Nana : C’est intéressant, tu considères donc que l’intérêt médical n’a pas lieu d’être personnalisé : si, de façon générale, on sait qu’une « atteinte à l’intégrité corporelle » d’une personne consentante peut induire une amélioration de la santé collective, alors cette atteinte est justifiée. Dans le même ordre d’idées, on sait que les soins affirmateurs de genre sont bénéfiques pour la très vaste majorité des personnes qui en expriment le besoin, c’est-à-dire sont bénéfiques pour la santé publique. Dès lors, poser comme contrainte de savoir à l’avance s’ils seront bénéfiques assurément à chaque personne qui en exprime le besoin, n’est pas une contrainte justifiée face à l’intérêt public manifeste de ces soins.
Tom-Tom : Désolée, mais ton analogie avec la transplantation d’organes me paraît un peu tirée par les cheveux. Tu dois sûrement avoir d’autres arguments en réserve pour défendre que les médecins doivent abandonner toute grille bénéfices-risques sur les soins atteignant l’intégrité corporelle ?
Nana : Oui mais tout d’abord ce n’est pas ce que j’ai dit ! L’estimation des bénéfices et des risques de ces soins est intégrale au problème éthique, et je disais plus tôt combien elle risquait d’entraver l’accès aux soins en pratique. Le médecin a un autre problème à résoudre que tu ne soulèves pas : il doit estimer aussi les bénéfices et les risques d’une non-intervention médicale. Quel est l’effet anticipé sur la santé mentale du refus de soins par un médecin, chez un ado qui a déjà fait plusieurs tentatives de suicides ? Si on pose une exigence d’évaluation de la variation en santé attendue d’une intervention médicale, il faut aussi systématiquement avoir la même exigence d’évaluation sur les effets attendus de la non-intervention médicale. Le statu quo n’est jamais une option neutre. En définitive, si l’ado trans est piégé par l’exigence de certitude sur les conséquences bienfaitrices des soins, le médecin est contraint par l’exigence de certitude sur les conséquences non-malfaisantes du refus de soins. Sauf que l’ado n’a pas de porte de sortie, alors que le médecin peut très bien décider d’arrêter de recevoir des jeunes trans, ce qu’ils font en définitive tous pour la plupart, accroissant le problème d’accès aux soins.
Tom-Tom : Comment comptes-tu résoudre ton problème d’accès aux soins, à périmètre législatif constant, c’est-à-dire sans ouvrir de droits nouveaux ?
Nana : L’ouverture de droits pour les soins de transition serait idéale, elle consacrerait le principe d’autonomie, qui est déjà à l’œuvre dans le droit à la contraception et l’avortement des mineures, ou dans la stérilisation contraceptive des adultes. Mais en l’absence de ces droits pour des soins de transition dans la loi, on demeure dans une confrontation du principe éthique d’autonomie avec le respect de l’intégrité corporelle. Le problème pour moi peut se résoudre dans la notion d’intérêt médical, qui ouvre une exception à l’atteinte de l’intégrité corporelle. Qui décide de l’intérêt médical ? Est-ce le médecin ou la personne concernée et ses parents ? Ou au consensus de tous, liés par une relation partenariale ? Quand on va dans le détail de l’analyse des bénéfices et des risques, comment savoir quel poids donner aux avantages des soins, et aux inconvénients ? N’est-ce pas la personne concernée qui est la plus experte sur elle-même, donc aussi sur ce qui lui fait du bien, ce qui lui fait du mal, ce qui est susceptible de lui faire plus de bien, ou plus de mal ? Comment justifier que le point de vue du médecin - ou des parents d’ailleurs – l’emporte sur celui de la personne concernée, alors qu’il s’agit précisément de déterminer les valeurs et préférences de la personne concernée ? Certes les médecins spécialisés ont une expertise sur les valeurs et préférences des personnes trans, du fait de leur pratique auprès de ce public, mais comment peuvent-ils anticiper que leur connaissance, toute moyenne, de ces valeurs et préférences observées classiquement dans le reste de sa patientèle soit parfaitement pertinente pour anticiper correctement celles du patient bien spécifique qu’ils ont en face d’eux ? Ne serait-il pas plus simple de demander directement aux personnes concernées ? On le voit mon cher Tom-Tom, même quand on discute de l’intérêt médical, le principe d’autonomie n’est jamais loin et sait se rappeler aux décisions et jugements médicaux, par l’exigence pour une véritable démocratie en santé.
Tom-Tom : Merci Nana pour ton éclairage, je pense qu’on peut arrêter la conversation ici et passer aux questions du public.
Nana : D’accord Tom-Tom !



