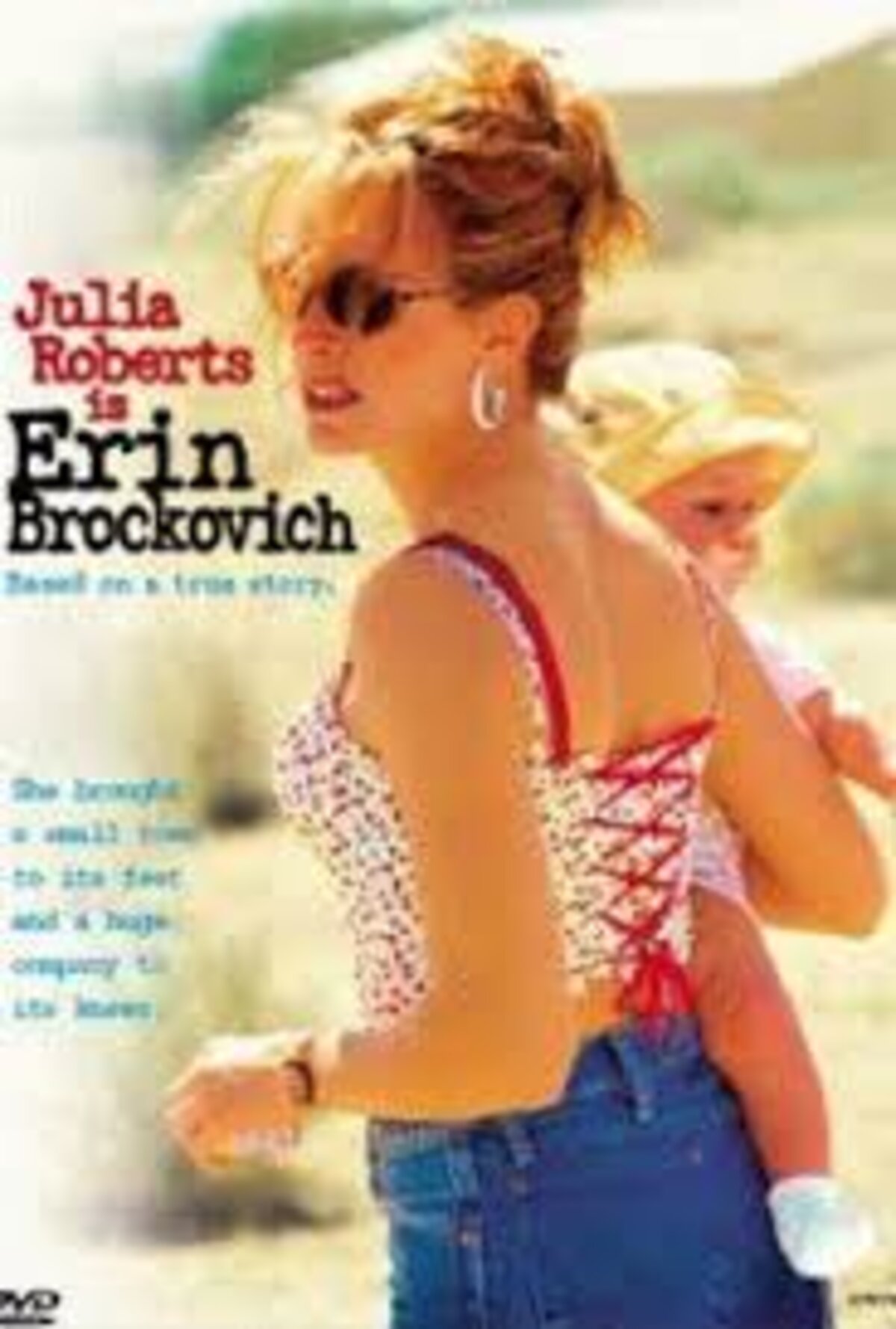
Face au retour des « féodalités économiques » et au séparatisme – réel – des marchés qui remettent en cause les bases de notre contrat social, la justice est souvent impuissante. Trop lente, trop chère pour les demandeurs, trop clémente avec les fautifs, elle remplit mal sa mission réparatrice.
L’action collective peut être un moyen puissant de rendre du pouvoir et de l’influence aux citoyens et aux consommateurs. Mais, au pays de Voltaire et de Rousseau, elle a mauvaise presse et représente encore, pour certains, une menace pour les entreprises et l’innovation.
Aux États-Unis, pays de la libre concurrence, la « class action » constitue un robuste aiguillon pour les entreprises et supplée, souvent, aux carences d’un État peu protecteur des plus faibles. La justice joue son rôle dans l’équilibre des pouvoirs en luttant contre la mainmise du pouvoir économique sur le pouvoir politique.
Malheureusement en France, la réalité n’a rien à voir avec les indemnisations spectaculaires qui ont inspiré plusieurs cinéastes américains. « Erin Brockovich, seule contre tous », incarnée par Julia Roberts, n’aurait pas pu exister dans notre pays.
La loi Hamon de 2014, qui a introduit l’« action de groupe » en droit français, reste une loi de compromis. Huit ans après son entrée en vigueur, les très fortes contraintes juridiques imposées sous la pression du MEDEF ont eu pour conséquence d’empêcher toute action de groupe de prospérer.
Mais, c’était sans compter sur le développement du numérique et… l’ingéniosité des avocats. À défaut d’actions de groupe, les actions collectives conjointes ont pris leur essor.
Grâce aux legaltechs, rendues possibles par la loi dite Macron de 2015, les avocats peuvent aujourd’hui mettre à la disposition de leurs clients des plateformes de mobilisation dans le respect des règles déontologiques de la profession d’avocat.
C’est en appuyant sur ces possibilités nouvelles que MyLeo est devenue la première plateforme française destinée à faciliter le recours à des actions collectives en ligne.
Comme l’a dit le président de la République lors du lancement des États généraux de la justice : « Nos legaltechs permettent des innovations extraordinaires. Elles doivent être associées en matière de lisibilité, d’accessibilité et de simplicité.»
Le scandale du #Levothyrox a apporté la preuve de l’efficacité de l’action collective quand elle est relayée par les outils numériques. 3.300 victimes du laboratoire Merck, rassemblées en une seule procédure, ont obtenu gain de cause devant les tribunaux, en moins de cinq ans. Dans le cadre d’une action de groupe selon la Loi Hamon, la durée de la procédure aurait été multipliée par 3 ou 4… et l’indemnisation du préjudice moral n’aurait pas été possible.
Il manque cependant encore des outils juridiques pour rétablir un rapport de force équilibré entre les citoyens et les entreprises aux comportements délictuels. Aux États-Unis, la redoutable (et redoutée) efficacité de la « class action » repose sur deux piliers qui devraient être, selon nous, intégrés en droit français.
D’abord : l’accès à l’information et la transparence imposée aux entreprises sous le contrôle du juge. C’est ce qu’on appelle en droit anglo-saxon la « discovery ». Grâce à cette technique, les victimes des cigarettiers américains ont pu obtenir la communication forcée de 80 millions de pages de documentation interne qui montraient que la dangerosité des cigarettes était parfaitement connue des fabricants depuis 1953.
En France, la loi sur le secret des affaires protège de manière disproportionnée les industriels, les grands groupes, les éventuels pollueurs et leurs complices. L’exemple récent de l’action collective regroupant 600 personnes et menée contre des groupes leaders de la grande distribution, le ministère de la Santé et des EHPAD dans le but d'obtenir un ensemble de pièces relatives à la gestion contestée du Covid-19 lors du premier confinement est frappant. Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a tout simplement refusé aux citoyens le droit de savoir. Il est donc plus que jamais nécessaire de réformer ces dispositions et de permettre aux consommateurs d’avoir accès aux documentations des entreprises ou organismes publics dans le viseur.
Deuxième sujet d’évolution indispensable : les dommages et intérêts punitifs. Les économistes du droit l’ont parfaitement démontré : d’un point de vue économique, il peut être plus intéressant pour un industriel de supporter le risque limité et aléatoire d’une procédure plutôt que de rappeler un produit dont il connaît pourtant la dangerosité.
En droit français, on appelle cela la « faute lucrative ». L’agent économique sait pertinemment qu’il commet une infraction, mais les gains espérés étant largement supérieurs au coût de l’indemnisation, il préfère prendre le risque d’une condamnation, même si cela met en danger la vie d’autrui.
Pour le moment, le droit français a du mal à appréhender ce comportement, même devant le juge pénal. C’est la raison pour laquelle il faut reconnaître sans attendre les dommages et intérêts punitifs afin d’éviter le cynique calcul qui prévaut aujourd’hui.
Des modifications juridiques seront également nécessaires pour savoir comment répartir les dommages et intérêts entre les victimes actuelles et futures, comment engager des campagnes d’information sur la dangerosité d’un produit, comment soutenir les victimes enlisées dans les procédures...
Aux États-Unis, la justice confie à des trusts le soin de gérer les indemnisations. Pourquoi ne pas imaginer confier ces fonds à des fiducies placées sous le contrôle d’un juge, comme cela existe en matière d’expertise ?
L’instauration de ces mesures permettrait, selon nous, de rétablir l’égalité des armes entre les puissants et les citoyens, entre les sachants et les consommateurs, entre les trompeurs et les trompés, entre ceux qui ont tout le temps d’attendre et ceux pour qui la lenteur des procédures est synonyme de frais de plus en plus importants à supporter.
Développer les actions collectives en France permettrait non seulement à nos concitoyens aux revenus les plus modestes, en s’appuyant sur la force du numérique, de mutualiser les frais pour défendre leurs intérêts mais aussi de redonner confiance dans un système judiciaire, aujourd’hui en proie à la défiance voire au complotisme.
Arme anti-lobby, l’action collective deviendrait ainsi une réponse au désarroi démocratique dont souffre notre société. Il ne resterait plus qu’aux Erin Brockovich de France à s’emparer de ce nouveau moyen pour faire advenir la justice pour tous
Christophe Lèguevaques, avocat au barreau de Paris



