La nouvelle a circulé. Les résultats du TIMSS et du PISA, deux concours qui évaluent le niveau de nos élèves et ceux de nombreux pays, sont arrivés. Et malheureusement, notre beau pays des Lumières n’a pas vraiment brillé par ses compétences… Les élèves français sont des cancres. Quand on sait que la participation au TIMSS est basée sur le volontariat des institutions et que la France n’avait plus participé depuis 1995, on se demande… Mesdames et Messieurs des gouvernements Chirac et Sarkozy connaissaient-ils l’ampleur du problème et ne voulaient-ils pas cacher la misère en refusant d’inscrire ses élèves au TIMSS ? Encore pas de chance pour le gouvernement Hollande, son courage (ou méconnaissance) en re-participant au TIMSS n’a pas vraiment été récompensé.
Bref, c’est bien beau de se plaindre, mais faut-il encore proposer des solutions. J’ai entendu ici et là des petites recettes psychologiques ou pédagogiques pour aider nos valeureux élèves. Hmm mouais. Pas certain que cela suffise. Et si les causes étaient plus profondes que ça ? Comment savoir quel est le problème exactement ? Eh bien, le TIMSS offre tout un tas d’information pour aider à comprendre ce qui fait qu’un pays a réussi au test ou pas du tout (comme la France) : heures passées en classe, à faire les devoirs, écarts sociaux, moyens des écoles, charges de travail des enseignants… Et ces données ont été collectées pour 49 pays, et plusieurs niveaux de scolarité (CM1 et 3e, même si la France n’a participé qu’en CM1). Autrement dit, une mine d’information pour savoir ce qui plombe les résultats scolaires ou les améliore. Et ce qui est assez louable avec le TIMSS, c’est que toutes ces informations sont accessibles et téléchargeables ici : http://timss2015.org/. Si vous avez Excel ou Libre office, vous pouvez donc vous aussi jouer avec les statistiques et les faire parler, c’est gratuit.
Si cela ne vous dit rien, ça tombe bien, je l’ai fait pour vous et vous propose un petit résumé de ce que j’ai trouvé. Afin de comprendre ce qui suit, sachez tout d’abord que le TIMSS n’évalue que les maths et les sciences. Non pas que le reste n’a pas d’importance, mais il faut bien commencer quelque part. Ensuite, je vous propose de commencer par un petit rappel sur deux-trois notions de statistiques, car contrairement à nos politiciens, je ne veux pas que vous gobiez cru ce que j’ai à vous dire, et préfère que vous ayez les outils pour comprendre et vous forger votre propre opinion en toute connaissance de cause.
Les statistiques, c’est magique
En science, si on veut comprendre un problème, on le reproduit en laboratoire et on essaie des solutions qui vont réduire le problème en question. Par exemple, on teste des médicaments sur des animaux préalablement rendus malades, jusqu’à en trouver un qui traite la maladie. Pour étudier les problèmes de société humaine, les choses se compliquent : on se refuse à utiliser nos congénères comme cobaye d’expériences sociologiques. L’éthique nous empêche donc de tester comme dans un laboratoire l’influence de tel ou tel facteur sociologique sur un problème.
On a alors recours à un autre outil : sans interférer sur la vie de nos concitoyens, on mesure certains paramètres et on définit la relation entre eux pour tirer des conclusions : c’est ce qu’on appelle la corrélation statistique. Par exemple, prenons les résultats au test de maths et le nombre d’heures de cours de maths, tous deux mesurés par le TIMSS. D’après le graphique 1, on peut conclure qu’il n’y a aucune relation entre résultats au test et heures passées en classe. On peut dire cela grâce à la ligne tracée qui définit leu relation : elle est horizontale. La valeur « R² » nous renseigne sur la force de leur relation. Plus elle est proche de 0, moins elle est forte, comme ici. Autrement dit, quel que soit le volume horaire de cours de maths, le niveau au TIMSS reste le même de manière générale. Surprenant, n’est-ce pas ?
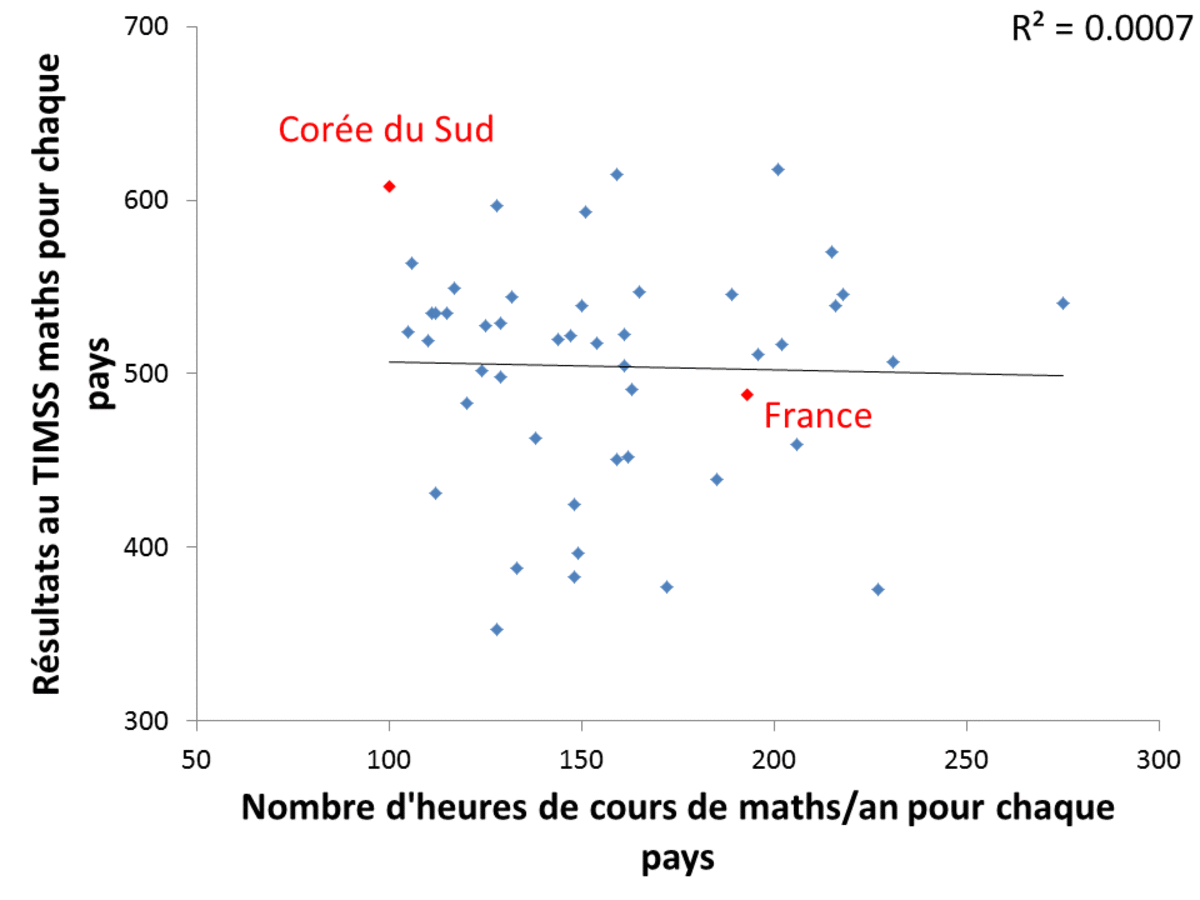
Agrandissement : Illustration 1
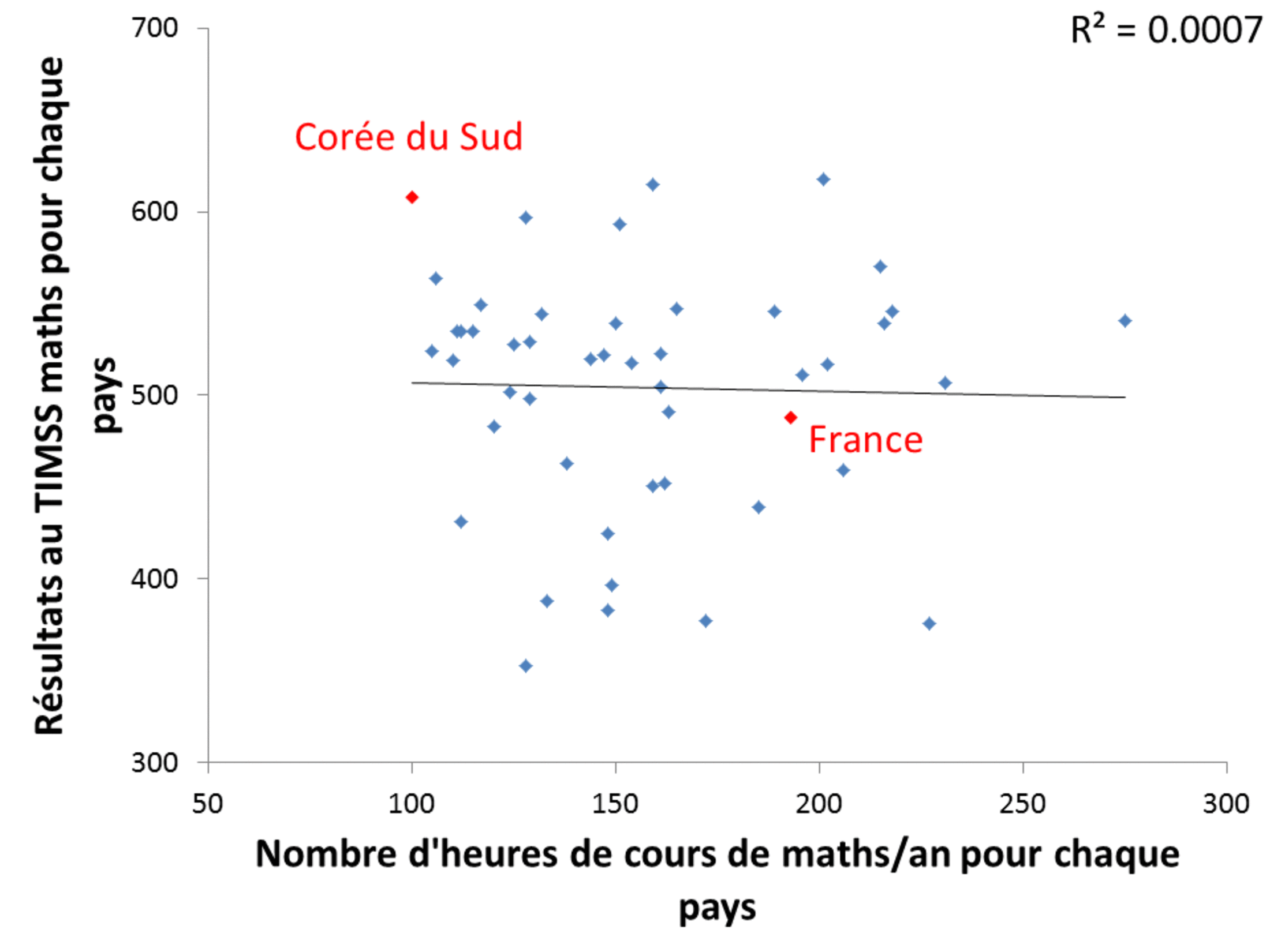
A l’inverse, s’il y’a une corrélation entre deux choses mesurées, celles-ci peuvent aller dans le même sens (on parle de corrélation positive), ou dans le sens inverse (corrélation négative). Il y a par exemple une corrélation positive entre les résultats au TIMSS et les ressources pédagogiques disponibles à la maison. Cela veut donc dire que plus un élève aura un bon environnement de travail à la maison, plus il aura de bons résultats scolaires (représenté par la ligne ascendante dans le graphique 2). Logique. La corrélation négative fonctionne de façon inverse : par exemple, plus les problèmes de discipline sont importants dans une classe, moins les résultats au TIMSS sont bons (ligne descendante graphique 3). Logique aussi ? On y reviendra.
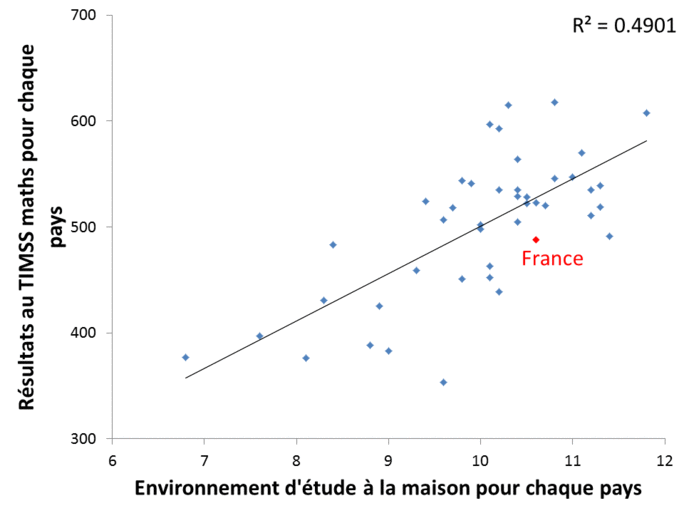
Agrandissement : Illustration 2
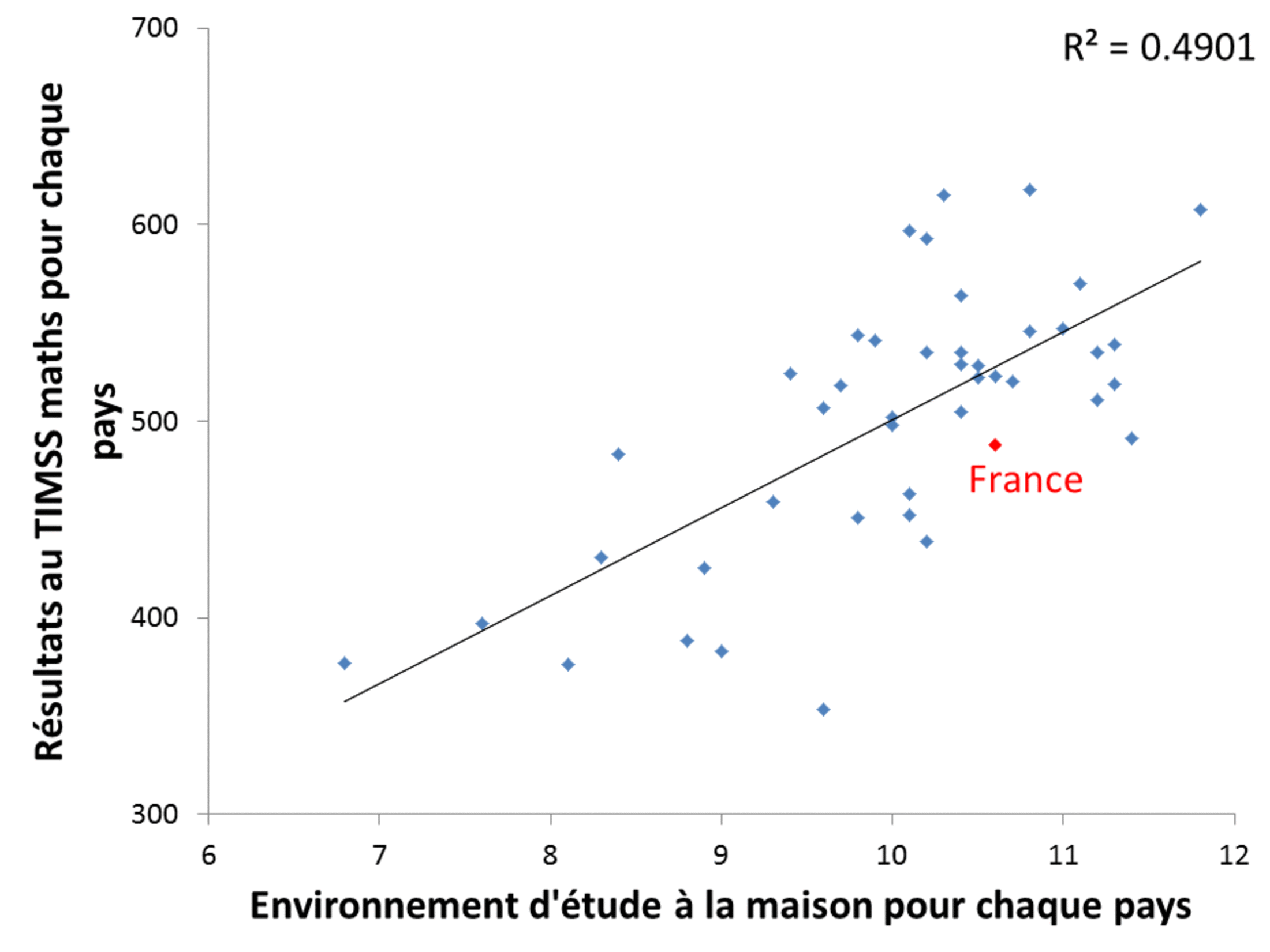
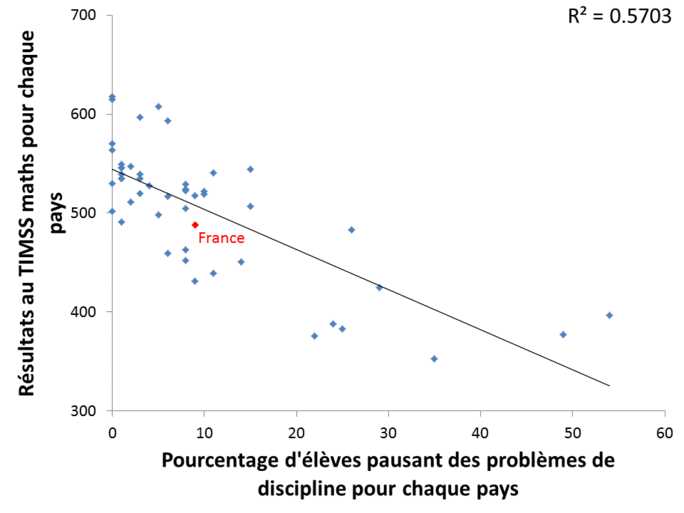
Agrandissement : Illustration 3
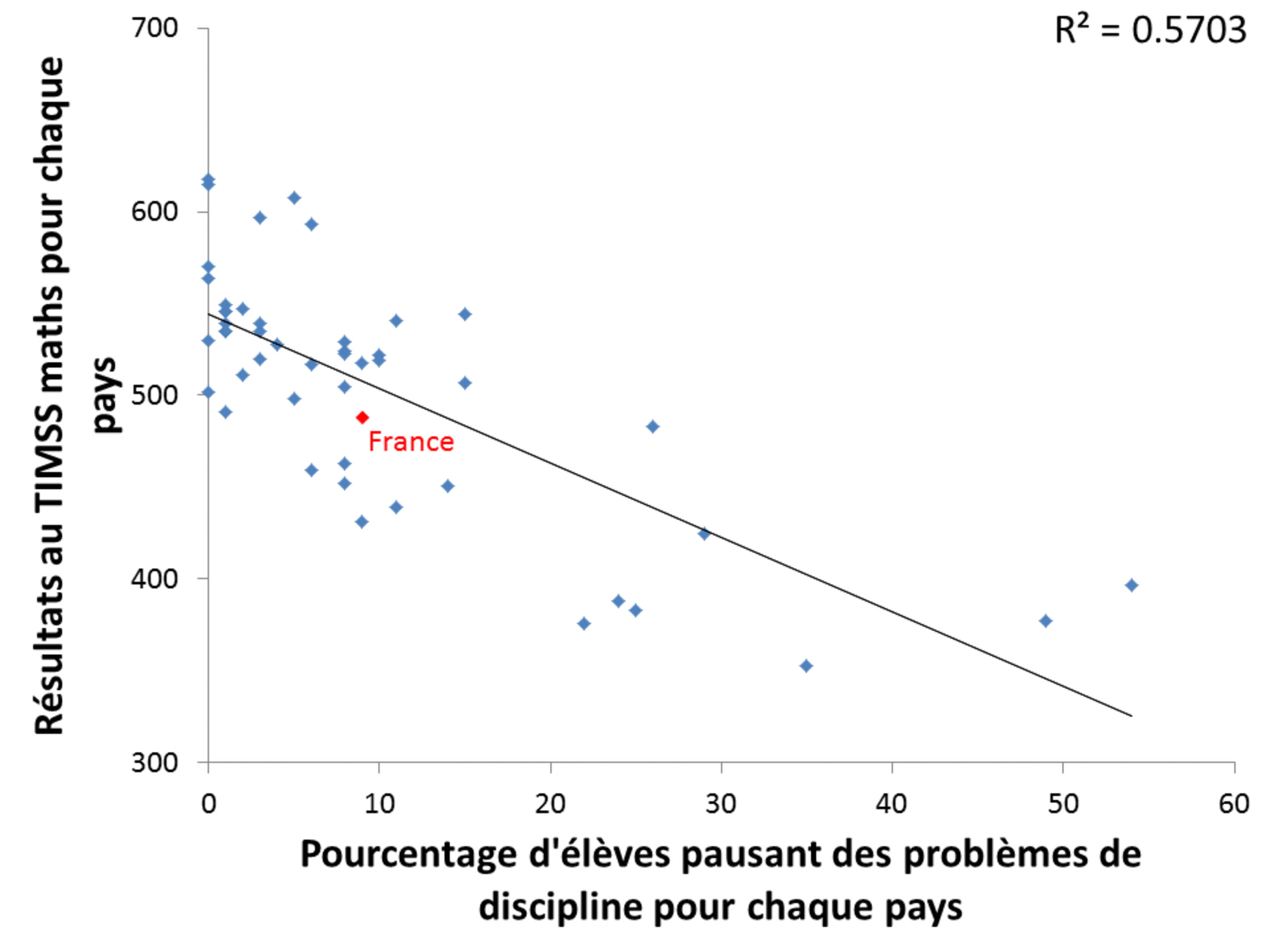
Mais a-t-on vraiment besoin d’outils statistiques pour savoir quel est le problème minant le niveau de nos élèves ? Après tout, il suffit de regarder dans le pays voisin qui cartonne en maths, et de faire pareil chez nous. Et nos politiques sont friands de cette stratégie. Sauf qu’il y a un problème à ça. Reprenons le cas de l’effet du temps passé en classe sur les résultats au TIMSS. Un candidat à la présidentielle 2017 pourrait vous dire : « En France, on passe énormément d’heures en classe et les résultats sont terribles, alors qu’en Corée du Sud (point rouge sur le graphique 1), les élèves passent très peu d’heures en classe et ont des résultats bien meilleurs. Réduisons donc le temps passé en classe pour améliorer le niveau. » Et ce serait un raisonnement faux… Car on l’a déjà vu, si on prend en compte l’ensemble des données du TIMSS, il n’y a absolument aucun effet du temps passé en classe sur le niveau scolaire. Certains pays étudient beaucoup et réussissent bien, d’autres étudient peu et réussissent tout aussi bien, d’autres étudient beaucoup et échouent etc., etc. Bref, aucun rapport. Prendre le cas particulier, ce que font très souvent nos politiques (notamment sur des sujets brûlants), est un moyen de convaincre aussi facile que fallacieux. C’est comme dire que le réchauffement climatique est un mensonge car l’hiver cette année est rude. Alors oui, si l’on veut vraiment comprendre pourquoi nos élèves ne réussissent pas bien à l’école et améliorer le problème de fond, il faut avoir un moyen plus solide d’étudier la situation. Utilisons donc les outils statistiques, et voyons ce qu’ils nous disent.
Soyons honnêtes cependant : une corrélation ne permet pas de tisser un lien de cause à effet entre deux paramètres. Simplement une relation mathématique. Mais malheureusement, comme indiqué plus haut, c'est le seul outil dont toutes les études sociologiques disposent quand il s'agit de l'humain. Car encore une fois, établir un lien de cause à effet implique des expérimentations que l'éthique nous interdit. Ce qui suit est donc avant tout une opinion, une interprétation des corrélations disponibles et une proposition de pistes pour nos politiques. Car pour prendre une décision lourde de conséquence, il faut avoir des pistes, qui est la seule valeur à donner aux corrélations statistiques. Et si une piste indique que tel ou tel facteur pourrait être lié au niveau scolaire, ou inversement ne le serait pas, il me parait sage d'opter pour le premier plutôt que le second.
Les Français aiment bien râler
On l’a vu, le temps passé en classe n’a pas d’influence sur les résultats scolaires, même si la France est un des premiers pays en termes horaires. Pas de panique donc, si vous avez l’impression que le programme scolaire réduit comme peau de chagrin, cela ne veut pas dire que les résultats en pâtiront.
Puisqu’on en vient aux impressions, deux paramètres mesurés dans le TIMSS concernent l’appréciation faite par les parents : l’importance, selon eux, des mathématiques et des sciences dans la vie future de leurs enfants, ainsi que leur appréciation du niveau de l’école où sont leurs enfants. Et devinez quoi ? La France se classe confortablement parmi les derniers pays : les parents français ont une très mauvaise opinion de l’école de leurs enfants, et estiment que les maths et sciences ne sont pas importantes pour la réussite de leurs enfants. Heureusement, grâce à l’outil statistique, la magique corrélation, on se rend compte qu’il n’y a pas de relation entre résultats scolaires et opinions des parents. Autrement dit, la disposition des parents vis-à-vis d’une matière n’influence pas le niveau de leurs enfants dans cette matière (et c’est bien). Egalement, les parents, en plus d’être sévères en France, n’évaluent pas correctement le niveau de l’école de leurs enfants. J’imagine qu’un parent veut toujours le meilleur pour son enfant et n’est donc jamais satisfait, mais un conseil, tâchez d’être un peu plus indulgents et objectifs avec l’école: ça ne changera rien au niveau scolaire (c’est prouvé statistiquement) mais vous vous ferez moins de tracas.
Une autre opinion est étudiée dans le TIMSS : celle des enseignants. Le TIMSS leur a demandé l’état des conditions matérielles à l’école, des conditions de travail en termes de charge ou de tâches extra-pédagogique (administration), et leur satisfaction. Et surprise… Les enseignants français ont estimé que les conditions matérielles à l’école sont déplorables, qu’ils ont une charge de travail trop importante et trop de tâches extra-pédagogiques, classant la France, encore une fois, dans les derniers pays pour ce paramètre. En soit, peu importe, car la question importante est de savoir s’il y a, d’après les données du TIMSS, une influence des conditions de travail à l’école sur la performance des élèves. Et là, M. Fillon et consorts de droite vont être contents : la réponse est non. Les conditions peuvent être exécrables et les enseignants débordés, le niveau peut toujours être excellent, comme en Russie par exemple, et vice versa. Pas d’effet, qu’il soit positif ou négatif. Ne nous méprenons pas : on peut supposer que les enseignants ayant le souci de fournir à l’élève le meilleur niveau possible, s’adaptent et compensent des conditions de travail sous-optimales par une implication plus importante. Réduisez donc le nombre de postes, M. Fillon, le niveau scolaire ne baissera pas, les enseignants suivront. Enfin, jusqu’à un point de rupture…
En conclusion, il semble que l’étude TIMSS confirme une chose bien connue : les Français adorent râler. L’école n’échappe pas à ce hobby auquel s’adonnent aussi bien parents qu’enseignants. Nous avons également vu que plusieurs paramètres qui, intuitivement, seraient importants pour le niveau de nos élèves, sont en fait totalement impuissants à changer quoi que ce soit. Mais alors, quelque chose peut-il changer la donne ?
Pour remonter le niveau scolaire, réduisons les écarts sociaux et augmentons la mixité sociale
Le TIMSS a mis en lumière un fait plutôt déprimant : dans chacun des 49 pays participants sans exception, les élèves de milieux défavorisés réussissent moins bien que les élèves de milieux aisés. Pas un seul pays n’a réussi à donner un accès équitable à l’éducation, sans distinction de classe. Pas un. Ceci est d’autant plus terrible que cet écart est observé très tôt, dès le CM1. Autrement dit, le milieu social a déjà fait son œuvre quand l’enfant a 9-10 ans, et toute mesure politique visant à améliorer les choses après servirait tout au plus comme bandage sommaire à une hémorragie commencée bien plus tôt. Alors, certes, des pays ont réussi à réduire l’écart entre classes de manière conséquente. Citons, par exemple le n°1 dans ce domaine, la Slovénie, dont les résultats des élèves défavorisés ne sont « que » de 1,3% inférieurs à ceux des élèves aisés. Vous vous demandez sûrement comment la France, pays des droits de l’homme, de l’école publique gratuite etc., se situe. Eh bien, désolé de vous décevoir, mais comme cela a déjà été mentionné dans d’autres articles ( http://www.lemonde.fr/ecole-primaire-et-secondaire/article/2013/12/03/classement-pisa-la-france-championne-des-inegalites-scolaires_3524389_1473688.html ; https://www.cnesco.fr/fr/comparaison-pisa-timss/volet-mathematiques/analyse-des-resultats-timss/ ), la ségrégation sociale en France est l’une des pires parmi les pays étudiés… En France, l’écart de résultat au TIMSS entre élèves défavorisés et aisés est de 10% ! C’est bizarre, il me semblait que la devise de notre pays était Travail, Famille… Euh non, je voulais dire Liberté, Egalité, Fraternité. Cependant, pas de panique, en termes d’équité sociale à l’école, la France est toujours devant les Etats-Unis, l’Afrique du Sud ou la Turquie. Oups, en fait, il me semble que ces pays sont connus pour leur fracture sociale extrême… Ca y est, vous paniquez ?
Soit. Mais après tout, au diable l’équité sociale. L’important est le chiffre. Les résultats scolaires au niveau national. Notre question de départ était bien de savoir comment améliorer le niveau des élèves français en général, et avec ou sans ségrégation sociale, ce n’est qu’une question de goût. A moins que... Dans les analyses statistiques, figurez-vous qu’on trouve que plus l’écart élèves riches-élèves pauvres est grand, moins les résultats nationaux au TIMSS sont bon. Autrement dit, les pays qui ont réduit les écarts sociaux ont vu leur niveau scolaire global augmenter. Pas besoin d’être Einstein pour comprendre ce qui se passe ici : en améliorant le niveau des élèves défavorisés, une population conséquente (et grandissante), le niveau scolaire moyen du pays augmente. Simple me dites-vous ? Pourtant, on ne peut pas dire que ce problème ait été la grande préoccupation de nos politiques ces dernières décennies. Prenons même des candidats à la présidentielle 2017 qui ont dévoilé leur programme sur l’éducation. M. Fillon propose de remettre les devoirs obligatoires à l’école primaire (Fillon.fr). Non seulement on ne voit pas trop comment cela va régler les écarts sociaux, mais en plus, le TIMSS nous montre que la quantité de devoirs donnés par le professeur n’a aucune conséquence sur le niveau scolaire. Bref, on est mal parti. M. Macron propose d’accroitre l’autonomie des établissements ( http://www.directmatin.fr/politique/2017-01-06/presidentielle-2017-le-programme-demmanuel-macron-744341 ). A côté de la plaque. Marine le Pen parle d’arrêter le collège unique et de rétablir l’apprentissage à 14 ans (frontnational.com). Trop tard Mme Le Pen, l’écart scolaire entre pauvres et riches est, on l’a vu, déjà bien établi avant le collège. Pire même : iraient donc en apprentissage dès 14 ans les élèves au niveau général moins bon pour « éviter de perdre du temps » ? Les élèves pauvres, qui ont un niveau scolaire plus faible dès le CM1, iraient donc pour les métiers manuels alors que les élèves riches, aux meilleurs résultats, s’orienteraient vers les métiers de cadres et autres classes dirigeantes ? Pour maintenir l’inégalité du système tel qu’il est, je trouve cette idée très bien réussie. Quant aux candidats de la gauche, Jean-Luc Mélanchon n’a pas encore de programme précis. Les candidats à la primaire PS comme François de Rugy proposent des dotations supplémentaires aux zones/réseaux d’éducation prioritaire, les fameuses ZEP/REP ( http://www.ifrap.org/comparateur-socialistes# ). Les classifications en ZEP, soyons justes, étaient une tentative louable de réduire les écarts sociaux. Malheureusement, les effets n’ont pas été ceux escomptés, et ce système a été inefficace pour lutter contre les ghettos scolaires ( http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1312481-rep-ou-zep-ecole-prioritaire-un-statut-inefficace-qui-maquille-les-ghettos-scolaires.html ).
A propos des ghettos scolaires, les données du TIMSS montrent que les écoles composées en majorité d’élèves défavorisés (nos ZEP/REP) réussissent moins bien. Et de manière logique, les pays avec moins de ces ghettos scolaires ont non seulement un meilleur niveau scolaire global, mais aussi un plus faible écart entre élèves aisés et pauvres. Autrement dit, les pays avec un système scolaire où la mixité sociale prévaut et où il y a peu de ghettos scolaires obtiennent de meilleurs résultats à l’école. Pourquoi alors ne pas arrêter avec les ZEP ? Pourquoi ne pas utiliser des écoles en dehors des ZEP, comme terrain « neutre » où des élèves de tous horizons sociaux seraient activement mélangés ? Le vivre ensemble commence là. Et il est fort à parier que les problèmes de discipline, qui nuisent gravement au niveau scolaire d’après les données du TIMSS, réduiraient. En effet, d’après ces mêmes données, plus le nombre de ZEP est important dans un pays, plus les problèmes de discipline sont élevés. Et plutôt que de proposer toujours plus de sanctions, de « rétablir l’autorité du professeur » et autres slogans des candidats de droite et extrême droite, arrêtons donc avec les ghettos scolaires. Ce serait un bon début pour réduire les écarts sociaux et de fait augmenter le niveau scolaire des Français. Un autre facteur à développer concerne l’environnement familial. Nous l’avons vu, le TIMSS montre qu’il est important pour la réussite de l’élève. Pourquoi donc, par exemple, ne pas offrir des livres, donner un accès internet plus facile ou donner des cours gratuits aux parents dans les foyers défavorisés ?
En bref, si la France réussissait à réduire les écarts sociaux entre élèves, son niveau scolaire grimperait. Si certains candidats à la présidentielle 2017 ne trouvent pas révoltant que la réussite scolaire soit encore et toujours déterminée par le milieu social de nos citoyens, qu’ils cherchent au moins à réduire les écarts sociaux pour améliorer les statistiques scolaires nationales. Mon vote ira à celui/celle qui aura des propositions concrètes et novatrices dans cette direction. Maintenant, même si les élèves français aisés réussissent bien mieux que leurs camarades défavorisés, ils n’ont pas pour autant un niveau extraordinaire. Réduire les écarts sociaux ne sera donc qu’une étape dans l’amélioration des résultats français. Il va falloir changer les méthodes d’enseignement en général, en oubliant les vieilles recettes de plus d’heures de classe, plus de devoirs, la semaine de 4 jours contre 5, et autres mesures dont l’inefficacité a été démontrée par le TIMSS. Des idées, messieurs/mesdames les candidat(e)s 2017 ?



