La grille d'analyse géopolitique a radicalement changé au moment de la passation de pouvoir en janvier. Loin de s'accorder avec l'ancien président Biden, le président Trump est en totale rupture avec ce qui a constitué la politique internationale des État-Unis d'Amérique jusqu'ici.
Dorénavant, il n'est plus question d'alliances « occidentales » basées sur des « valeurs communes » dans un cadre de « respect mutuel » comme on pouvait l'entendre entre le président français et l'ancien président étasunien. Cette nouvelle ère est celle du rapport de force, si possible la plus virile possible, avec une forme de brutalité affichée et revendiquée.
L'OTAN, sur laquelle les européens naïfs pensaient pouvoir compter, a été désavouée par Trump, qui exige désormais que les pays augmente de quelques points de PIB leurs budgets militaires... dans le but d'acheter des armes américaines évidemment ! Les alliances idéologiques sont devenues inneficaces face à un président prêt à travailler avec tout le monde, du moment qu'il s'en dégage argent et richesse.
Car elle est bien là la bascule : la géopolitique de Trump est économique. Marco Rubio, secrétaire d'État nommé par Trump, expliquait ainsi vouloir se défaire des « fantasmes idéalistes » pour s'occuper avant tout des « intérêts nationaux essentiels des États-Unis ». Comprenez que désormais, peu importe les valeurs : pourvu qu'il y ait de l'argent à aller chercher, les États-Unis seront de la partie !
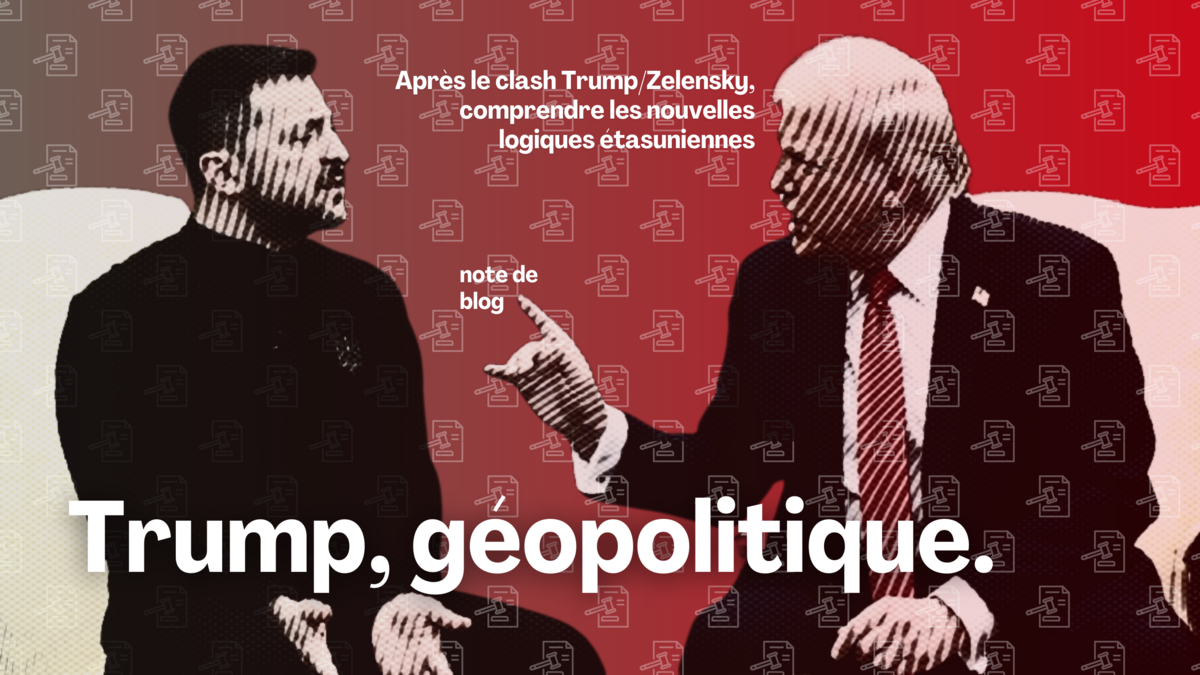
Agrandissement : Illustration 1
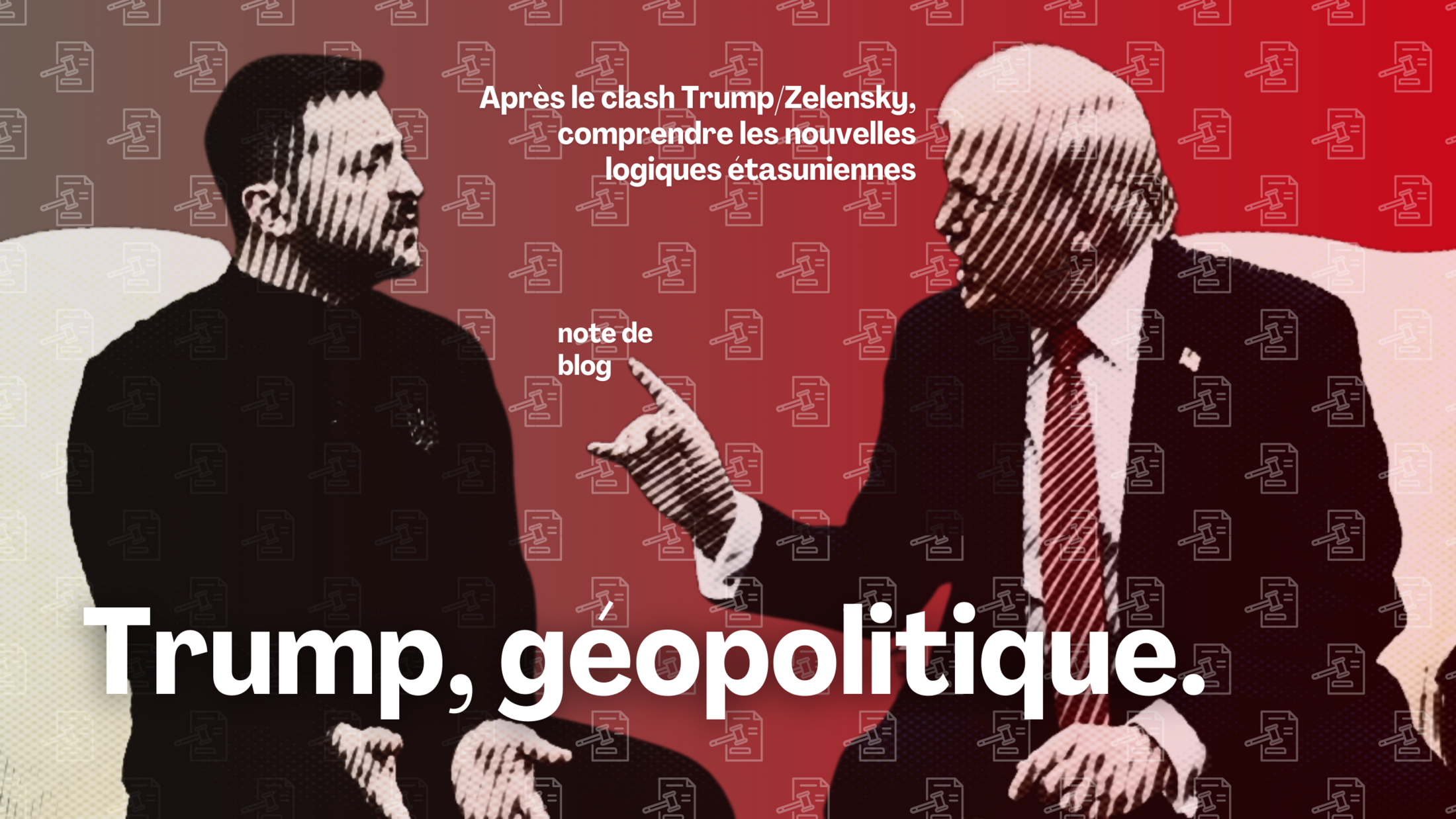
En résumé, cette attitude de provocation, d'humiliation et de menaces permanentes à l'égard des alliés historiques des USA est une façade qui prépare aux chocs à venir. Le renversement d'alliance qui place désormais les États-Unis du côté de la Russie et non du côté de l'Ukraine n'est pas une folie, une lubie ou une stupidité de la part de Trump : c'est un des maillons qui constitue la vaste chaîne qu'il se fait de la géopolitique. Empêcher l'émergence finale de la Chine, rester les premiers dans l'ordre mondial, extraire et utiliser autant de ressources que possible pour faire tourner l'économique américaine.
Ainsi, on remarque comment Trump et son administration, petit à petit, conditionnent leur soutien stratégique et militaire aux différents pays qui en bénéficie. L'exemple flagrant est celui de l'Ukraine, où le président Trump n'a pas hésité à employer comme à son habitude de grossières contre-vérités pour tenter de semer le doute sur les moyens financiers envoyés à l'Ukraine, avant de finalement déclarer que celle-ci devrait rembourser l'aide des USA. Et aussi accepter que les États-Unis d'Amérique pillent son sol de ses richesses. Rien que ça. Antérieurement, Marco Rubio (encore lui !) avait soumis l'idée de faire payer Taïwan pour la protection étasunienne.
Bref, partout où les USA se trouvent en position avancée, les alliances, les logiques idéologiques et les relations diplomatiques reculent au profit de l'argent et de la cupidité sur l'autel d'un capitalisme débridé et sauvage incarné par le président-milliardaire Trump à la tête de la première puissance mondiale. Pour autant, peut-on dire que ce comportement est une nouveauté ? Certes exacerbé avec Trump, au regard de l'histoire, il est constant dans la géopolitique américaine.



