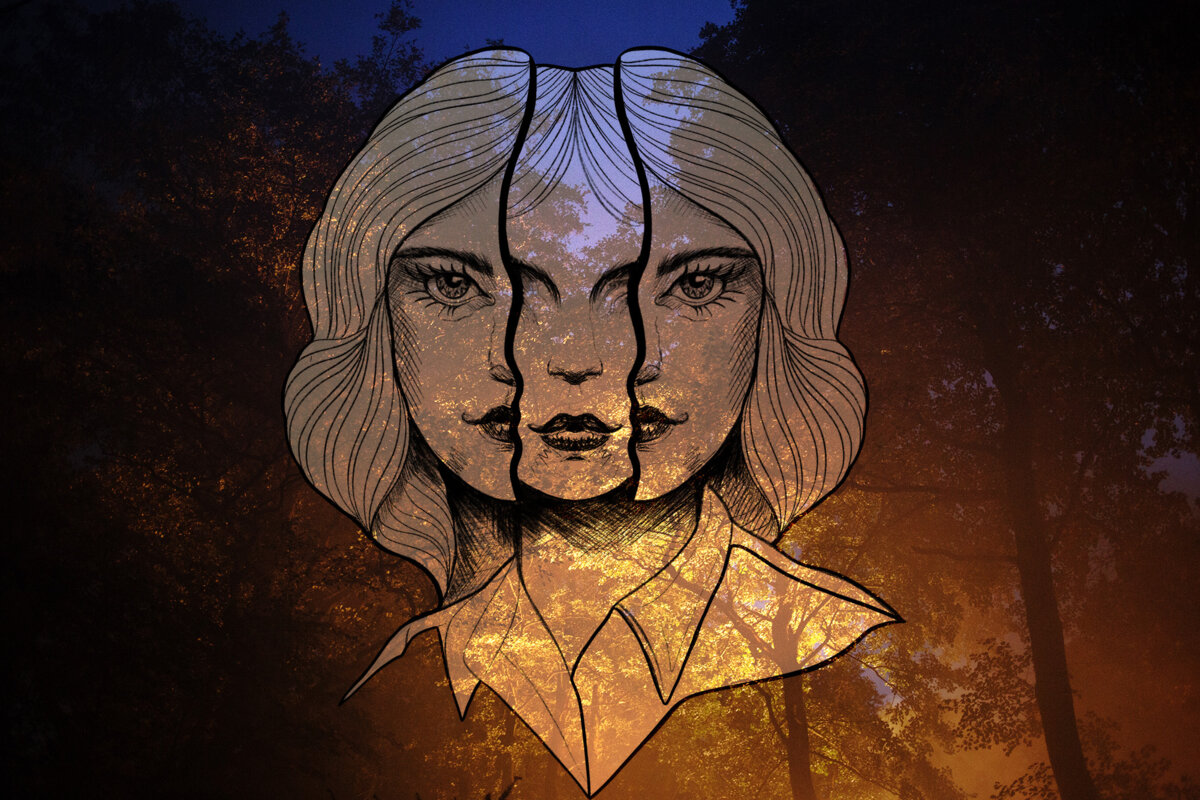
Agrandissement : Illustration 1

Nous, collectif de femmes, souhaitons réagir à l’article de Donatien Huet, intitulé « Violences sexuelles : les musiques extrêmes face à leurs démons », publié dans Mediapart le 22 mai 2021. Partout, les débats se focalisent sur la dénonciation des violences sexuelles. C’est aussi le cas dans notre milieu, la scène punk/metal/hardcore, sensible en partie aux questionnements et positionnements politiques militants progressistes. Malgré la volonté affichée d’être en alerte sur ces diverses thématiques sociales, on y retrouve néanmoins la reproduction de pratiques de domination, et la transposition des mouvements médiatiques qui les révèlent et les condamnent (#metoo ⇒ #musictoo, #balancetonporc ⇒ #balancetascene). Une de ces pratiques prend la forme du call out : dénonciations publiques suite à des propos ou comportements vus comme politiquement ou moralement condamnables, qui a comme conséquence directe le canceling : la mise à l’écart des accusé·e·s de leurs cercles sociaux. Ces accusations mènent à des pratiques excessives dont nous souhaitons ici détailler les enjeux.
Nous sommes issues de cette scène : organisatrices de concerts, musiciennes, productrices, techniciennes, photographes, spectatrices, graphistes, ou tout simplement passionnées. La plupart d’entre nous ont subi, à un moment de leur vie, des violences psychologiques, morales, physiques et/ou sexuelles de la part de personnes en lien ou non avec notre milieu, sans pour autant que ces situations ne soient à l’origine de notre prise de parole. Nous ne souhaitons pas nous exprimer au nom de toutes les femmes de notre scène, ni au nom de toutes les femmes en général. Nous respectons les expériences et les épreuves qui n’appartiennent qu’à celles qui les traversent. Nous espérons donc que vous lirez, critiquerez ou partagerez nos propos uniquement sur la base de ce qu’ils sont.
Notre réflexion répondant à l’article de Mediapart, il est important d’affirmer ici que nous n’accusons ni les individu·e·s ni les groupes musicaux. Nous pointons uniquement les réactions auxquelles nous avons été confrontées suite à la publication de cet article et témoignons des ressentis et des réflexions qui en ont découlé, notamment concernant l’injonction à la dénonciation. Nous ne visons pas non plus à apporter des preuves concernant les faits évoqués dans l’article, ni à rendre justice. Nous cherchons à analyser une forme de lutte et ses conséquences.
C’est dans ce contexte précis que nous nous demandons dans quelle mesure le call out et le canceling, par l’injonction à se positionner, participent à l’essentialisation des parties prenantes et à la polarisation sociale. Nous questionnons la définition, le périmètre et les degrés de la violence sexuelle. Nous interrogeons en particulier le rôle d’un journal comme Mediapart, et sa déontologie, dans ces nouveaux processus de call out/canceling liés aux réseaux sociaux : quel impact ont les méthodes d’enquête, la restitution des récits, la hiérarchisation des faits et la formulation des problèmes ? Enfin, nous proposons de réfléchir à une lutte adéquate et juste contre les violences sexistes et sexuelles, sans passer par l’utilisation de la violence sociale, qu’elle soit intentionnelle ou non.
Le call out : une méthode de dénonciation dans le but de rendre justice
Depuis octobre 2020, dans le microcosme punk-rock français, un milieu où tout le monde se connaît ou presque, la prise de parole contre les violences sexistes et sexuelles s’est intensifiée, notamment sur le réseau social Instagram. Cela nous a d’abord questionnées sur notre positionnement comme témoins, proches, victimes, femmes, ou féministes mais aussi en tant que membres d’une communauté qui aspire à agir selon une pensée humaniste, activiste ou militante. En privé comme en public, les témoignages et les réactions se sont multipliés, nous poussant à réfléchir sur les rapports de domination.
Le mouvement #metoo est une avancée importante car il permet, entre autres, de mettre en lumière le décalage entre les statistiques judiciaires des violences sexuelles et la réalité sociale de ces violences. En son sein, se distinguent plusieurs pratiques, dont une que les activistes appellent le call out et qui consiste à témoigner publiquement en identifiant un agresseur présumé. En conséquence, des groupes de soutien se constituent autour de la victime – et parfois indépendamment d’iel – pour réclamer l’exclusion des individus mis en cause. Le call out n’ayant que peu d’effet sur bon nombre de personnalités publiques, ce procédé est utilisé avec l’idée que les voix qui s’élèvent sont rarement entendues et que se fédérer autour d’elles permet de les rendre audibles.
Mais force est de constater que dans le milieu que nous fréquentons, un call out entraîne facilement la mort sociale des individus visés (perte d’emploi, exclusion de la communauté, du cercle social et familial, dépression). Qu’elle soit collatérale à la dénonciation ou expressément recherchée, cette exclusion opère bien souvent sans distinction de degrés quant à la gravité des accusations. Or, nous ne pensons pas que la fin justifie les moyens : écraser quelqu’un, coupable ou non, dans le but de servir une cause, de donner l’exemple ou de rendre justice, ne sert qu’à entretenir la haine et le ressentiment dont il se nourrit[1], se révélant, in fine, plus délétère qu’efficace.
Le mouvement #metoo met également en avant la nécessité de révéler les noms d’hommes influents qui, protégés par leur entourage et leur milieu, commettent des violences sexuelles en toute impunité. De véritables puissants qui abusent d’une position hiérarchique et du pouvoir que leur confère leur capital financier, culturel, social… Peut-on réellement estimer que les membres de la communauté metal/punk-rock française visés par cette pratique bénéficient d’un capital équivalent ? Par ailleurs, ce type de mécanisme répressif peut-il s’appliquer de la même manière pour le violeur et pour celui qui a eu un comportement ou une parole déplacés ? Enfin, si cette pratique est questionnable à l’échelle individuelle, qu’en est-il lorsque Mediapart, fort de son capital juridique, financier et médiatique, contribue, volontairement ou non, à la reproduire sur celleux qui ne disposent pas d’un pouvoir comparable ? Nous imaginons qu’une des ambitions de l’article de Donatien Huet était de rendre une « certaine » justice. Mais si c’est le cas, de quelle justice parlons-nous ?
De l’injonction à se positionner à l’instrumentalisation de ce phénomène
Cette méthode de call out qui appelle au canceling s’inscrit dans la dynamique des réseaux sociaux et dans l’évolution de nos usages de ces outils. Elle est donc déterminée par les spécificités de ces vecteurs d’information et de communication : immédiateté et visibilité sociale. Cela s’est récemment traduit dans notre microcosme par des publications sur Instagram qui prenaient position sur les faits décrits dans l’article. Celles-ci enjoignaient également les utilisateurs à exprimer publiquement leur soutien envers les victimes et leur engagement contre toute violence. Bien qu’indispensables, ces soutiens n’ont pas été en mesure de rendre véritablement justice aux victimes, ni de leur apporter un sentiment de sécurité. C’est ainsi que pour aller plus loin, certain·e·s sont passé·e·s à la condamnation publique unilatérale, dans une quête au nombre de partages semblant donner consistance et véracité aux accusations. Leurs publications sommaient donc de se positionner, de prendre parti en quelques minutes sur la si difficile question de la culpabilité, sans avoir le temps d’en évaluer les conséquences. On a observé que chaque silence a été et est encore interprété comme de la complicité, comme une tolérance envers les violences sexuelles et sexistes, comme un refus de soutien aux victimes ou encore comme la défense d’un système établi de domination masculine. Alors que pour certain·e·s le choix du silence, conscient ou non, devrait être vu comme une prise de recul. « Discerner suppose du temps, de la patience de la prudence »[2], de l’observation et de la distance. Par ailleurs, certaines victimes se sont retrouvées dans une situation paradoxale, ayant choisi de ne pas pratiquer le call out vis-à-vis de leur agresseur, elles se retrouvaient appelées à participer à celui d’autres. Entre l’envie d’être solidaire, parce que comprenant le vécu traumatique, et la volonté de ne pas vouloir participer à la sentence publique d’une personne, elles ont choisi de ne pas se prononcer. Afin de respecter les besoins de justice de chacune, il nous paraît donc important de dissocier soutien public et condamnation collective.
D’autre part, le positionnement des groupes ou des individu·e·s nous a questionnées sur les intentions de fond de chacun·e. Des dizaines voire des centaines de personnes, plus ou moins proches de notre courant musical et/ou d’individu·e·s en faisant partie, ont relayé l’article de Mediapart sur les réseaux, avouant parfois ne pas l’avoir lu. Quand on interroge certain·e·s à ce sujet, iels expliquent qu’iels s’y sont senti·e·s obligé·e·s, afin de ne pas être assimilé·e·s aux faits évoqués dans l’article. René Girard évoque ce phénomène collectif récurrent dans sa théorie du bouc émissaire[3] : on en jette un en pâture, afin qu’il paye pour tout le monde, que les projecteurs soient fixés sur lui et que son sacrifice lave les péchés de tous, la question de la véracité de sa culpabilité semblant presque secondaire. Par là même, on cultive une atmosphère lourde et délétère avec la menace : « attention, préparez-vous, il y aura d’autres accusés ! ». Cela a également permis à certains groupes ou individu·e·s de se positionner et de se rendre visibles dans un mécanisme d’autopromotion ou de dédouanement, sans remise en question de leur propre comportement. Parmi ces dernier·e·s s’étant exprimé·e·s, certain·e·s auraient pu avoir des comportements considérés comme discutables, parfois agresseur·euse·s, parfois dissimulateur·ice·s. Cela leur a néanmoins permis à toustes d’acquérir une légitimité auprès de certain·e·s, en tant que groupes ou personnes engagées dans cette lutte pour pointer du doigt celleux qui ne s’engageaient pas, ou asseoir une position ascendante dans des conflits interpersonnels.
Enfin les mis en cause n’ont pu obtenir de crédit lorsqu’ils se sont exprimés ou excusés : toute réponse a été d’office jugée comme acte de manipulation : les personnes ciblées n’y sont plus attaquées sur des faits, mais essentialisées autour de la seule accusation.
Contester publiquement ces méthodes devient complexe et dangereux car les individu·e·s dominant·e·s du groupe constitué d’une audience vindicative peuvent décider d’intimider, de harceler ou de dénoncer qui bon leur semble par des attaques ciblées et publiques. Les personnes critiquant cette méthode de lutte risquent de voir leurs propos qualifiés de « misogynie intégrée », de « social traîtrise » ou d’être perçues comme des « victimes-complices ». Celleux qui ne s’expriment pas se retrouvent coincé·e·s par les accusations de « silence = complice ». Les appels à la raison ou au calme sont moqués. Si pour certaines personnes, ouvrir le dialogue était important, on a de fait assisté à l’incapacité de respecter le positionnement de chacun.
Les discussions et réflexions intellectuelles qui traversent notre communauté, centrées sur la justice, la justesse, le pardon, la réintégration sont entravées par ces méthodes d’intimidation. « Son objet même semble être l’empêchement de tout dépassement moral », d’émancipation du statut de victime, et d’inscrire dans la faillite toute recherche de solutions autres que l’essentialisation des individu·e·s : que le statut des victimes et agresseurs soit figé à jamais. Ce procédé suggère que la réparation d’une victime n’est possible que par la destruction de l’agresseur, voire de son entourage, et par là même on reproduit les mécanismes avilissants de la domination que l’on prétend vouloir conjurer. Ce rapport de domination inversé, dans une terminologie victimaire, guerrière et empreinte de ressentiments, crée un climat qui entretient l’angoisse et favorise la confusion. Nous ne sommes plus ici dans une lutte d’égalité de droits et d’acquis, mais dans une lutte de pouvoir. Nous regrettons à ce titre, de voir qu’un article publié dans un organe de presse progressiste puisse cultiver ce type de terreau.
La reconstruction individuelle de chaque victime est un processus appelant des mécanismes psychologiques particuliers. Or, la récupération de ces mécanismes sur les réseaux sociaux, dans une justification du call out comme instrument de réparation, est problématique. Comment l’appropriation et la défense d’une lutte contre les violences sexuelles et sexistes ne deviennent pour certain·e·s qu’une reproduction de schémas de domination calqués sur le patriarcat ? Qu’une arme dans des relations interpersonnelles ? Ce phénomène est d’autant plus accentué lorsque ces individus jouissent d’une validation par leur audience sur les réseaux, en tant que groupes de musique, ou par leur diffusion médiatique.
Les espaces dits safe n’existent pas. Mais nous devons réfléchir à des moyens d’actions et de prévention à mettre en place, tout en restant vigilant·e·s à ne pas verser dans l’hyper-sensibilité, la sur-affectivité, la surinterprétation ou le tout répressif[4]. Les mécanismes de domination, de violence et de harcèlement sont à déconstruire et non à reproduire : les tentatives de rabaissement de l’autre ne créent évidemment pas un terrain propice à la discussion mais entraînent plutôt un nivellement par le bas des relations interpersonnelles. On ne cherche pas à améliorer les échanges et à donner de la place à chacun, mais plutôt à exclure, affaiblir ou à discréditer.
Lorsqu’on dégage le problème de son aspect passionnel, le choix de notre positionnement est pour chacune d’entre nous un choix moral. Nous ne voulons « plus apparaître comme des victimes, c’est-à-dire des sujets passifs, mais comme des êtres ayant une dignité sexuelle que [nous entendons] faire respecter et exprimer clairement, en renonçant à toute vengeance inutile »[5], en refusant de cautionner la reproduction de la domination et de l’oppression d’individu·e·s, en refusant de participer au spectacle des réseaux sociaux qui annihile le temps que l’on doit à la lucidité, à la réflexion, au discernement.
La difficulté à définir les violences sexuelles
Il apparaît très compliqué de définir l’ampleur et les contours des violences sexuelles, car ces violences restent largement méconnues. Les statistiques judiciaires et policières ne représentent qu’une petite partie d’un phénomène bien plus vaste, comme le montre l’écart de ces chiffres avec ce qui ressort des enquêtes de victimation en population générale. Cet écart s’explique par la faible proportion de victimes qui parlent à leur entourage des violences vécues, qui choisissent de porter plainte (environ une victime sur dix), qui voient leur plainte aboutir à un procès puis à une condamnation pénale (environ une plainte sur dix).
Les chiffres les plus proches de la réalité sociale de ces violences sont donc ceux issus des enquêtes de victimation[6]. Selon l’enquête Virage, environ 15 % des femmes et 4 % des hommes déclarent avoir été victimes d’une agression sexuelle ou d’un viol au cours de leur vie. Les études[7] montrent qu’une majorité des auteurs de violences sexuelles sont des hommes, entre 94 % et 98 % quand il s’agit de femmes victimes et 75 % quand il s’agit d’hommes victimes. Ces violences sont majoritairement des violences de proximité, les auteurs appartenant à l’entourage proche des victimes : famille, conjoints, ex-conjoints ou amis. Enfin, une majorité de ces violences se produit durant l’enfance et l’adolescence de la victime, pour 59 % des femmes et 67 % des hommes avant l’âge de 18 ans. Au-delà de cet aspect, les violences sexuelles recouvrent des situations très hétérogènes, impliquent des profils d’auteurs très différents, et des contextes variés, un ensemble de facteurs psychologiques et sociaux y participant.
L’article de Mediapart utilise le terme de violences sexuelles sans le définir. On pourrait penser que l’auteur de cet article se réfère à ce qui constitue les infractions à caractère sexuel définies par le code pénal dans ce champ : viol, agression sexuelle, inceste, exhibition, harcèlement sexuel, proxénétisme et recours à la prostitution, propositions ou atteintes sexuelles sur mineur·e de 15 ans, pédopornographie, corruption ou incitation à infraction sexuelle sur mineur·e, outrage sexiste, etc. Cet article tend plutôt à confondre différents niveaux de gravité, mettant sur le même plan viol, agressions sexuelles, relations affectives et/ou sexuelles complexes, paroles sexistes, entre-soi masculin. Si le propos était de mettre en évidence les lacunes et l’inefficacité du champ judiciaire en la matière, il questionnerait la complexité à définir ce qui constituerait une violence en dehors des critères de la loi. Certains actes décrits dans cet article semblent pénalement répréhensibles et il serait pertinent que l’auteur le précise de manière systématique au regard des faits concrets mis en évidence par l’enquête. Le cas échéant, il serait plus juste de signaler le manque d’informations qui permettrait de qualifier ces comportements d’agression sexuelle.
Par ailleurs, les témoignages cités par l’article évoquent aussi des expériences intimes difficiles, mais qui ne sont pas des agressions sexuelles au sens juridique du terme. On aurait pu s’attendre à ce que cet article s’en inspire pour questionner nos rapports intimes. En effet, la sexualité est un apprentissage qui se poursuit tout au long de la vie ; un apprentissage conditionné par des habitus sociaux et relationnels, une éducation genrée, une classe sociale. Tout ceci est relié à des fragilités individuelles et des histoires de vies plus ou moins traumatiques, parfois intriqué dans des contextes festifs alcoolisés et des enjeux affectifs complexes. On n’est pas la ou le même à 15 ans, à 25 ans ou à 40 ans. Et on n’a pas la même sexualité non plus. Tous les enjeux précédemment évoqués peuvent nous amener à revisiter, parfois a posteriori, une expérience affective ou sexuelle, et à y repérer des relations complexes, des vécus douloureux, des pratiques non désirées, des contraintes, des déceptions. Pour autant cela ne veut pas dire que la ou le partenaire était intentionnellement malveillant·e, ou qu’iel cherchait à heurter. En dehors du cadre des violences définies par la loi, la sexualité peut impliquer des mauvaises expériences, des ratés, des regrets, des conflits, des blessures.
La libération de la parole des victimes est importante et le pouvoir de la désignation d’un agresseur dans la sphère publique implique une réflexion et une évaluation rigoureuses des informations par les acteur·ice·s concerné·e·s. Les conséquences sur la personne mise en cause peuvent être considérables, alors qu’il est pourtant établi qu’une accusation ne vaut pas la culpabilité[8]. Au-delà de la question de la définition, il s’agirait de réfléchir également aux modalités d’interventions possibles en dehors du champ judiciaire.
Relais médiatiques des vécus de violences sexuelles : quelle déontologie ?
« Ce sont les professionnels des médias qui mènent le débat, jugent, décident si l’émotion a atteint l’objectif fixé. » (François Jost, 2007).
Si l’enjeu de relayer la parole de victimes est central pour la reconnaissance de ces violences par le grand public et les instances au pouvoir, le rôle des médias est donc déterminant. Mais comment rester en alerte face à un support informationnel qui semblait pour une majeure partie d’entre nous pourtant légitime ? L’article de Donatien Huet, paru dans Mediapart, a ébranlé la confiance que nous avions pour certaines, en ce media. Contactées pour certaines d’entre nous en tant que victimes ou témoins par le journaliste, connaissant des personnes impliquées de près ou de loin, ou tout simplement faisant partie de ce milieu, nous sommes aujourd’hui aux premières loges des répercussions de cet écrit.
La rencontre et les échanges des journalistes avec des personnes victimes sont des moments très délicats. Il ne s’agit en aucun cas de remettre en question un vécu, ou de fragiliser des personnes déjà traumatisées par des expériences de vie. La responsabilité des auteurs et des médias est dans ce qu’ils font de ces récits. Nous nous demandons d’abord sur quels critères s’est basé Donatien Huet pour faire son enquête et ses choix : le nombre d’accusateurs·trices ? La notoriété des mis en cause ? La disparité des témoignages ? La gravité des faits reprochés ?
Quand nous parlons de rencontre, il n’y en a pas vraiment eu ici : l’auteur n’a été en contact avec les personnes citées dans son article que par téléphone ou messagerie. Il semble pourtant fondamental que l’écoute d’un témoignage de victime se fasse en personne[9]. Au sujet du procédé de sélection des témoignages, Donatien Huet a expliqué à l’une d’entre nous, post parution, que sur la soixantaine de personnes interrogées, il avait recueilli une trentaine de récits de victimes mais que seulement une dizaine apparaissait dans l’article, à cause entre autres de la contrainte de nombre de caractères. Parmi la dizaine de récits de victimes publiée, certaines nous ont confié n’être pas satisfaites du traitement de leur témoignage, une vingtaine d’autres ont dû accepter d’avoir retraversé leur traumatisme en faisant confiance à quelqu’un qu’elles ne connaissaient pas, pour finalement découvrir que leur témoignage ne serait pas publié. On parle alors d’un choix de l’auteur, et donc d’une hiérarchisation des témoignages. Pourtant, celui qui recueille des récits de victimes devrait être un « interlocuteur qui assure au témoin que sa parole ne restera pas sans écho, et ne retombera pas dans le silence dont il a souffert lors des persécutions »[10]. Témoigner d’une violence à vide peut être quelque chose d’extrêmement douloureux. L’auteur s’est voulu rassurant auprès de certaines d’entre elles, inquiètes du traitement ou de l’absence de leur témoignage, en leur faisant espérer la parution d’un second article. Par ailleurs, trois personnes accusées de façon anonyme dans cet article nous ont confié ne pas avoir été contactées par le journaliste. Là où il est dommageable d’avoir négligé leur récit contradictoire, c’est que les réseaux sociaux, en public ou plus souvent par groupes privés ont fini par lever l’anonymat des mis·es en cause et des victimes qui en subissent toujours les répercussions.
Parmi celleux qui ont témoigné ou qui sont concerné·e·s par cet écrit, certaines furent offensées d’avoir été contactées spontanément par l’auteur qui les estimait victimes a priori. Il se dégage chez beaucoup un sentiment de surprise quant au contenu de l’article et de ce qu’il a produit, mais aussi de tromperie, causé par un individu bénéficiant de la légitimité du media qu’il représente. Des vécus douloureux, traumatiques, n’ont servi sous couvert d’enquête que d’outil de traque pour un article qui n’analyse ou ne déconstruit rien, mettant parfois au banc des accusés des personnes à la culpabilité subjective ou relative pour des attitudes ou des comportements décrits comme seulement inappropriés ou offensants[11].
Après avoir été trahies par la justice, certaines d’entre nous ont eu le sentiment d’avoir été trahies par le journalisme. Si l’ambition de cet article était de mettre en lumière les injustices là où la communauté et les institutions ont failli, qu’en est-il de la responsabilité de Mediapart quand il les reproduit ?
Au-delà de la démarche du journaliste en amont, c’est également le contenu de l’article qui mérite d’être étudié. En effet, la lecture de témoignages de violences sexuelles est toujours chargée. « Elle requiert du temps tant la première lecture est magnétisée par les faits dramatiques. Il faut néanmoins dépasser ce stade pour s’intéresser à l’enveloppe narrative qui en dit beaucoup, sur la manière de dire et de se dire. »[12] Ici, les raccourcis et les sauts de temporalité portent à confusion dans le rapport des âges de certain·e·s protagonistes, et certains passages ont des aspects visuels très forts qui nous posent question : le but recherché est-il d’informer ou de provoquer des émotions ? Que cherche l’auteur quand il met en avant un champ lexical lié à l’école primaire dans le récit d’une personne qui, selon l’article, aurait 17 ans ? La forme choisie ainsi que les termes employés donnent un aspect graphique au récit, suscitant des réactions fortes, et mettent ainsi au second plan la réflexion et la prise de recul nécessaires au discernement.
Pour une mission aussi complexe que de rendre justice à des victimes, les médias présentent un certain nombre de travers : les biais de ses objectifs idéologiques et monétaires, ses contraintes en termes de taille d’article, son penchant à rechercher le sensationnel... « Cette tendance des médias à l’exposition dramatisante des victimes agit, en quelque sorte, comme une injonction à se sentir ému par l’exposition de la souffrance d’autrui, appelant le lecteur de la presse, l’auditeur de radio, le téléspectateur, à partager ces émotions, parfois instituant ce dernier en lieu et place de voyeur. »[13].
Un sujet tel que celui des violences sexuelles nécessite une infinie précaution dans la manière dont il est traité. Un article qui ne permet pas d’évaluer toutes les versions des faits et dont le contenu ne fait que relater des témoignages avec des détails qui appellent plus aux sentiments qu’autre chose, construit un jugement orienté et subjectif, dont les conséquences peuvent être désastreuses. Conséquences sur les personnes citées bien entendu, victimes ou auteurs – reconnu·e·s ou présumé·e·s –, mais également sur la crédibilité générale des victimes, et jusqu’au concept même de féminisme. Nous pensons que cette vision binaire, violente et excluante ne nous amènera à rien, et surtout pas à faire avancer les valeurs collectives que nous sommes nombreu·x·ses à chérir : l’acceptation, la bienveillance, la croyance en la capacité de changer.
Les limites de la Justice
L’application de la justice est complexe « entre la gravité d’une infraction condamnable et celle de la sanction pénale à prononcer, entre la garantie des droits des justiciables, victimes ou auteurs, et la protection des intérêts de la société »[14]. L’inscription de la justice dans des enjeux médiatiques, politiques et sociaux peut venir parfois remettre en question la justesse de ses principes et de ses décisions. L’accueil inadapté de la parole des victimes par les autorités, les difficultés de qualification de certains faits et les délais de prescription rajoutent un niveau de complexité dans le traitement judiciaire de ces situations qui peut être extrêmement douloureux pour les victimes. Peuvent s’ajouter à cela l’absence de considération de leur discours, le constat que leur témoignage leur échappe, le face à face avec leur agresseur qui bénéficiera de la défense de ses droits par un avocat, la longueur du processus qui entrave la possibilité de la reconstruction, la peur des représailles[15] et les décisions et verdicts qui peuvent être bouleversants (acquittements, non-lieux…). « En donnant l’illusion aux victimes que leur devoir est de venir immoler leur vie privée devant le tribunal, la justice donne, contrairement à sa mission, une occasion de souffrances supplémentaires que l’on voudrait “thérapeutique” »[16]. Et à elle seule, la justice ne permettra pas de dépassement du traumatisme.
Concernant plus spécifiquement les auteurs de violences sexuelles, une réponse de plus en plus répressive et punitive est réclamée. Or, la justice ne peut être notre seule solution sociale de régulation, car plusieurs raisons nous amènent à penser que la pénalisation systématique et/ou croissante des comportements humains et sociaux est critiquable, tant sur l’efficacité réparatrice de celle-ci pour les victimes, que sur la conscientisation des condamnés car « ce n’est pas l’emprisonnement de l’agresseur qui changera sa mentalité et qui lui apprendra qu’une femme est un être humain » (citation extraite du texte de la ligue du droit des femmes, 1976). Si les peines alternatives se développent, l’incarcération reste une norme en France. Et si la prison permet une mise à l’écart des individus considérés comme déviants et/ou dangereux pour la société par la privation de liberté, de nombreux facteurs (conditions d’incarcération, longueur des peines, préparation des sorties...) ne favorisent pas la réinsertion sociale qui est pourtant un objectif de la prison. La réponse pénale répressive n’est donc qu’une tentative partielle de réponse à ces problématiques. D’autres dispositifs judiciaires mériteraient d’être développés, comme par exemple la justice restaurative, dont l’objectif est de permettre une réflexion entre auteurs et victimes sur les conséquences de l’acte – sous des conditions très précises – et de « trouver des solutions pour le dépasser, dans un objectif de rétablissement de la paix sociale »[17].
Comment penser l’après ? Que mettre en place pour éviter la reproduction de ce que l’on combat ?
Cela nous amène à un point qui nous paraît fondamental : comment souhaitons-nous et pouvons-nous vivre ensemble ? Notre vision humaniste nous amène à penser que personne n’est irréprochable, que chaque humain est capable de commettre des fautes, parfois graves, et que dans tous les cas il s’agit de réfléchir aux modalités de retour en société de cette personne dans les meilleures conditions possibles. Nous sommes critiques quant à l’exclusion liée à la prison. Mais nous sommes tout autant heurtées par l’exclusion sociale créée par les méthodes de call out et de canceling qui reproduisent certains travers de la justice institutionnelle (entrave à la possibilité de reconstruction, enfermement dans le statut de victime, peur des représailles) tout en transgressant les principes démocratiques en ne donnant pas la parole à toutes les parties. Nous n’adhérons pas à certains élans collectifs, comme la punition, le harcèlement ou la vengeance, qui ne réparent pas sur le long terme, et ne sont jamais à la hauteur du préjudice subi. Que du point de vue d’une victime, ce soit notre souhait de voir la personne qui nous a blessé ou traumatisé, payer pour ce qu’elle a fait, nous pouvons l’entendre. Que l’on se positionne à titre individuel concernant les agissements d’un proche, ou en tant que collectif constitué, nous le comprenons. Que l’on appelle à la mort sociale d’une personne sans lui laisser la possibilité d’en dire quelque chose, cela nous révolte. Et quand bien même on laisserait l’opportunité à chacun·e de répondre, il n’y a aucune garantie que soit accordé à chaque parole le même crédit ou la même visibilité, aucune garantie de maîtriser les conséquences de cette démarche de call out puissante et destructrice.
Attachées aux idées de justice, d’égalité, de liberté, de réintégration, nous ne comprenons pas que ces questions soient si peu évoquées dans les débats actuels de notre communauté. Pire, elles sont attaquées et empêchées dans les discussions en ligne. Que le patriarcat asseye une domination et des violences sur les femmes est un constat sans appel, il est cependant essentiel de réfléchir et de réagir aux conditions de toustes et que chaque individu·e, quel que soit son genre ou son orientation sexuelle, puisse être reconnu·e comme victime ou envisagé·e comme agresseur·euse. Que toustes puissent parler de ce qu’iels ont vécu sans que se pose la question de l’identité : toutes les histoires méritent d’être écoutées, prises en compte. La discussion sur les abus et violences sexuelles concerne chacun·e d’entre nous.
Dans les différents collectifs constitués au sein de notre communauté, nous appelons à la rencontre hors ligne, afin d’échapper à « la fluidité, la flexibilité et la superficialité liée à l’idéologie de réseau »[18]. Les réseaux sociaux sont un puissant vecteur de conscientisation et de théorisation, mais qui doit être confronté au réel pour en mesurer l’efficacité et en corriger les défauts. Nous encourageons donc chacun·e à la réflexion sur ces thématiques qui nous bouleversent dans des échanges qui peuvent être des terrains expérimentaux de partages d’expériences, de justice transformative. Les problématiques de rapports humains ne peuvent être réglées qu’en communicant entre nous toustes. La rencontre dans un cadre défini favorise l’empathie et la compréhension, mais aussi l’acceptation des désaccords et des différences de vécus ou de ressentis. Il est possible de trouver d’autres moyens qui peuvent mener vers une réparation des victimes en nous inspirant de récits qui ouvriraient un champ d’action pour l’instant trop limité à la dénonciation publique.
Nous croyons à la transformation de notre société, à la prise de conscience progressive de celleux qui ont participé à une forme de domination, et au fait que ces prises de conscience se feront dans le dialogue, la médiation et surtout dans le temps, en nous appuyant sur les idéaux qui ont toujours été nôtres et que nous portons contre toutes formes d’oppression. Nous sentons une nécessité de nous positionner fermement contre ce que nous considérons comme des élans totalitaires, contre celleux qui refusent la nuance, le dialogue et contre les pulsions sur-répressives qui se répandent.
Le Collectif du Mois d’Août
PS : M. Huet, puisque vous dites que notre « scène » vous est familière, nous espérons vous voir à ces rencontres, afin que vous participiez dans la bienveillance aux réparations des individu.e.s que vous avez offensé.e.s et blessé.e.s et que vous contribuiez au déploiement d’énergies collectives nécessaires à la réparation d’injustices.
Ce texte a été conçu à cinq et depuis quatre villes différentes. Nous avons partagé notre temps et nos opinions pour l’écrire d’une seule voix mais avons aussi chacune dû faire des compromis dans cet exercice d’écriture commun complexe et enrichissant. Il a été important pour nous de prendre du recul sur nos réflexes liés à nos vécus individuels et de nous appuyer sur le collectif pour faire ressortir ce qui nous semble essentiel.
Références bibliographiques sur lesquelles nous avons appuyé notre réflexion
Articles
NOËL, F. « Militer : une activité safe ? Pour une critique politique de la notion d’espace safe » Contre-attaque(s). 2017, 1er novembre. http://contre-attaques.org/magazine/article/militer-une
CHARAUDEAU, P. « De l’état victimaire au discours de victimisation : cartographie d’un territoire discursif », Argumentation et analyse du discours, 2019. https://doi.org/10.4000/aad.3408
Collectif. « Nous sommes touTEs des survivantEs, nous sommes touTEs des agresseurSEs », Infokiosques, 2015. https://infokiosques.net/lire.php?id_article=1176
GRAND D’ESNON, P. « Pureté militante, culture du “callout” : quand les activistes s’entre-déchirent », NEON, 2021, 3 septembre. https://www.neonmag.fr/purete-militante-culture-du-callout-quand-les-activistes-sentre-dechirent-569283.html
FREEMAN, J. « Trashing: The Dark Side of Sisterhood », Ms. Magazine, 1976. https://www.jofreeman.com/joreen/trashing.htm
JOIGNOT, F. « Abus sexuels dans l’église. La Commission d’enquête publie un difficile livre de témoignages », le blog de Frédéric Joignot, Le Monde, 2021, 1er novembre. https://www.lemonde.fr/blog/fredericjoignot/2021/10/07/abus-sexuels-dans-leglise-un-difficile-livre-de-temoignages/
HODER. « Chroniques du bord de l’amer… », Deux doigts dans la marge, 2012, 23 juillet. https://deuxdoigtsdanslamarge.wordpress.com/2012/07/23/chroniques-du-bord-de-lamer/
SAUVAGET, B. « Rapport de la Commission sur les abus sexuels dans l’église : les voix du silence », Libération, 2021, 4 octobre. https://www.liberation.fr/societe/religions/rapport-de-la-commission-sur-les-abus-sexuels-dans-leglise-les-voix-du-silence-20211004_BUBESLLHXNE5DL3UHRXWLZVHNQ/
Secrétariat général service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes. Les mesures de justice restaurative, 2016. http://www.justice.gouv.fr/art_pix/justicerestaurative_20160126.pdf
WAINTRATER, R. « Témoignaire », Témoigner. Entre histoire et mémoire, 117 | 150151, 2014. https://doi.org/10.4000/temoigner.1213
Livres
BADINTER, É. Le Conflit, Flammarion, 2011.
BAJOS, N., BOZON, M., GODELIER, M. Enquête sur la sexualité en France, La Découverte, 2008.
BASTIE, E., Le Porc émissaire, éditions du Cerf, 2018.
BOURDIEU, P. La Domination masculine, Points, 2014.
BROWN, E., DEBAUCHE, A., HAMEL, C., MAZUY, M. Violences et rapports de genre. Enquête sur les violences de genre en France, Ined éditions, 2021.
DEBAUCHE, A., LEBUGLE, E., BROWN, E., et al. Enquête Virage et premiers résultats sur les violences sexuelles, Ined éditions, 2017.
ELIACHEFF, C., SOULEZ-LARIVIÈRE, D. Le Temps des victimes, Albin Michel, 2011.
FLEURY, C. Ci-gît l’amer : guérir du ressentiment, Gallimard, 2020.
GIRARD, R. Le Bouc émissaire, Livre de Poche, 1986.
JASPARD, M. et al., Ministère délégué à la parité et à l’égalité professionnelle. Les violences envers les femmes en France – Une enquête nationale, La Documentation française, 2003.
KOECHLIN, A. « Woke et déconstruit·e, critique d’une posture » in La Révolution féministe, p. 129-147, Amsterdam, 2019.
LAMEYRE, X. Le Glaive sans la balance, Grasset, 2012.
LAGASNERIE, G. de. Juger : l’état pénal face à la sociologie, Fayard, 2016.
LAGASNERIE, G. de. Sortir de notre impuissance politique, Fayard, 2020.
LAGASNERIE, G. de. Mon corps, ce désir, cette loi – Réflexions sur la politique de la sexualité, Fayard, 2021.
MERTZ, B. Les réseaux sociaux contre la démocratie. Palimpseste de la Société du spectacle, Édilivre, 2021
MICHÉA, J. Le Loup dans la bergerie, Flammarion, 2019.
MURAT, L. Une révolution sexuelle ? : réflexions sur l’après-Weinstein, Stock, 2018.
RICORDEAU, G. Pour elles toutes – Femmes contre la prison, Lux, 2019.
SCHULMAN, S. Conflict Is Not Abuse: Overstating Harm, Community Responsibility, and the Duty of Repair, Arsenal Pulp Press, 2016.
TEULÉ, J. Mangez-le si vous voulez, Julliard, 2009.
Vidéos
L’Annulation (canceling) | ContraPoints. 2020, 2 janvier. [Vidéo] YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=OjMPJVmXxV8
Le dog pile : une violence communautaire. 2020, 27 avril. [Vidéo] YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=8n66RWRdZFw&fbclid=IwAR0vWLr3dwUKPjL5S1Ww7AAJBMupVeAhb9jB1BiZJzOGwo4igZoTkJTECz
Championne de France de cyber-harcèlement | Marion Seclin | TEDx Talks. 2017, 29 novembre. TEDxChampsElyseesWomen [Vidéo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=sphZS8JVwNc&feature=youtu.be
Podcasts
L’affaire Salif B. Adila Bennedjaï-Zou, réalisation Clémence Gross. 2020, 23 juin. [Podcast]. France Culture https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/laffaire-salif-b
Talking Shit with Dr. Christine Marie: Breaking the Spell of Cancellation. Fucking Cancelled. 2021, 28 janvier. [Podcast]. Spotify https://open.spotify.com/episode/7joHha2vQkDDuDnZkgpgZW?si=CshMGeqESJCY7kw3dTTu6A
[1] FLEURY, C. Ci-gît l’amer – Guérir du ressentiment, Gallimard, 2020.
[2] Ibid.
[3] GIRARD, R. Le Bouc émissaire, Livre de Poche, 1986.
[4] GRAND D’ESNON, P. « Pureté militante, culture du “callout” : quand les activistes s’entre-déchirent », NEON, 2021, 3 septembre. https://www.neonmag.fr/purete-militante-culture-du-callout-quand-les-activistes-sentre-dechirent-569283.html
[5] Extrait du texte de la ligue du droit des femmes de 1976, citée par LAGASNERIE, G. de. Mon corps, ce désir, cette loi – Réflexions sur la politique de la sexualité, Fayard, 2021.
[6] JASPARD, M. Les violences envers les femmes en France : une enquête nationale. La Documentation Française, 2003. BAJOS, N., BOZON, M., Enquête sur la sexualité en France, La Découverte, 2008. BROWN, E., DEBAUCHE, A., HAMEL, C., MAZUY, M. Violences et rapports de genre. Enquête sur les violences de genre en France. Ined éditions, 2021.
[7] DEBAUCHE, A., LEBUGLE, E., BROWN, E., et al. Enquête Virage et premiers résultats sur les violences sexuelles, Ined éditions, 2017. BAJOS, N., BOZON, M. Enquête sur la sexualité en France, La Découverte, 2008.
[8] CHARAUDEAU, P. « De l’état victimaire au discours de victimisation : cartographie d’un territoire discursif », Argumentation et analyse du discours, 2019. https://doi.org/10.4000/aad.3408
[9] SAUVAGET, B. « Rapport de la Commission sur les abus sexuels dans l’église : les voix du silence », Libération, 2021, 4 octobre. https://www.liberation.fr/societe/religions/rapport-de-la-commission-sur-les-abus-sexuels-dans-leglise-les-voix-du-silence-20211004_BUBESLLHXNE5DL3UHRXWLZVHNQ/
[10] WAINTRATER, R. « Témoignaire », Témoigner. Entre histoire et mémoire, 117 | 150151, 2014. https://doi.org/10.4000/temoigner.1213
[11] LAGASNERIE, G. de. Mon corps, ce désir, cette loi – Réflexions sur la politique de la sexualité, Fayard, 2021.
[12] JOIGNOT, F. « Abus sexuels dans l’église. La Commission d’enquête publie un difficile livre de témoignages », le blog de Frédéric Joignot, Le Monde, 2021, 1er novembre. https://www.lemonde.fr/blog/fredericjoignot/2021/10/07/abus-sexuels-dans-leglise-un-difficile-livre-de-temoignages/
[13] CHARAUDEAU, P. « De l’état victimaire au discours de victimisation : cartographie d’un territoire discursif », Argumentation et analyse du discours, 2019. https://doi.org/10.4000/aad.3408
[14] LAMEYRE, X. Le Glaive sans la balance, Grasset, 2012.
[15] LAGASNERIE, G. de. Mon corps, ce désir, cette loi – Réflexions sur la politique de la sexualité, Fayard, 2021.
[16] ELIACHEFF, C., SOULEZ-LARIVIÈRE, D. Le Temps des victimes, Albin Michel, 2011.
[17] Secrétariat général service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes. Les mesures de justice restaurative, 2016. http://www.justice.gouv.fr/art_pix/justicerestaurative_20160126.pdf
[18] MICHÉA, J. Le Loup dans la bergerie, Flammarion, 2019.



