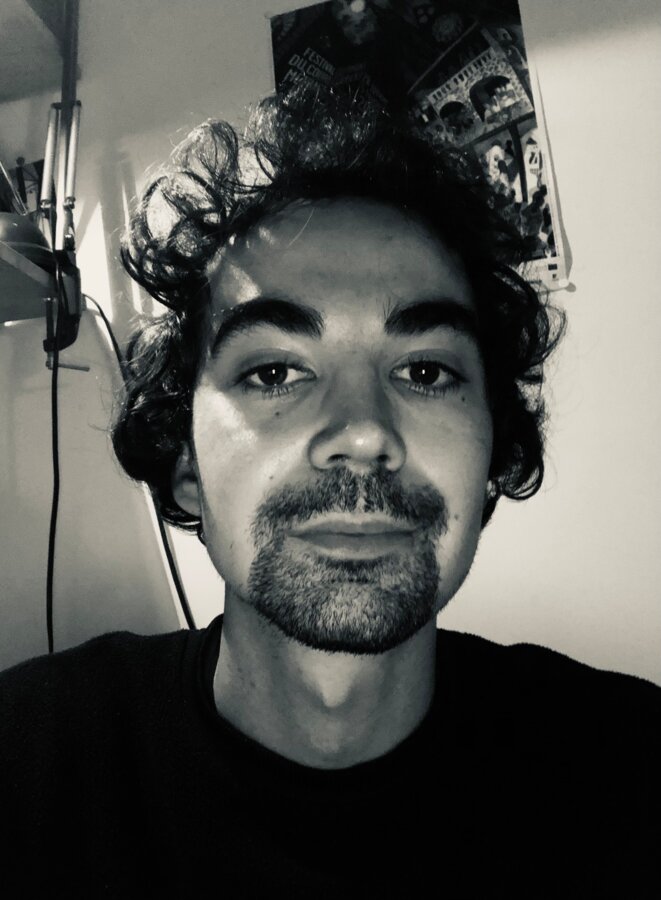Agrandissement : Illustration 1

Dans Maria de Pablo Larraín, la "prima donna" n’est plus une diva absolue, une star au top de sa forme, plutôt le genre tarée et déchue : il reste d’elle une image de victime, un chagrin d’amour, et le même destin tragique que dans les opéras qu’elle interprétait sur scène. Premier film sur une artiste du cinéaste chilien, Maria commence en 1977 par le décès chez elle de la cantatrice, retrouvée morte par ses deux domestiques (joués par Alba Rohrwacher et Pierfrancesco Favino), dans son splendide salon, avant d'effectuer un léger flash-back, vers les derniers jours de sa vie, à Paris. Admiré pour ses façons plastiques de rechercher le narratif, multipliant matières diverses, goût de l’archive et de la reconstitution, lyrisme virtuose, Pablo Larraín semble dorénavant un cinéaste spécialisé dans les biopics de femmes mythiques, riches et malheureuses, qui travaille avec des moments historiques précis : une semaine après l’assassinat de JFK, dans Jackie (2017), trois jours de festivités de Noël au domaine de la reine en 1991, pour Spencer (2022), autour de Lady Di. C’est sur la dernière semaine de la Callas, la grande rivale de l’ancienne première dame des États-Unis (les deux femmes ont en commun l'irrésistible porc armateur et milliardaire Aristote Onassis), qu’il s'appuie aujourd’hui pour se focaliser sur son héroïne, interprétée par Angelina Jolie, superstar américaine de tous les plans.
Personnification par un journaliste de sa drogue préférée
Toute la dernière semaine de Maria Callas a lieu en bordure du vertige existentielle, dans cette instance narrative circonstanciée et réussie, la personnification par un journaliste (l’acteur australien Kodi Smit-McPhee) de sa drogue préférée, dont elle abuse, le jeune homme lui faisant revivre des souvenirs, avoir des visions, des flash-backs. C’est là qu’est le vrai et vaste programme du film : la biographie triomphale et intimement triste de la cantatrice. Tout Maria se joue entre deux tragédies, d’un côté la perte progressive de sa voix, de l’autre son grand amour déçu, Onassis ayant choisi Jackie Kennedy, qu’il a épousée en 1968. Le film ne s’abandonne vraiment à aucune des deux, s'en tient à cette double formule enrichie d'un Best Of et d'un traumatisme originel pour encore plus nous émouvoir. La mise en scène classieuse de Larraín, faite de beaux mouvements de caméra, de décors somptueux, confine ici à un académisme feutré qui, ne cherchant pas à se libérer des carcans et des fourrures, échoue à susciter l’émotion, tire vers ce qu’il faut bien se résoudre à appeler imagerie chic ou publicitaire : quelque chose qui va droit à l’image, pas au coeur.
L'ombre d'un désintérêt
Et la fragmentation narrative, qui est l’art de Larraín, son domaine - cette quête d’un libre rayonnement dans l’espace et le temps, qui fait le déploiement formel de son cinéma en général - reste, malgré tous les gracieux mélanges de régimes d'images, à l’état de bonne copie, de bel canto. On voit ce que Maria travaille, brouillant les pistes, mêlant constamment les vraies archives (la Callas sur scène, de loin) et les fausses (les flash-backs fictionnels et non documentaires). Mais Maria ne prenant jamais le risque de se salir en allant jusqu'au bout avec son personnage, d’accompagner véritablement le désespoir d’une fin dans la vie, ne s’élève jamais. Une main invisible semble avoir retenu son geste, comme l’ombre d'un désintérêt, cette mélancolie de happy few qu’une simple vie sans triomphes, au milieu de domestiques, même adorables, ne pouvait suffire à soigner.