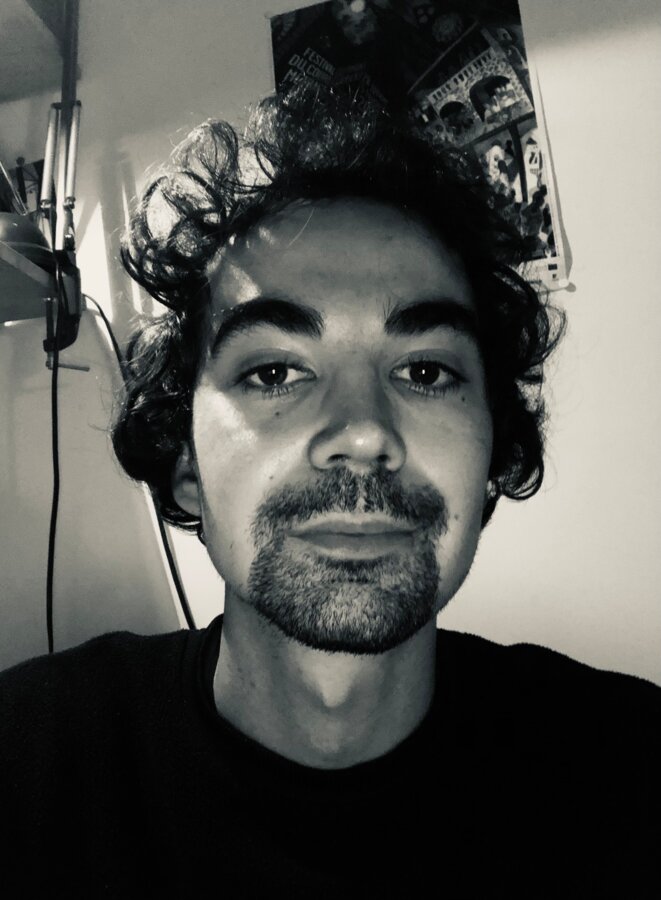Agrandissement : Illustration 1

À seulement 45 ans, Ryūsuke Hamaguchi, découvert en France en 2018 avec Senses et Asako I&II, compte déjà parmi les plus grands cinéastes d'aujourd'hui. Son dernier film, Le mal n'existe pas, qui a germé autour de la musique d'Eiko Ishibashi, marque le renouveau d'un art du mouvement et de l'intime, avec un motif récurrent de la perte et de la disparition, dont il faut ici louer l'épure, la frugalité et la précision, le souci d'ordonner beaucoup avec presque rien, de regarder là où le réel s'évide, de faire exister des personnages en prêtant l'oreille à leur respiration secrète, à mille lieux d'une propension actuelle à la surcharge narrative. Art, surtout, d'accueillir la nature sans forcer le romantisme, de lui construire une place au cœur de rapports entre les êtres qui en constituent la seule matière.
Mais ce qu'on admire le plus, dans le nouveau film de Ryūsuke Hamaguchi, c'est encore son merveilleux et unique noyau d'étrangeté. Non pas qu'il soit sibyllin, bien au contraire, mais parce que l'énigme y surgit et retombe par vagues, comme échappée du décor, tant la forêt enneigée qui compose l'espace du film paraît lui insuffler spontanément ses plans les plus mystérieux.
Le mal n'existe pas s'ouvre sur un très long travelling sous les arbres, la caméra tournée vers le ciel, et semble ainsi créer d'emblée une opposition conflictuelle, une tension dramatique, à savoir une certaine hostilité de la nature à l'homme. À ce trouble fait écho la musique de la compositrice Eiko Ishibashi : ses thèmes sombres et tracassants ne cesseront tout au long du film de surgir et de s'interrompre brusquement, le plaçant sous la prémonition d'une tragédie imminente. De fait, le film s'installe à Muzubiki, village d'allure paisible près de Tokyo, dont les habitants reçoivent la visite de deux agents de communication venus présenter le glamping (camping glamour pour les citadins) bientôt construit au cœur de leur forêt.

Agrandissement : Illustration 2

Magnifique mélange des tons
Divisé en trois parties, Le mal n'existe pas est construit patiemment dans un magnifique mélange des tons, sculpté dans la matière même du quotidien. La première, très anodine en apparence, ne contient, chose inhabituelle chez Hamaguchi, que peu de mots. Les premiers plans, attentifs au rythme des gestes en forêt de Takumi et de sa fille Hana, lui confèrent un aspect documentaire tout en jouant avec l'imaginaire du film d'horreur ou du thriller - la tronçonneuse, la hache, la maison dans les bois. Tout semble à la fois harmonieux et louche. Une séquence signale à quel point le film se plaît à jouer sur les deux tableaux, spécialement chez Takumi, qui ne communique rien : il entend un coup de feu, puis se rend compte un peu plus tard qu'il a oublié d'aller chercher sa fille à l'école, et il porte subitement sa main à l'arrière de la tête, comme pour vérifier qu'une balle ne l'a pas traversée. Hana, son enfant, n'est pas plus tangible : la petite vagabonde seule, dans un jeu d'apparitions et de disparitions, comme lorsqu'elle se retrouve magiquement sur les épaules de son père lors d'un travelling en forêt.
Hamaguchi se révèle aussi précis et subtil lorsque la parole jaillit enfin, à l'occasion d'une longue scène de réunion participative entre les deux communicants envoyés par la société de glamping, Takahashi et Mayuzumi, et l'assemblée des villageois. Chacune des prises de parole est filmée dans la durée avec autant d'intérêt que son écoute, et on a même rarement si bien marqué l'écart entre l'humanité rurale et certain capitalisme mondialisé, avec sa langue de bois, ses macs, ses PowerPoints, ses assistantes en escarpins et ses rendez-vous pros. Arrivé à mi-parcours, la grande intelligence d'Hamaguchi est de ne pas se contenter du point de vue des habitants mais d'aller voir du côté de l'entreprise, de ce qui se trame à Tokyo et dans le cœur des deux représentants. Et alors, dans une très belle scène de complicité en voiture, on sympathise avec le diable et on se met à douter. Puissent ceux qui s'obstinent à donner aux méchants des airs de méchants retenir la leçon.
Dans une dernière partie, qui revisite en présence de Takumi et des deux agents de la ville les situations parcourues au début - couper du bois, remplir des jerricans d'eau du ruisseau -, ce à quoi ces individus de mondes opposés sont confrontés, c'est finalement à l'impossibilité même de nouer un lien, de réduire ne serait-ce qu'un instant le fossé qui les sépare par la parole, à mesure que se dévoilent les décalages entre Takumi et Takahashi, le porte-voix du glamping qui tente avec zèle de se racheter.

Agrandissement : Illustration 3

Semer des possibles
Il en est pour croire qu'on fabrique de l'art en corrigeant l'existant. En recouvrant les couches du réel par d'autres couches plus présentables. Comme Mayuzumi demandant si une clôture sera construite puisque le site de glamping est "sur le trajet des cerfs", l'erreur consistant à croire que l'on dispose de la réalité. À rebours, Ryūsuke Hamaguchi fabrique un film en l'accueillant, la trouant puis se penchant sur sa béance. Ce vide, par la magie du filmage concentré, semble receler un monde. Le peu qu'il filme s'augmente, s'excède, acquiert une densité inédite. Ces arbres deviennent un peu plus que des arbres.
Ce surcroît de réel on peut aussi l'appeler le possible. Pour Hamaguchi, écrire puis filmer Le mal n'existe pas, c'est semer des possibles et les maintenir tels. Il sème un père qui oublie d'aller chercher sa fille à l'école. Sème des parties de chasse invisibles. Sème une mère absente - deux plans sur des photos de famille suffisent. Le possible c'est parfois aussi simple qu'une enfant qu'on appelle et qu'on ne voit pas. Ou que les empreintes d'un animal dans la neige.
Le plus beau reste quand même comment cette histoire se termine sur un acte insondable et terriblement ambigu, sanctionnant l'impossible rencontre ou la lucidité fugace d'un personnage rendu étranger à son propre désir. Bien que cette fin se fasse soudain plus sèche et violente, il en émane une logique qui nous invite naturellement à remonter la piste des indices dispersés ici et là - une goutte de sang sur une épine, une carcasse animale croisée par les personnages, etc.
À terme, Le mal n'existe pas offre l'un de ces rares moments de cinéma où chaque plan fascine par sa profonde écoute de ce que la matière lui dit à mots inaudibles, où chaque raccord résonne de diverses façons, l'ensemble dessinant un mouvement par lequel le sens se dérobe, dans la brume, enfin, d'un soir bleuté où sévit quelque chose de mal, ressentiment, perte, désarroi du vivant, on ne sait pas trop, mais c'est là.