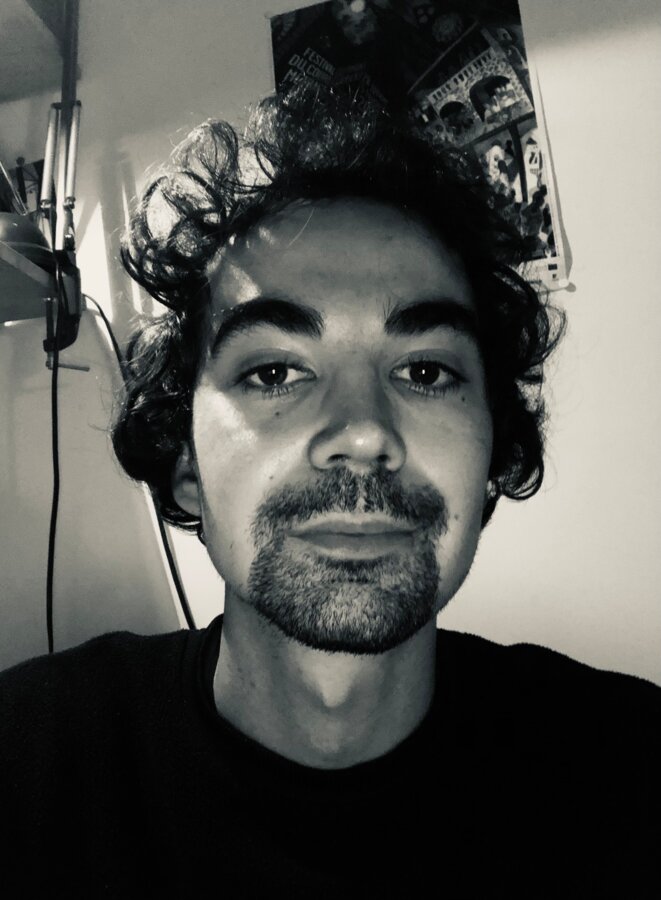Agrandissement : Illustration 1

Petit prodige du cinéma friand de fantaisies conceptuelles, d’auteur international et contemporain, grande bête à festivals multiprimé, le grec Yórgos Lánthimos, 50 ans, est arrivé en septembre dernier à la consécration en remportant le Lion d’or de la Mostra de Venise avec son huitième long-métrage, Poor Things (Pauvres créatures). Nonobstant la frénésie de succès que le cinéaste engrange à l’échelle mondiale, à commencer sur le Vieux Continent, ce n’est bien sûr pas une raison suffisante pour rendre son auteur louable. En ce sens semblable à la créature baroque qui habite son film, Lánthimos mériterait plutôt notre admiration par la manière crue et débordante avec laquelle il parvient, depuis quinze ans, à voyager dans les univers cinématographiques - même à Hollywood - sans y perdre son excentricité.
Soit, ici, une fable rétrofuturiste de l'époque victorienne, adaptée du roman du même nom de l’écrivain écossais Alasdair Gray, publié en 1992. Après s’être suicidée pour échapper à son mari violent, le cerveau de Bella Baxter (Emma Stone) est remplacé par celui de sa fille à naître. Mi-femme, mi-nouveau-née, la créature blanchâtre aux billes bleues, maladroite et délicate à la fois, effrayante en même temps que charmante si cela se peut, suscite l’intérêt castrateur de trois hommes en particulier. En premier lieu son créateur, l’étrange docteur Godwin Baxter (Willem Dafoe) – «God», de son surnom –, incarnation loufoque et inquiétante (ex-cobaye de son père, il porte au visage d’énormes cicatrices) de ce que l’espèce compte de plus paternaliste. Préservant Bella du monde extérieur, il veille jalousement sur elle et introduit un assistant dans sa vaste maison laboratoire de Londres, afin de la surveiller du matin au soir.
L’apprenti Max McCandless (Ramy Youssef), étudiant de la faculté de médecine, jeune homme de compassion, tombe éperdument amoureux de son sujet, et “God” accepte de lui donner sa main à condition que le couple reste avec lui. Enfin, Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), avocat séducteur quinqua au travail peu recommandable, obsédé par les plaisirs sexuels, voue à Bella un désir manifeste, avant de l'entraîner dans un grand voyage à l’étranger et d’avoir l’ivresse de lui être utile, spirituellement et charnellement, dans sa découverte du monde. La créature candide entame un périple inattendu, de Londres à Lisbonne en passant par Alexandrie puis Paris, pour mieux revenir à son point de départ.
On pourrait croire l’expérience traumatisante. Mais il n’en est rien quand le récit prend, comme ici, le parti de la libération. Et partant de l’émancipation. Tout est délibérément renversé par rapport aux mythes classiques (Frankenstein, Pygmalion), dont s’inspire Pauvres créatures. Le patriarcat y est cloué au pilori, tandis que les barrières morales d’une société étriquée sont ignorées par la franchise d’une femme se fichant des préjugés, vivant mille aventures, adorant le sexe (“les bonds furieux”).
Plus encore, Lánthimos s’amuse à exalter les minoritaires et les dominés, à libérer d’une société masculine, blanche et répressive tout un peuple qu’elle craint - une prostituée socialiste et un jeune cynique noirs, une maquerelle tatouée, une dame âgée sans-gêne rencontrée à bord d’une croisière -, et pose cette question : si une personne ne se laisse pas dicter par la société, à quel point lui apparaît-elle absurde ? “Donc tu souhaites m’épouser… ou me tuer ?” demandera à Duncan, Bella, interdite.
Feu d’artifice par les décors et les costumes
La parabole politique et sociale n’annule en rien, toutefois, l’art de divertir. Et le film de se métamorphoser en spectaculaire défilé d’imaginaires où les univers des divers mondes créés se répondent, surenchérissent, deviennent le cœur du film - qui doit énormément aux trouvailles des chef.fe.s décorateur.rice.s et costumier.ère.s entremêlant avec brio plusieurs époques. Ce feu d’artifice par les décors et les costumes donne au film tout son relief, et soustrait par la même occasion, mais en partie seulement, à l’esthétique de Lánthimos, qui, fidèle à son goût de la sophistication assumée, s'époumone dans une pluie d'effets de mise en scène poseurs - entre noir et blanc et couleurs, 35 millimètres et numérique, torsions optiques et musiques dissonantes à la pelle.
Le charme de Pauvres créatures consiste somme toute à renouer avec un savoir-faire à l’ancienne, s’appuyant sur des ressorts que les studios hollywoodiens ont tendance à délaisser : la puissance visuelle des décors et des costumes, un scénario dans l’air du temps mais néanmoins original et efficace, signé par le scénariste du précédent film du grec La Favorite - et dont Pauvres créatures confirme la vis comica. On doit à Yórgos Lánthimos d’employer une rhétorique formelle (encore trop) criarde, mais d’avoir habilement construit son film autour de la puissance d’incarnation de Bella, inspirée par les manières transgressives d'Emma Stone - le Golden Globe de la meilleure actrice vient de lui être attribué, tandis que le film a remporté celui de la meilleure comédie.
La meilleure manière de revisiter à travers un prisme féministe et comique le classique de Mary Shelley était sans doute celle-ci : en faire un film à la gloire de son actrice, pour et porté par elle. Un film dédié au charisme de l'étonnante Emma Stone - également productrice du film - qui se livre avec l’ardeur d’un savant trop folle de joie de pouvoir jouer à se créer elle-même.

Agrandissement : Illustration 2