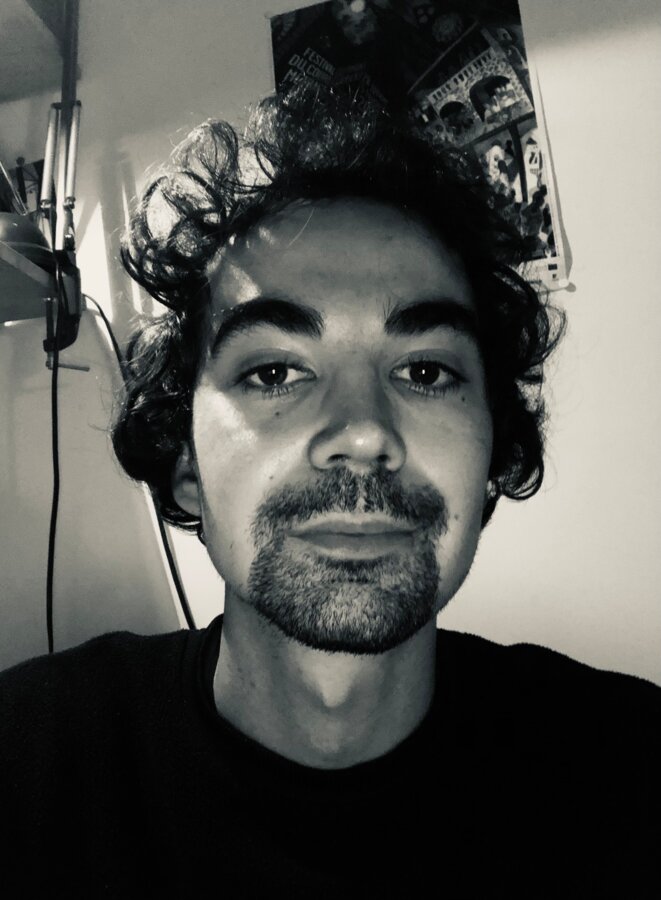Agrandissement : Illustration 1

Aux deux tiers de La Voyageuse, dans une séquence chargée de tout l’artisanat simple et euphorisant de Hong Sang-soo, interloqué par Iris, un couple s’interroge en la voyant s'éloigner entre les arbres, à la fin d’un premier cours qui s’est terminé par une promenade dans un parc : « Pourquoi est-elle en Corée ? » « On lui demandera un autre jour. » En voilà une réponse définitive qui n’en est pas vraiment une, mais où on touche du doigt ce qui caractérise en premier lieu cette curieuse étrangère : elle est mystérieuse, au sens où l'on ne sait rien d'elle, de ce qu'elle veut, de son passé, de ses attaches ailleurs, des raisons de sa présence à Séoul. C’était déjà là le procédé qui obstruait in water, le précédent film du coréen, sorti l’été dernier : un flou généralisé, optique cette fois, qui contrevenait scandaleusement aux normes techniques, mais figurait peut-être davantage un certain être au monde.
Présenté voilà presque un an à la Berlinale (dont il est reparti avec le Grand prix du jury), La Voyageuse est le troisième film de Hong Sang-soo avec Isabelle Huppert - après In another country, en 2012, où elle jouait déjà une voyageuse, et La caméra de Claire, en 2017 -, la présence récurrente de l’actrice n'altérant en rien la manière de faire du cinéaste, vite, avec ce qu’il a sous la main, presque tout seul, à juste quelques-uns de confiance, sans la machinerie de l’industrie, pour se donner la force de réinventer bien des choses, à commencer par la façon de raconter des histoires : ce nouveau film se présente comme l’un des plus ouverts aux aléas des circonstances de tournage, au « heureux hasard », parmi la trentaine réalisés par le grand Hong à ce jour, et si Huppert s’y meut avec la légèreté d’un cours d’eau qu'elle doit traverser à un moment, c’est aussi l’un des plus évidemment burlesque.
Chapeau de paille, robe fleurie et compensés, vieux stylo customisé avec du sparadrap du même vert que son gilet, Iris se trouve donc à Séoul, où elle s’est improvisée professeure de français à domicile. Elle communique cependant en anglais avec ses élèves coréens, réservant le français à des fiches qu’elle constitue pour eux et qu’elle enregistre ensuite sur des cassettes pour la prononciation. Dessus ne figurent que des phrases qui les « touchent émotionnellement ». Apprendre une langue par l’émotion, c’est une méthode qu’elle a inventée. Question pédagogie, on ne sait pas trop, on demande à voir, mais ce qui est sûr, c’est que son dispositif psychanalytique donne envie à ses élèves de se livrer, de dire des choses intimes, de faire des confidences. En les interrogeant à sa manière, Iris sert même de révélatrice, pour les autres, c’est peut-être pour ça qu’elle boit beaucoup de makgeolli (un alcool de riz coréen d'aspect laiteux), pour rendre plus vivable ce transfert et cette conscience du monde qui l’entoure.
Mêmes questions
Comme beaucoup d’autres Hong Sang-soo avant lui, La Voyageuse se décompose en plusieurs parties, et repose sur un principe de variation entre elles, dans le cours d’une seule journée. Chaque partie, il y en a trois, est centrée sur une rencontre d’Iris, la première avec Isong (Kim Seung-yun), une jeune femme à qui elle a déjà donné plusieurs cours, la deuxième avec Wongju (Lee Hye-young), une nouvelle cliente qui suit sa première séance accompagnée de son conjoint, et la troisième avec Inguk (Ha Seong-guk), l’ami + + et élève qui l’héberge. D’un bloc à l’autre, le déroulé est plus ou moins le même : se tenant d’abord chez l'élève, la rencontre est momentanément interrompue par un morceau de musique joué en direct, avant que l’action ne se poursuive à l'extérieur, au cours d’une promenade dans un parc, où l’on se trouve, à un moment, à côté d’une stèle ou d'un rocher. La Voyageuse s’amuse ainsi à multiplier les échos entre les situations, faites de petits riens, d’infimes détails, la seconde partie pouvant tout spécialement être considérée comme une variante de la première : l’élève et les lieux sont différents, mais les dialogues sont presque les mêmes, car Iris pose au mot près les mêmes questions. Ce réseau de duplications renvoie plus généralement au cinéma de Hong, qui aime à construire des récits et des personnages analogues, au sein d’un même film, et d’un film à l’autre, à l’intérieur desquels les spectateurs et ses admirateurs sont conviés au jeu des sept différences. Il est en effet reconnaissable entre tous pour sa façon d’épingler des figures familières (comme par exemple Kwon Hye Hyo, qui joue à nouveau un homme d’âge mûr dragueur et insatisfait, alter ego titubant du cinéaste), des créatures peu sûres d’elles-mêmes, de leur désir, noyant leur incertitude existentielle dans l’alcool et les mots.