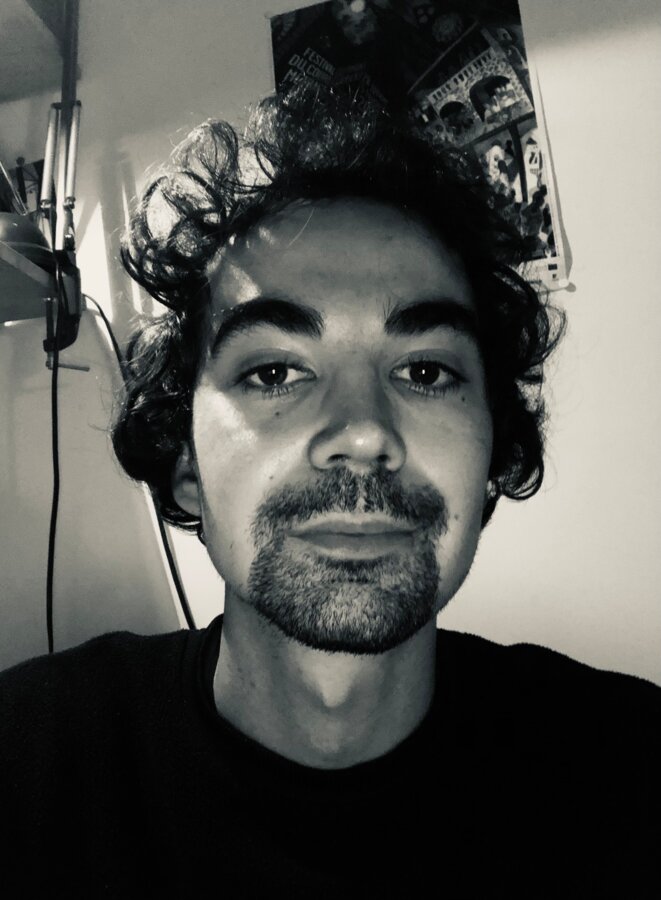Agrandissement : Illustration 1

La rencontre de la haute et du populo, l’impureté agissante et l’injection du comique dans le tragique sont autant de sillons creusés par le cinéma de Patricia Mazuy. Un cinéma qu’on qualifie volontiers "d'anarchisant”, attentif aux ingrédients du genre, mais toujours enclin à les dérégler, à les précipiter dans une échappée sauvage (la série B dans Sport de filles, en 2011, le western spaghetti dans Paul Sanchez est revenu !, en 2018, le film noir dans Bowling Saturne, en 2022). La Prisonnière de Bordeaux, son dernier long-métrage présenté à la Quinzaine des cinéastes au Festival de Cannes, reconduit la plupart de ces motifs, mais d’une façon étrangement sage.
Dans La Prisonnière de Bordeaux, ce sont les hommes et non les femmes qui sont en prison. Au parloir, deux d'entre elles venues rendre visite à leur conjoint se rencontrent : Alma, une grande bourgeoise bordelaise (Isabelle Huppert), excentrique à souhait, et Mina, une jeune mère des quartiers de Narbonne (Hafsia Herzi). Ces deux-là, personnages et actrices, vont faire un bout de route ensemble, lorsqu’Alma décide d’héberger Mina, avec ses galères et bientôt ses enfants, dans son hôtel particulier riche d’art contemporain. Le film se lance alors dans une étrange amitié, belle et périlleuse, sur fond de lutte des classes (l’un des scénaristes est l’écrivain François Bégaudeau), dans une veine naturaliste.
Alma et Mina s’utilisent l’une l’autre. Alma loge Mina, lui permettant de se rapprocher de la prison, elle lui trouve un job dans la clinique de son mari, et parvient à inscrire ses enfants dans l’école de quartier. La première se sent seule et cherche à se distraire. La seconde est pressée par Yacine, un curieux truand qui a perdu son frère lors du casse de son conjoint, et lui réclame à présent sa part de butin. Les deux femmes n’ont apparemment rien en commun - Alma a tout le temps d’être drôle et enjouée, quand Mina n’a pas une seconde pour ça. N’empêche que toutes deux ont leur vie déterminée par leur homme, par ses bonnes ou mauvaises actions, et leur marge de manœuvre, dans le film, ne se situe qu’à l’intérieur de ce cadre. Et donc prisonnières ? Mais de quoi ? Peut-être d’un trop-plein de déterminismes, social et patriarcal.
Passer en force
Par rapport à Bowling Saturne, où deux frères se déchiraient autour de l’image du père défunt, Patricia Mazuy opte, dans La Prisonnière de Bordeaux, pour un ton nettement plus léger. Le film se veut pour l'essentiel l'histoire de cette improbable amitié transclasse, mais peine trop souvent à faire tenir debout sa mince trame dramatique, comme étouffée par la centralité de ses deux caractères féminins. Ainsi, les deux conjoints, que la cinéaste ne semble filmer qu’à contrecœur, sont presque accessoires. Idem pour les enfants. Même Yacine, dont les premières apparitions interrogent, se révèle ne servir qu'à tirer les ficelles du récit.
Le style rageur de Patricia Mazuy s’efface progressivement, ici, au profit du scénario à gros sabots. Tout le fond d’intrigue gangster, par moments relancé, mêlant histoire de dettes et cambriolages, est condamné à passer en force. Deux ans à peine après Bowling Saturne, La Prisonnière de Bordeaux est le septième long-métrage de cinéma de Patricia Mazuy en trente-cinq ans de carrière.