
Les sursauts et les rancœurs de la nouvelle année
La nouvelle année a commencé violemment. D'une part, nous avons été surpris par le séisme de magnitude 6,5 qui a frappé le Mexique le vendredi 2 janvier, nous rappelant que face à la voix imposante de la terre, il ne restait plus qu'à attendre, en espérant que l'issue soit rapide et indolore. D'autre part, nous avons été secoués par la nouvelle de l'invasion du Venezuela par les États-Unis le lendemain, qui s'est soldée par l'arrestation de Nicolás Maduro et de son épouse Cilia Flores.
Ici, ce n'était plus la terre qui avait parlé, mais la légalité américaine, arrogante et sélective, habituée à s'arroger, si elle le jugeait nécessaire, le rôle d'une force naturelle immunisée. Seul le cynisme le plus récalcitrant avait permis de dissimuler pendant si longtemps le véritable sens de sa célèbre expression God Bless America (« Que Dieu bénisse l'Amérique »), qui n'était autre que America Bless God, dont le son devait parvenir aux oreilles du président américain devenu Trump is America, ou ce qui revenait au même selon le simple syllogisme, Trump is God.
Le spectre Monroe et l'usurpation de l'Amérique

Agrandissement : Illustration 2

L'invasion du Venezuela et la capture de Nicolás Maduro et de son épouse (que plusieurs médias ont immédiatement qualifiée d'enlèvement) ouvraient désormais un scénario incertain, mais qui nous ramenait à d'autres épisodes de l'histoire américaine et à sa stratégie impérieuse visant à contrôler des territoires étrangers afin de protéger ses propres intérêts géopolitiques et économiques. Depuis la présidence de James Monroe au premier quart du XIXe siècle jusqu'à l'invasion de l'île de Granada en 1983 ou l'arrestation de Manuel Antonio Noriega après l'invasion américaine du Panama en 1989, les États-Unis avaient tracé une ligne claire pour leur politique étrangère, qui réduisait l'Amérique latine à un rôle subsidiaire, de « arrière-cour », par rapport au rôle prépondérant et tutélaire des Américains.
La doctrine Monroe, ainsi nommée bien après que James Monroe l'eut proposée, est passée d'une notion liée à l'indépendance américaine vis-à-vis de l'Europe à un impératif de dépendance latino-américaine vis-à-vis des États-Unis et de leur politique étrangère néocoloniale. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les États-Unis ont osé s'appeler simplement « l'Amérique ».
Après la publication de la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine en novembre dernier, le spectre de l'ancienne doctrine refaisait surface. Avait-elle vraiment été enterrée ? Beaucoup l'ont commenté et le commentent à nouveau, à juste titre, après l'invasion américaine du pays sud-américain. Mais pour comprendre le rôle des États-Unis, cette doctrine devait être complétée par une autre référence : la politique du Big Stick (« Grand Bâton ») mise en place par Theodore Roosevelt au début du XXe siècle, qui a complètement défini le double standard de l'attitude américaine envers le reste du monde, et principalement envers les autres pays du continent : s'affilier à ses intérêts (en tant que filiale de second ordre, bien sûr) ou faire face à la menace constante d'une intervention militaire. Un cynisme qui, comme l'a souligné l'anthropologue Paula Sibilia dans son livre Yo me lo merezco (Taurus, 2024), n'a fait que se consolider sur le terrain moral de notre époque avec des exemples tels que celui de Donald Trump et son autoritarisme compétitif.
Cynisme américain et échec vénézuélien
Mais le précédent d'un tel cynisme venait de loin, puisqu'il résonnait déjà dans la célèbre phrase apocryphe attribuée à Franklin D. Roosevelt : « Somoza (en référence au Nicaraguayen Tacho Somoza) est peut-être un fils de pute (son of a bitch), mais c'est notre fils de pute ». Apocryphe ou non, cette phrase résumait parfaitement le pragmatisme sans scrupules qui définissait la vision américaine du monde et son intérêt persistant à maintenir à tout prix son hégémonie dans celui-ci. Son nouveau document sur la sécurité nationale poursuivait dans la même veine, affirmant l'intention du gouvernement Trump de veiller à ce que l'Amérique reste « la puissance mondiale la plus forte, la plus riche, la plus puissante et la plus prospère dans les décennies à venir ». Pour sa part, la déclaration de Pete Hegseth, secrétaire à la Défense, pour qui il était impossible « d'instaurer la paix dans ce monde dangereux sans recourir à la force », actualisait le vieux slogan de Reagan et rappelait au passage le célèbre et belliqueux adage latin : si vis pacem, para bellum (« si tu veux la paix, prépare la guerre »). Était-ce là la seule chose à laquelle nous pouvions nous attendre : un monde de violents pacificateurs ?
Cependant, rien de tout cela ne servait à blanchir naïvement ou par intérêt l'image du projet politique lancé par Hugo Chávez en 1999, il y a près de vingt-six ans. Ses promesses initiales, qui ont tenté de se concrétiser dans certains programmes sociaux prometteurs visant à lutter contre l'extrême pauvreté du pays et à développer les services médicaux, éducatifs et culturels pour les populations les plus vulnérables, ont peu à peu échoué au milieu d'une crise structurelle qui s'est aggravée après la mort du leader militaire en 2013. À l'arrivée de Nicolás Maduro, un personnage très éloigné du charisme de Chávez, mais à qui ce dernier a décidé de passer le relais, se sont ajoutés des problèmes liés à l'inflation et la dévaluation monétaire. Au milieu d'accusations répétées de corruption et d'actes répressifs visant à mettre fin à toute opposition au pouvoir en place, les dernières élections de 2024, marquées par l'ombre de la fraude, ont encore plus brouillé les cartes. Le refus du gouvernement de montrer les bulletins de vote – ce qu'exigeaient notamment le Chili, la Colombie et le Brésil – a provoqué de violentes manifestations dans les rues, qui ont été réprimées avec violence, faisant de nombreux morts et blessés selon Amnistie International.
Brève chronique d'un Venezuela perdu
Mais cette situation ne pouvait pas non plus être attribuée uniquement à la dérive autoritaire du chavisme, dont l'histoire allait non seulement de pair avec le boycott obsessionnel des États-Unis à l'égard de tout écart par rapport à la discipline idéologique conçue par le capitalisme de Washington et ses institutions, mais était également le résultat des antécédents de l'histoire vénézuélienne elle-même et de ses dilemmes tant politiques qu'économiques. D'une part, le pays était confronté à la dissolution du pacte dit de Puntofijo, signé en 1958 par les principaux partis nationaux (AD, COPEI et URD) après le renversement de la dictature du général Marcos Pérez Jiménez ; d'autre part, il voyait comment la détérioration lente mais progressive de son économie interne, à la suite de la chute du prix du pétrole, aggravait les inégalités sociales dans de larges secteurs de la population. La dépendance vis-à-vis des revenus pétroliers avait en effet été un fardeau qui pesait sur l'histoire nationale, et que les gouvernements successifs n'avaient pas réussi à surmonter. « Semer le pétrole », métaphore expressive utilisée par l'écrivain et homme politique Arturo Uslar Pietri, était devenu une tâche aussi urgente qu'impossible.

C'est précisément dans ce contexte de crise économique aggravée que le lieutenant-colonel Hugo Chávez Frías a fait son apparition sur la scène historique vénézuélienne, six ans avant sa victoire électorale. Sa tentative ratée de coup d'État en 1992 a donné un visage à une insurrection qui rappelait les coups d'État militaires dans le pays, et même dans toute l'histoire du continent. Cependant, cette révolte était également l'expression d'une détérioration réelle des conditions de vie de milliers de personnes qui subissaient les conséquences des mesures économiques du président Carlos Andrés Pérez, imposées par le Consensus de Washington et ses institutions phares : le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale. Pérez avait annoncé un ensemble de mesures alignées sur les dispositions ultra-néolibérales des États-Unis. Cette décision a entraîné une hausse du prix des services de base et elle a provoqué une vague de troubles connue sous le nom de « Caracazo » (bien qu'elle ne se soit pas limitée à la capitale du pays), qui a été réprimée en quelques jours par le ministre de la Défense de l'époque, le général Ítalo del Valle, qui a ensuite été accusé, une fois Chávez au pouvoir, pour son action pendant ces jours-là. Je garde encore en mémoire certaines images de cet événement.

Agrandissement : Illustration 4

Cependant, un quart de siècle après ses débuts, nous pouvons affirmer que le chavisme, malgré toutes les illusions qu'il avait suscitées, n'a pas non plus été capable d'articuler une politique globale qui échappe à la « monoculture » pétrolière et développe le pays dans des secteurs stratégiques. L'espoir d'un socialisme latino-américain offrant une alternative au capitalisme le plus prédateur a succombé à la discipline partisane la plus vulgaire et typique, consistant à réduire la réalité à sa guise, en fonction de slogans idéologiques grossiers, très commodes pour la nouvelle élite politique et économique installée au pouvoir. Une fois cet échec douloureux consommé, l'attaque des États-Unis contre la souveraineté du Venezuela, bien qu'illégale, confirmait leur volonté résolue de réintroduire à tout prix la discipline interrompue dans la région, afin de sauver leurs intérêts dans un monde en pleine mutation. Il s'agissait d'une réponse en phase avec le climat généré par la montée en puissance des gouvernements d'extrême droite dans plusieurs parties du monde, qui lui était favorable, mais aussi proportionnelle à la tentative désespérée d'empêcher son hégémonie de décliner dans un monde qui lui était devenu hostile. Il n'était plus nécessaire de parler de Guerre Froide, car il suffisait de constater à quel point les nouveaux termes de « multipolarité et de « multilatéralité » remettaient en cause son hégémonie.
Je crains les gringos, même lorsqu'ils apportent des cadeaux
Mais la joie initiale de beaucoup face à l'opération militaire américaine a été rapidement balayée par les déclarations ultérieures de Trump, qui a affirmé ne pas avoir parlé à l'opposante María Corina Machado et ne pas la reconnaître comme une véritable figure de proue au Venezuela. Au lieu de cela, le président a déclaré que ce seraient les États-Unis qui prendraient le contrôle de la « transition démocratique » vénézuélienne, ce qui laissait entrevoir son désir impérieux de piller ses ressources pétrolières, en bloquant au passage leur acheminement vers Cuba, l'Iran, la Russie ou la Chine.
C'était une déclaration surprenante, étant donné que Trump lui-même avait reconnu un an auparavant Edmundo González comme président élu du pays, mais c'était aussi le prix de la lucidité que devaient payer ceux qui croyaient que les Américains menaient des opérations militaires et envahissaient des pays dans le but de rétablir la démocratie et de promouvoir le bien-être de tous les peuples de la terre. C'était aussi ridicule que de se fier à leur leadership pour mener à bien tout processus de transition politique dans le monde. Il suffisait de se rappeler ce qui s'était passé en Irak après son invasion en 2003 sous le prétexte des armes qui n'avaient jamais existé.
Beaucoup continuent pourtant de faire preuve d'une fatale naïveté historique, incapables d'accepter que les Américains n'apportent pas de cadeaux, ou que s'ils en apportent, c'est encore pire. Timeo gringos et dona ferentes. Je crains les gringos, même lorsqu'ils apportent des cadeaux. C'est quelque chose que ne voient pas non plus ceux qui réclament ici, au Mexique, une intervention militaire pour mettre fin au crime organisé, comme si celui-ci aurait pu exister sans la complicité simultanée du régime américain et ses jeux déloyaux, habitués à utiliser la lutte contre la drogue comme une arme ambiguë : utile pour financer certaines opérations particulières, mais également prête à justifier une intervention militaire dans certains pays.
Cela s'est produit avec Noriega, que les États-Unis ont accusé d'avoir des liens avec le cartel de Medellín, et cela se reproduit aujourd'hui avec Nicolás Maduro, accusé d'association illicite avec le cartel de Sinaloa. Que cette accusation soit fondée ou non n'est pas la seule question ici, mais aussi son utilité pour dissimuler la collusion historique du géant du Nord avec les dividendes tirés du trafic illégal, comme l'a révélé en son temps l'héroïque journaliste Gary Webb (mort dans des circonstances étranges à l'âge de 49 ans seulement), et comme l'a de nouveau exposé Seth Harp en 2025 dans son ouvrage The Fort Bragg Cartel (Viking, 2025), qui enquête sur les liens entre certains militaires américains et un groupe criminel qui leur est propre.
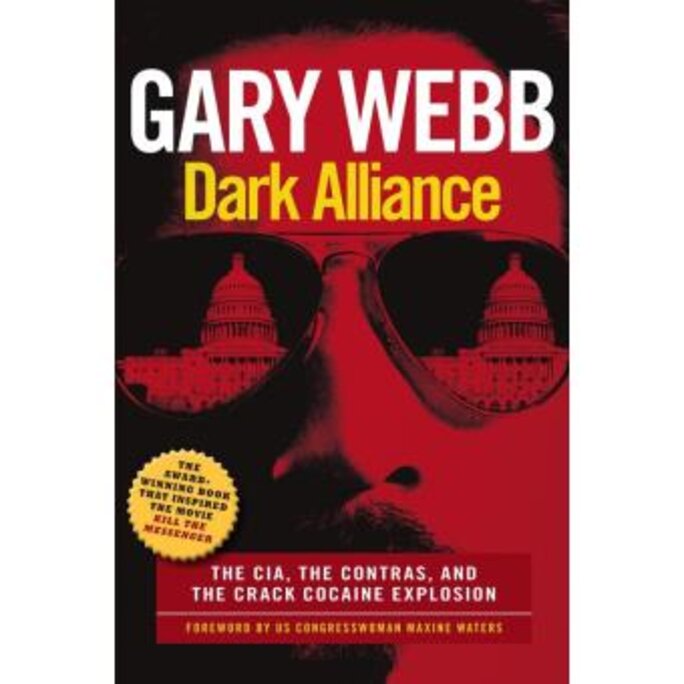
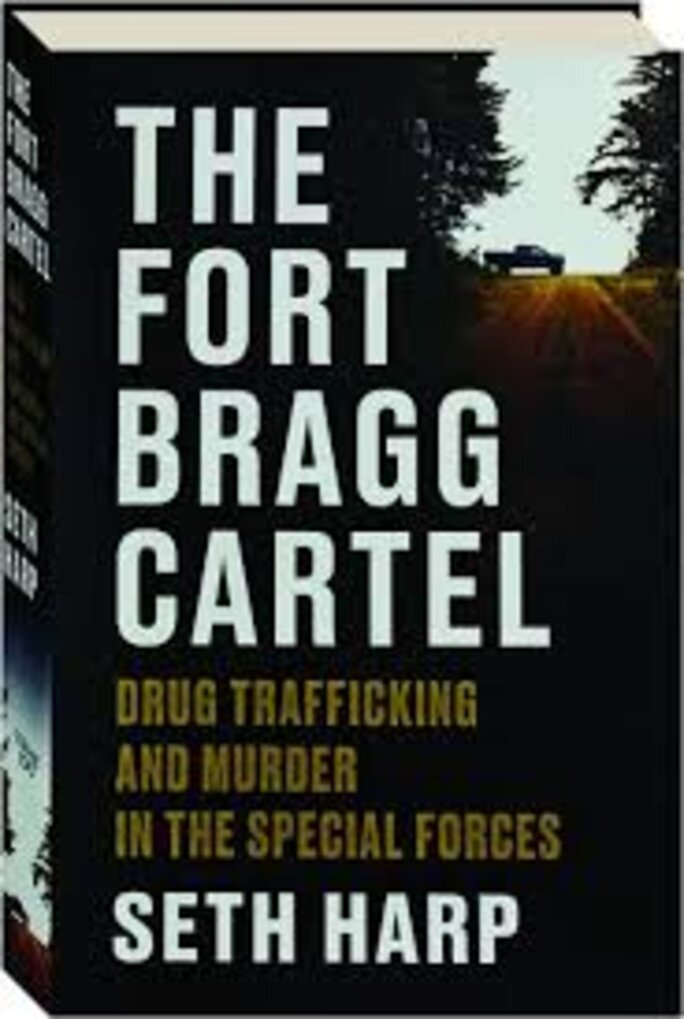
Coda
À défaut de savoir ce qui se passera dans les prochains mois, ce qui semble clair c'est qu’au Venezuela n'est ni la paix ni la liberté qui sont arrivées, mais la victoire. Il apparaît également que ces événements affaiblissent l'ensemble de l'hémisphère et détruisent encore davantage la crédibilité du droit international, au profit du seul recours à la force.
Cela signifie qu'en guise d'alternative aux excès de Maduro et à la ruine du tournant politique latino-américain autrefois prometteur, la seule voie qui s'ouvre désormais est celle des abus d’un impérialisme américain affaibli et de son plus haut représentant politique. La seule liberté dont on parle dans un tel contexte est celle qui est aujourd'hui manipulée par les cris de haine de la farce ultralibérale, capable de défendre une attaque militaire étrangère au nom de sa prétendue volonté de lutter contre le trafic de drogue et, en même temps, proposer un livre qui vante la valeur économique des proxénètes et des trafiquants (comme l'a fait récemment Javier Milei en Argentine).
C'est cette fausse liberté qui célèbre comme un champion de la paix un délinquant condamné pour plusieurs délits de falsification de documents. Tel est le monde délirant dans lequel nous vivons et où tant de gens s'agressent avec une véhémence aveugle, vociférant leurs affinités ou leurs phobies : aujourd'hui entre Maduro et Trump, comme hier entre Poutine et Zelenski, le Hamas et Netanyahu, le christianisme et l'islam. Un monde dans lequel il semble que la valeur de la conjonction négative « ni » n'ait jamais existé, et où meurt avec elle la seule liberté réelle, celle de penser et de vivre de manière intempestive, véritable, contre une vie outragée par le cynisme de tous et chacun des tyrans de ce nouvel ordre.



