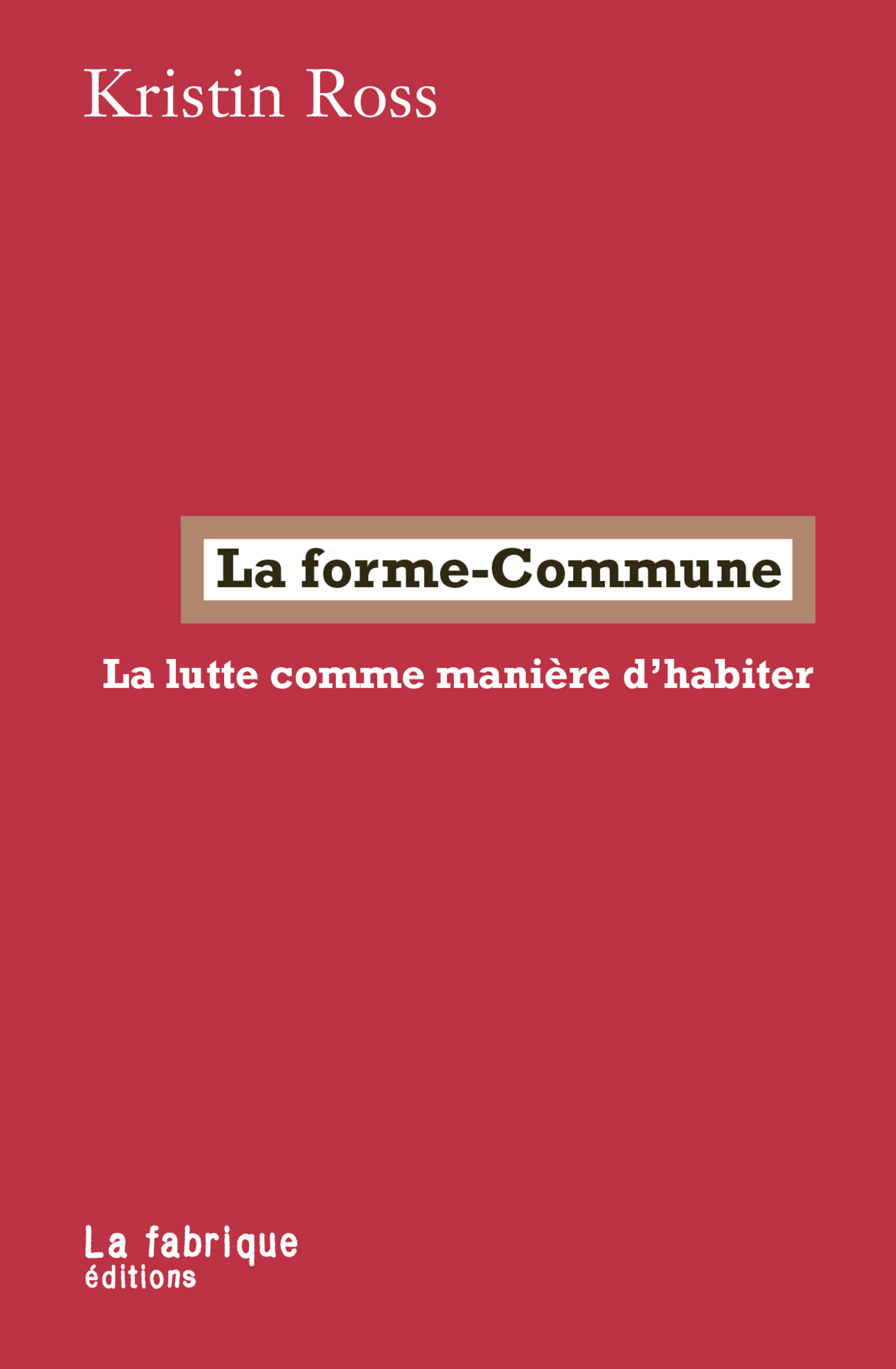Bienvenue dans la "Commune libre de Tolbiac". Au Printemps 2018, le site Pierre-Mendès-France de l’université de Paris I fut bloqué et occupé par des étudiants révoltés contre la loi « Orientation et réussite des étudiants » (ORE) portée par la ministre Vidal. En pratiquement trois semaines, ce fut une sorte de micro-société qui s’installa dans les locaux universitaires. Ce cinquantième anniversaire de Mai 68 fut réprimé sauvagement par les CRS...
La Commune fait encore rêver les révolutionnaires de tous les pays, du Japon à l’Amérique du Nord en passant par la France et le Chiapas. C’est pourquoi Kristin Ross, historienne américaine et militante marxiste, a souhaité sortir en 2023 aux éditions La Fabrique un petit livre rouge sur la « forme-Commune », c’est à dire sur les luttes comme manière d’habiter et de s’approprier les Communs, les terres, les quartiers, les villages…
Introduction :
Marx voyait dans la Commune de Paris en 1871 la forme politique permettant de réaliser l’émancipation économique des travailleurs. La forme Commune, ce sont des gens qui vivent différemment et qui changent leur propre situation en œuvrant dans les conditions du présent. En prenant en main leurs existences, les travailleurs démantèlent l’État pas à pas, ses hiérarchies, ses fonctions et ses services (rendus superflus).
Kropotkine remontait plus loin. La Commune émerge pour lui dès 1789 avec les districts et surtout la Commune insurrectionnelle de Paris. Elle se diffusa ensuite dans les campagnes françaises lors de la Grande Peur en août 1789 avec cet idéal de la possession de la terre en commun et de soulèvement des communes villageoises. Dès que l’État recule, les communes et leur mode de vie alternatif s’épanouissent !
L’apport d’Henri Lefebvre dans cette réflexion est déterminant. La forme Commune permet de dépasser la logique capitaliste en reprenant le contrôle du temps et de l’espace vécus. Des mouvements comme le zadisme ou les Soulèvements de la Terre réinventent au XXIe siècle des formes de vie communales dans les campagnes , fondées sur l’intimité avec la terre et associées à la subsistance et à la figure du paysan.
I/ Nantes plutôt que Nanterre :
La convergence des prolétariats :
En mai-juin 1968, Nantes fut une ville autogérée. L’énorme usine de Sud-Aviation se mit en grève. Des coopératives paysannes alimentèrent les grévistes (gratuitement ou à prix coûtant) en produits de ferme. Un Comité central de grève (ouvriers, paysans et étudiants) se mit en place dans l’Hôtel de Ville et prit en charge la garderie des enfants, le ramassage des ordures, le ravitaillement en essence et en denrées alimentaires.
A Nanterre, les rencontres entre les étudiants du campus ultra-moderne et les immigrés du bidonville furent précaires en 1968. En revanche, à Nantes, les rencontres entre les ouvriers (souvent d’origine rurale) et les paysans (souvent prolétarisés) organisées par l’entremise des étudiants gauchistes ou « maos » permirent de rompre avec cette antique méfiance entre les prolétariats des villes et des campagnes.
Cette « dualité du pouvoir » a été théorisée par Lénine. En 1917, les soviets (ou comités ouvriers) apportèrent dans le dos du gouvernement étatique, de nombreux services quotidiens aux Russes. Il s’agit en fait de devenir autosuffisant par rapport à l’État afin de rendre les services de ce dernier superflu. Des pratiques anciennes de solidarité sont réactivées et de nouvelles démarches collectives sont inventées.
Plus que par une lutte idéologique, il s’agit ici de transformer radicalement le quotidien pour en faire une affaire collective. La révolution de la vie quotidienne se fait à une échelle que les gens peuvent reconnaître. A Nantes en 1968, on assista à une ébauche de ce à quoi pourrait ressembler la vie si l’infrastructure d’une ville et de ses campagnes environnantes était autogérée en commune insurrectionnelle !
Le surgissement de la petite paysannerie familiale :
On retrouve cette lutte dans le Larzac entre 1971 et 1981. Là, des éleveurs de brebis du plateau se dressent pour sauver leurs pâturages que le gouvernement veut transformer en base militaire. Des milliers de militants de gauche parcoururent des milliers de km pour les soutenir et squatter le Larzac. On retrouve cette dynamique avec les ZAD actuelles rassemblant paysans, élus, citadins, naturalistes et militants.
Les paysans commençaient à comprendre bien avant 1968 les menaces de l’État et du capitalisme sur l’agriculture traditionnelle. Les agriculteurs modernisateurs sont criblés de dettes pour acheter leurs engrais, leurs machines et leurs pesticides. Une nouvelle gauche paysanne (symbolisée par les Paysans-Travailleurs de Bernard Lambert) défend l’autonomie régionale et la protection de la biodiversité !
Des paysans semblant venus du passé le plus lointain (par leur économie du subsistance comme leur rythme quotidien déconnecté du capitalisme) se heurtèrent au présent libéral pour défendre l’agriculture familiale qui a fait ses preuves. Anachronique, cette petite paysannerie utilise son conflit avec le présent capitaliste pour devenir un grain de sable dans l’engrenage de la machine industrielle ou (et) étatique.
L’économie paysanne préserve l’autonomie de la famille, le savoir de la terre et de ses usages, la mémoire et l’histoire. L’agriculture capitaliste détruit les pratiques ancestrales en privilégiant le profit individuel et la concurrence. La vie agraire est donc pour Kristin Ross le fondement nécessaire de toute économie alternative, de toute société alternative. Elle représente la possibilité d’un nouvel avenir politique.
II/ Le conte des trois aéroports :
Narita, Notre-Dame des Landes et Mirabel :
A la fin des années 1960, des paysans japonais en périphérie de Tokyo se dressent contre le projet du nouvel aéroport de Narita. Les paysans sont rapidement soutenus par les étudiants de la Zengakuren (ultra gauche japonaise) et les combats sont de plus en plus violents. Des morts émaillent les contestations des années 1970 mais le mouvement social échoue et le premier avion se pose en 1978…
Au même moment, le gouvernement français du général De Gaulle décide de créer un nouvel aéroport dans le bocage au nord de Nantes. Une Zone d’aménagement différé (ZAD) est crée en 1974 afin de commencer l’expropriation des paysans qui travaillaient et vivaient dans ces bocages, bois et champs. Paradoxalement, ce projet d’aéroport a freiné logiquement l’étalement urbain, sauvegardant le bocage jusqu’à aujourd’hui.
En 1976, la plus grande opération d’expropriation foncière du Canada se déroule en périphérie de Montréal à Mirabel. Les paysans acceptent les offres de rachat et le nouvel aéroport ouvre en 1975. Les paysans, arnaqués, n’ont pas assez d’argent pour se réinstaller sur des terres comparables. Ces expropriations ont profité à de gros propriétaires agro-industriels. L’aéroport titanesque de Mirabel n’a jamais vraiment prospéré de son côté.
Dans les cas de Narita et Mirabel, l’État impose des infrastructures pharaoniques quitte à augmenter la dette publique (les coûts sont sans cesse dépassés, les défaillances sont nombreuses…) au profit des capitaux privés. A ces désastres économiques s’ajoutent d’énormes destructions environnementales. Ces méga-projets sont en plus inutiles car ils font doublon avec les aéroports internationaux existants (dans les trois cas).
Développement contre économie de subsistance :
La logique du monde aérien est consubstantielle de celle du capitalisme mondial. Les aéroports, avec le « culture du mall » (de luxe) et les avions avec leur « absence de frottement » prouvent que l’espace mondial est fongible. Cette modernisation capitaliste exècre les « vestiges du passé » (comme la paysannerie familiale) qui ont leur propre économie et des rythmes de vie bien différents.
Le capitalisme mène depuis les années 1960 la guerre à l’économie de subsistance. Cette dernière a ses propres solidarités, une vie sociale bâtie sur les échanges de services, ses coopératives informelles (sur les modèles de coopération ou d’association chers à Marx). Le développement capitaliste ne peut s’accommoder des luttes défendant les bases écologiques de la vie. Ces nouvelles luttes qui défendent les conditions de vie sur la Planète sont le nouvel horizon de toutes les luttes !
III/ Défense, appropriation, composition et restitution :
Défense :
La forme Commune, c’est faire acte de se défendre, défendre un territoire et ses habitants. A Narita, les paysans japonais défendaient la cohérence et l’intégrité du village ancestral et corps communal. A Notre Dame des Landes, les zadistes et paysans défendaient le bocage et les zones humides. Il s’agit en fait de défendre ce que l’on aime, ce que l’on possède collectivement et qui mérite donc qu’on se batte pour lui/elle.
Le geste de défense commence par la proclamation d’une valeur, celle du « luxe communal » (selon les mots du communard Eugène Pottier). Il s’agit de créer de la « beauté publique » pour améliorer l’environnement vécu et permettre aux habitants de vivre et travailler dans un cadre agréable. L’art et la beauté sont intégrés dans la vie quotidienne pour que chacun ait droit à sa juste part « du meilleur ».
Comme ces « guerres » de défense sont souvent prolongées sur des décennies, elles exigent des occupants qu’ils créent sans arrêt de nouvelles manières d’habiter le conflit. Se battre pour un lieu précis, c’est plus intense que se battre pour une idée. Il n’y a pas de problème à résoudre mais un ennemi à abattre.D’une terre à défendre, on défend également petit à petit de nouveaux liens sociaux, des solidarités, des rapports affectifs et des entremêlements vécus produits par la lutte.
L’environnement peut être « reçu, fait et refait », activement façonné et achevé dans et par le travail, le jeu et la bataille. Cet environnement approprié crée une expérience à partir de laquelle on peut mieux percevoir le reste du monde et s’y confronter. Défendre le territoire, c’est défendre le projet de vie collectif (cultiver la terre, s’occuper des animaux et des enfants, construire un lieu d’assemblée, constituer une bibliothèque…).
Appropriation :
Les zadistes de Notre-Dame des Landes ont été engagés dans une recherche consciente de modèles qui pourraient les aider à perpétuer une vie à l’écart du monde organisé par l’État et le capitalisme. Certains regardant dans le passé (la Commune de Paris), d’autres ailleurs (le Chiapas), on construisait un espace de transformation et d’expérimentation sociales et collectives.
Par exemple, le « Cycle des Douze » à Notre Dame des Landes permettait de régler les litiges ou les comportements antisociaux dans la communauté. Médiateurs tirés au sort chaque mois, les « Douze » imaginaient des solutions possibles à la dispute ou déterminaient des formes de compensation pour les personnes lésées. On trouvait en commun une solution locale au problème sans recourir aux textes de lois ou aux codes moraux intemporels.
La « journée de travail » était sur la ZAD d’une élasticité temporelle, oscillant entre droit à la paresse et grands efforts collectifs. Les travaux saisonniers entremêlés par la densité des interactions sociales provoquaient une fatigue intense mais satisfaisante psychiquement. L’effort collaboratif pour résoudre les problèmes pratiques supposait des flux d’improvisations, d’échanges, de savoir-faire, de consultations et d’interruptions.
C’est le « temps approprié » théorisé par Henri Lefebvre. Le temps ne se compte plus, il advient et survient quand une activité apporte la plénitude qu’elle soit banale, subtile, spontanée ou sophistiquée. On est à l’opposé des temps capitaliste et étatiques au coeur de l’aliénation, de la confiscation de nos propres vies. Lefebvre reprend Marx (« l’homme total » et les communautés paysannes) pour désaliéner et reconquérir le temps.
Le capitalisme réduit l’appropriation à des interactions et des rapports de propriété (posséder et avoir). L’aliénation concerne tous les domaines de la vie. Le tissu social se fragmente et se détruit, provoquant une sentiment d’obstruction et d’impasse. Le capitalisme nous dépossède de notre dignité, de notre vie sociale, de notre temps, du sentiment de maîtrise de nos vies, de la beauté et de la santé de notre environnement et la possibilité de travailler ensemble à des alternatives.
Ainsi, l’espace est pour Henri Lefebvre permet d’autres manières de produire, d’autres usages alternatifs échappant à la logique de possession. Les groupes et classes de personnes ne peuvent incarner une transformation sociale que s’ils produisent, s’approprient et contrôlent un espace physique et social. Ces espaces appropriés se développent le mieux dans les marges et les ratés du capitalisme comme les favelas d’Amérique latine.
L’appropriation suppose l’usage plutôt que la possession. Le « droit d’usage » et un droit à faire qui ignore la division juridique et spatiale du mien et du tien. Par la coopération et la socialisation progressive de l’ensemble de la population, les incursions contre l’idéologie propriétaire seront de plus en plus nombreuses pour constituer des espaces appropriés et des communes capables de perturber le flot régulier du libre-jeu du marché et son efficacité.
Composition :
La forme-Commune est pour Marx une « existence en actes ». C’est un mouvement politique autant qu’une élaboration d’un mode de vie désiré. C’est la « reprise par le peuple et pour le peuple de sa propre vie sociale ». La forme-Commune est à la fois spécifique et transmutable. L’échelon communal permet de se plonger dans les dimensions les plus basiques de la vie quotidienne (celles qu’ignorent les « gouvernants »).
La forme-Commune suppose un engagement permanent de ne pas mettre en place des rapports et des institutions sous une forme définitive et bornée mais à construire en permanence par l’improvisation collective et les confrontations créatrices la situation du moment. C’est un projet ouvert qui nous fait avancer vers un au-delà du capitalisme et de la bureaucratie étatique. Chaque commune est donc unique par son histoire, sa géographie, sa sociologie et ses défis.
Elle permet des alliances singulières entre paysans, occupants, précaires, vieux (comme à Notre Dame des Landes), entre indiens et non-indigènes (contre les pipelines en Amérique du Nord), entre des paysans, militants d’ultra-gauche et religieux (comme au Larzac), entre dockers, bobos et étudiants (dans la vieille ville de Valparaiso au Chili). Ces forces se contredisent et se complètent mais elles demeurent dépendantes les unes des autres.
Les pratiques y sont complémentaires. On renonce à essayer de convaincre l’autre car la diversité du mouvement fait sa force. Certains préfèrent la violence frontale avec les flics, d’autres le sabotage des machines, d’autres le montage des dossiers juridiques ou encore le recensement des espèces menacées. La force du mouvement provient de sa diversité, de la solidarité dans la diversité face à un ennemi commun (néolibéralisme, techno-capitalisme, complexe agro-industriel…).
Restitution :
Le coeur du combat est l’accès au terres, leur usage partagé et leur entretien en commun. L’être humain doit s’aliéner à l’égard de la terre pour l’autosuffisance économique et la sortie du consumérisme. La terre est aussi un point d’ancrage historique ainsi qu’un lieu de réunion. En effet, selon Elisée Reclus, toutes les terres arables doivent être détenues en commun (comme dans les sociétés dites « sauvages »).
L’érosion de l’idéologie propriétaire peut être favorisée par l’éducation politique et un lieu commun. Une terre sous-utilisée peut devenir un espace collectif pour se rassembler (comme les rond-points des Gilets Jaunes) ou une zone menacée de destructions peut être défendue à l’images des nombreuses ZAD du pays. Ces espaces libérés constituent des « embryons de pouvoir communal et de solidarités locales » échappant à la propriété et à la rationalité du marché.
Le rapport historique à la terre se doit d’être restauré par un processus continu de réapprentissage et de réinvention des pratiques conçues pour préserver la terre pour les générations futures. Les richesses du monde comme le travail créatif du passé sont une propriété commune qui doit être gérée collectivement. Selon Proudhon, les usages et les besoins du groupe doivent prendre le pas sur tout droit abstrait individuel comme celui de la propriété.
Conclusion :
Si la vie quotidienne est aliénante, c’est en partant d’elle que l’on peut se désaliéner et changer la société. Ce sont les « territoires existentiels » de Félix Guattari qui s’écartent des normes capitalistes. André Gorz voit également dans la vie quotidienne une manière de penser des aliénations ainsi que toutes les tentatives pour les dépasser. Les gens deviennent les sujets de leur propre vie grâce au temps de la coopération remplaçant le temps salarié.
C’est l’ambition de mouvements comme les Soulèvements de la Terre dont l’histoire remonte aux années 70. Il faut dépasser l’aliénation à l’égard de la terre et relier les luttes écologiques et paysannes de l’échelle locale à l’échelle mondiale. Par des actions spectaculaires et massives contre les centres industriels ou de l’agro-business, ces mouvements font de l’éducation populaire pour ces militants (et autres) hétéroclites politiquement, géographiquement et socialement.
Les alliances conjoncturelles que les SdT arrivent à créer entre les collectifs sont possibles grâce à ces luttes écologiques locales qui suscitent souvent plus d’adhésion et d’espoir que bien d’autres combats politiques parfois très idéologiques. Il y a un risque que ces batailles apparaissent trop locales et déconnectées d’une vision planétaire. Mais les SdT basent leurs actions sur des lieux de vie concrets en ranimant le mode ancien pour mieux répondre à l’avenir !
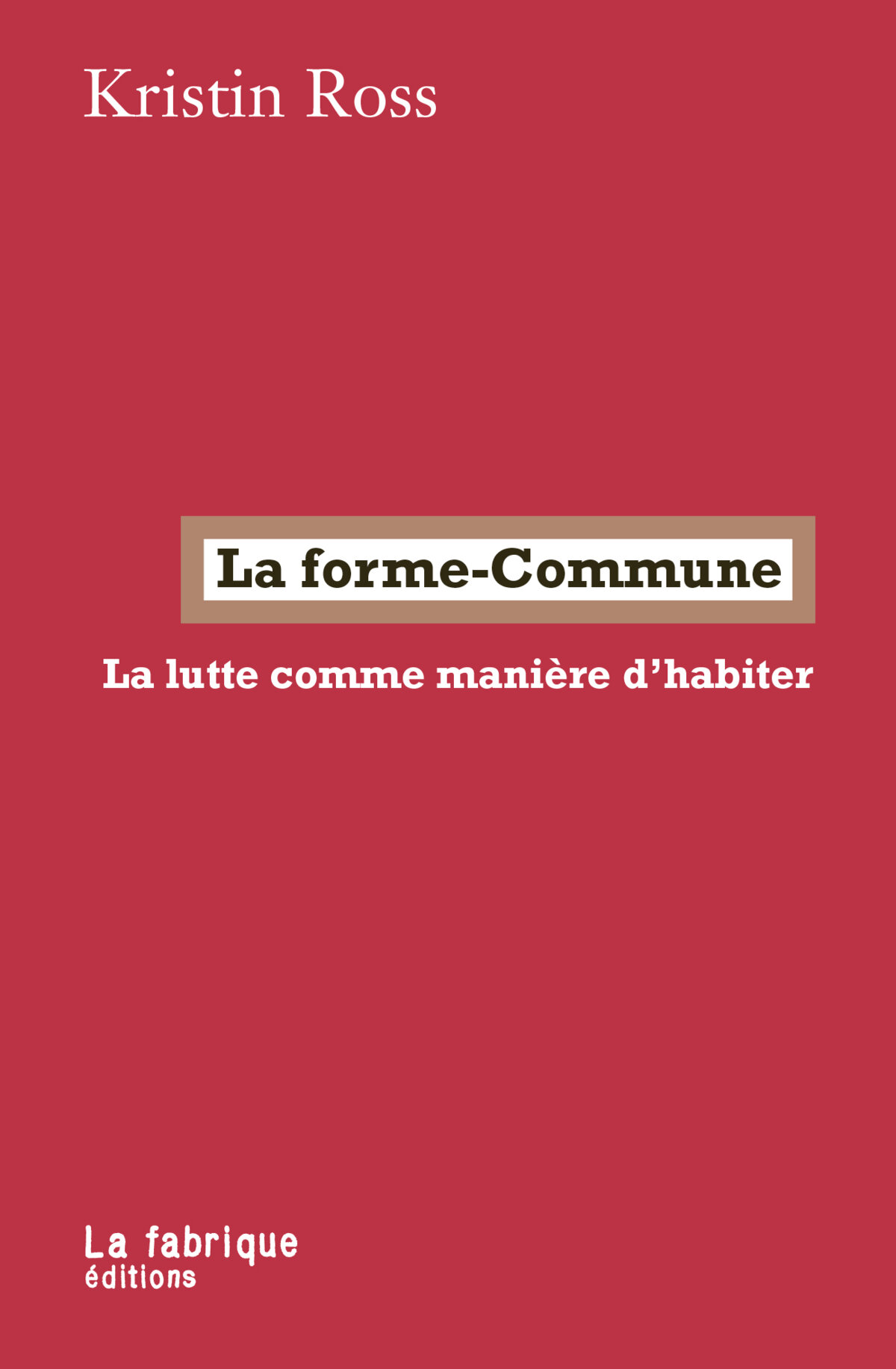
Agrandissement : Illustration 1