Chapitre XIX : Où Démocrite rencontre Auguste Comtus
Résumé des épisodes précédents : Le sage Démocrite et son jeune compagnon, Protagoras, ont rencontré Sarkominus. Ayant reçu, quelques dizaines d’années plutôt, une lettre d’Auguste Comtus contenant des prédictions sur le règne de Sarkominus, Démocrite a jugé à propos d’enquêter afin d’éclaircir la question des « prémonitions » qui défient sa philosophie radicalement matérialiste. Pour pousser plus loin son enquête, Démocrite est descendu aux enfers pour y rencontrer Auguste Comtus. Pendant ce temps, Sarkominus a prit la tête d’une armée pour conquérir l’Olympe, armée que Protagoras et Orphée accompagne.
1. Où Protagoras raconte la morne avancée des troupes de Sarkominus sur l’Olympe
Je n’ai rien, ou presque, à raconter de notre journée de marche vers l’Olympe, sinon que la tension, à mesure que nous approchions du séjour des dieux, devenait de plus en plus palpable et que les désertions se multipliaient. Plus personne n’osait adresser la parole à Sarkominus, de crainte de le voir s’emporter. Au soulagement général, Sarkominus parvint à se détendre et à retrouver son humeur faconde en apprenant comment les pirates de Cyrénaïques, qui servaient comme supplétifs dans ses légions de Libye, avaient lyncher Muhammad le Tripolitain.
« - Mon cher Béhachelus, comme vous m’avez bien conseillé durant cette guerre, s’exclama le tyran. Savez-vous que la première mesure qu’ont annoncé nos amis les pirates de Cyrénaïque, c’est le rétablissement de la polygamie. Une mesure qui doit vous enthousiasmer ! » (1).
« - Moyennement, répondit le philosophe. Quoique je doive reconnaître que nos amis les pirates sont sur la voie du progrès. Sans doute sont-ils encore loin de réaliser sur Terre l’utopie de mon maître, Platon, qui prescrit que « les femmes de nos gardiens [de la révolution idéaliste] seront communes, toutes à tous ; aucune n’habitera en particulier avec aucun d’eux [et] elles quitteront leurs vêtements, puisque la vertu leur en tiendra lieu » (2). Mais la polygamie a le mérite de libérer la femme du sentiment aliénant qu’elle pourrait devenir propriétaire exclusive d’un homme. Gageons que, grâce à sa nouvelle condition, la femme, n’en développera que mieux son sens du partage et saura se faire l’inspiratrice d’une nouvelle éthique qui rendra la société plus généreuse. »
« - C’est aussi ce que m’enseignait mon précepteur Auguste Comtus, approuva Sarkominus. Les femmes sont des daimôn, des êtres qui tiennent le milieu entre les hommes et le monde idéal. »
Sarkominus et Béhachélus devisèrent longuement sur l’Idée de la femme… Mais, pour faire bref, j’irais directement à la retranscription des dernières pages du journal de Démocrite.
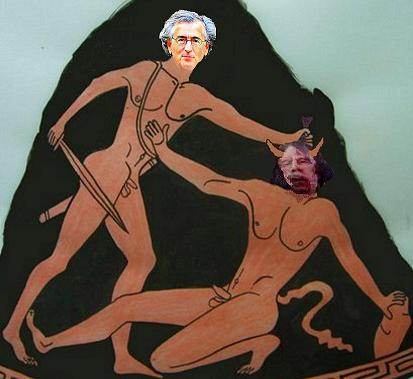
Béhachélus, héros civilisateur du Pays de Droite - Assiette cassée
2. Où Démocrite présente le jeune Môquetus
Eurydice me conduisit jusqu’à la vallée des « Innocents condamnés à mort », pour y retrouver le jeune Môquetus. Ce garçon et Eurydice doivent m’assister quand je partirais à l’assaut des murailles du Tartare.
Je dois dire un mot sur ce garçon au visage d’enfant. Son destin est connu : fils d’un sénateur plébéien emprisonné, il fut mis à mort dans les temps obscurs où les Teutons ravagèrent l’Europe. Pour venger la mort de l’un des siens, le tyran des Teutons exigea le supplice de cinquante otages, et Môquetus fut l’un des suppliciés.
Môquetus laissa, avant de mourir, une missive. Sarkominus semble attacher le plus grand prix à cette lettre au point d’exiger que tous les enfants du pays de Droite l’apprennent par coeur. Sarkominus justifie ainsi son intérêt pour ce texte : « Les plus petites paroles d’amour qu’un grand garçon de 17 ans adresse à sa mère et à son père prennent une grandeur tragique quand ce sont les dernières, non parce que la vie va cesser mais parce qu’après il ne sera plus possible d’aimer. J’ai suffisamment d’expérience de la vie, de ses épreuves comme de ses joies pour vous le dire avec certitude. Aimer, c’est la seule chose qui compte vraiment. Seront plus heureux ceux qui parmi vous le comprendront avant qu’il ne soit trop tard. » De la lettre de Môquetus, Sarkominus semble ne retenir que sa charge de pathos.
Ceci m’évoque une anecdote racontée Hérodote (3). L’historien rapporte la réaction des Athéniens devant une pièce du poète Phrynichus. Cette pièce représentait la prise de la ville de Milet et le massacre de ses habitants par les Perses : « Le théâtre fondit en larmes à la représentation de la tragédie de Phrynichus ; et après ils condamnèrent ce poète à une amende de mille drachmes ; de plus, ils défendirent à qui que ce fût de jouer désormais cette pièce. » La censure est un acte fort rare à Athènes. Si la pièce de Phrynichus fut frappée d’interdit, c’est parce qu’elle représentait l’horreur à l’état pur, le poète ayant fait le choix de la lancée l’horreur au visage du spectateur sans l’accompagner du moindre commentaire. Phrynichus trahissait les conventions de la tragédie, où l’horreur n’est montrée qu’autant qu’un Chœur, médiateur entre le public et le spectacle, met des mots sur la cruauté exhibée. Ce que l’on reprochait à Phrynichus, c’était d’abrutir le public en lui offrant l’extase que procure le spectacle de la violence brute, dont la puissance est de faire voler en éclat la pensée.
Pourquoi jeter à la face des enfants, sans commentaire, la lettre d’un mort ? Relisons ce texte :
« Ma petite maman chérie, Mon tout petit frère adoré, Mon petit papa aimé, Je vais mourir ! Ce que je vous demande, toi, en particulier ma petite maman, c’est d’être courageuse. Je le suis et je veux l’être autant que ceux qui sont passés avant moi. Certes, j’aurais voulu vivre. Mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c’est que ma mort serve à quelque chose. Je n’ai pas eu le temps d’embrasser Jeannus. J’ai embrassé mes deux frères Rogerus et Rinoüs. Quant au véritable je ne peux le faire hélas ! J’espère que toutes mes affaires te seront renvoyées elles pourront servir à Sergeus, qui je l’escompte sera fier de les porter un jour. A toi petit papa, si je t’ai fait ainsi qu’à ma petite maman, bien des peines, je te salue une dernière fois. Sache que j’ai fait de mon mieux pour suivre la voie que tu m’as tracée. Un dernier adieu à tous mes amis, à mon frère que j’aime beaucoup. Qu’il étudie bien pour être plus tard un homme. 17 ans 1/2, ma vie a été courte, je n’ai aucun regret, si ce n’est de vous quitter tous. Je vais mourir avec Tintinus, Michelus. Maman, ce que je te demande, ce que je veux que tu me promettes, c’est d’être courageuse et de surmonter ta peine. Je ne peux en mettre davantage. Je vous quitte tous, toutes, toi maman, Sergeus, papa, en vous embrassant de tout mon cœur d’enfant. Courage ! Votre Môquetus qui vous aime. Dernières pensées : Vous tous qui restez, soyez dignes de nous, les 27 qui allons mourir ! »
Examinons attentivement le texte : Môquetus n’est pas naturellement porté au sacrifice et la mort n’exerce aucun attrait sur lui : « j’aurais voulu vivre », affirme-t-il. Môquetus écrira d’ailleurs, le même jour, un autre billet, moins connu, adressé à Odettia, jeune fille de 17 ans, qu’il surnommait « Épinard ». « Ma petite Odettia, Je vais mourir avec mes 26 camarades, nous sommes courageux. Ce que je regrette est de n’avoir pas eu ce que tu m’as promis. Mille grosses caresses. De ton camarade qui t’aime. Grosses bises à Marie et à toutes. Mon dernier salut à Rogerus, Rinoïus, (la famille) et Jeannus Mercierus » (4) La promesse d’Odettia, c’était de lui faire un « patin. » Môquetus, donc, aurait voulu vivre et fourrer sa langue dans la bouche d’« Épinard », surnom taquin, et néanmoins évocateur, puisqu’il contient les homophones enivrants « pine » et « pinard ».
Dans sa lettre Môquetus s’emploie à consoler ses parents en les invitant à vivre ce songe : il vivra, tente t-il de les convaincre, à travers son jeune frère, Sergeus, le petit frère « adoré », qui portera un jour « fièrement » ses vêtements, qui étudiera et deviendra « un homme. » Le frère réalisera ce que lui-même, massacré à la fin de l’enfance, ne pourra être. Son vœu ne se réalisera pas : Sergeus, apprenant la mort de son grand Môquetus – la tragédie est insatiable ! – tomba malade et mourut quelques jours plus tard, déguisé en fille, alors que sa mère l’emportait pour fuir ceux qui venaient l’arrêter.
Ce garçon voulait vivre et pourtant il encouragera ses 25 compagnons à marcher fièrement vers le martyr. Ses compagnons, invoquant sa jeunesse, lui proposèrent de fomenter une révolte dans le camp, pour obtenir que sa vie – la sienne, à lui, qui était si jeune -, soit épargnée. Mais il refusa leur offre et décida de les accompagner vers la mort.
Pourquoi ? La lettre nous le laisse deviner. « Je n’ai pas eu le temps d’embrasser Jeannus. J’ai embrassé mes deux frères Rogerus et Rinoïus. Quant au véritable je ne peux le faire hélas ! », écrit-il. Il y a Sergeus, le frère véritable et de sang, qu’il ne peut, « hélas », revoir et embrasser avant de mourir. Mais il y a aussi les « frères » d’amitié et de combat, les camarades qui sont détenus avec lui. Ces trois garçons sont aussi les amis d’ « Epinard » puisqu’il la charge de saluer les familles de ses « frères ». Môquetus accepte le martyr, tout simplement parce qu’échapper à la mort, reviendrait à condamner un autre, à désigner un « frère », un ami qui, parce qu’il aurait été un peu plus âgés que lui, se serait nécessairement substitué à lui s’il avait été épargné. Cet autre aurait pu être Jeannus, Rogerus, Rinoïus ou un inconnu, et il aurait fallu vivre avec la pensée : je vis parce qu’un frère a reçu la mort à ma place.
Comment Sarkominus peut-il sérieusement affirmer : « Les plus petites paroles d’amour qu’un grand garçon de 17 ans adresse à sa mère et à son père prennent une grandeur tragique quand ce sont les dernières, non parce que la vie va cesser mais parce qu’après il ne sera plus possible d’aimer » ?
Aristote écrit à propos de la vie et de l’amitié : « l’existence est désirable parce qu’on sent qu’elle est une bonne chose et cette sensation est une chose douce par elle-même. [...] L’amitié est une communauté [...] ; et tout comme, par rapport à soi, la sensation d’exister est désirable, ainsi il en ira pour l’ami » (5). L’amitié est le lieu où l’on s’atteste mutuellement que l’existence est désirable. L’amitié, ce sentiment biophile qui fait aimer la vie, survit à la mort de l’un des amis, surtout si cet ami est mort pour permettre à son ami de vivre. Comment cesserait-on d’aimer cet ami par delà sa mort et comment pourrait-on vivre sans ressentir en soi son amour longtemps après sa mort ? Ne pas comprendre cela, c’est tout ignorer de l’amitié. J’ai écris : « Celui qui n’a pas un seul ami véritable ne mérite pas de vivre » (6). Parce que l’on ne peut pas vivre vraiment, si l’on vit en deçà du sentiment partagé que la vie vaut d’être vécue.
La détermination de Môquetus face au martyr sera chantée par le poète Aragonus : « J’ai sous les yeux le récit [d’un] interné qui se trouvait dans la baraque 10 (celle des jeunes). Il traduit aussi cette angoisse sourde et montante des deux journées, les bruits qui courent, encore incertains, les signes précis d’un événement qu’on croit deviner sans en être sûr. « Quand s’ouvre la baraque 10, [l’officier] lance sans hésitation, avec un sourire pincé, un seul nom : Môquetus. Le nom est un couperet qui tombe sur chacun de nous. Il répond d’un seul : présent ! Et comme sans réfléchir, droit, plus grand que jamais, notre Môquetus s’avance d’un pas rapide et assuré, dix-sept ans, plein d’inconscience et de vie ! À peine éveillé aux premiers rêves de l’amour, il est parti, notre Môquetus, comme serait parti un peu de nous » (7).
Cette assurance devant la mort étonne : « Ce que je souhaite de tout mon cœur, c’est que ma mort serve à quelque chose », écrit-il. La mort n’est pas qu’un spectacle effrayant. Sans doute est-elle effrayante. Le sacristain Moyonus, présent pour assister au martyr écrivit : « les condamnés ont refusé d’avoir les yeux bandés et de se laisser attacher au poteau. Un seul - le jeune homme de 17 ans - a eu un évanouissement. Lui seul a dû être attaché dans cet état, mourant ainsi dans cette triste condition » (8). Môquetus aura reçu la mort dans un songe. La mort est effrayante, mais Môquetus sait aussi qu’elle est porteuse de message. Il aurait pu réciter ce qu’un Chœur, assistant à son martyr, aurait clamer : « cet enfant n’a commis nuls crimes, il consent à mourir pour que nul ne se substitue à lui dans la mort, mais il désigne ses assassins. Ces assassins ? Les Teutons ? Plaisanterie ! Ils ont exigé des otages, mais n’ont jamais réclamé qu’on tue un enfant. Qui le désigne sinon ceux qui, dans le pays de Droite, font le choix de collaborer avec les Teutons ? » Môquetus dans un poème dédié à trois résistants, désigna l’ennemi : « Vous êtes tous trois enfermés / Mais patience, prenez courage / Vous serez bientôt libérés / Par tous vos frères d’esclavage / Les traîtres de notre pays / Ces agents du capitalisme / Nous les chasserons hors d’ici » (9). Le sacrifice de Môquetus est un acte qui fait signe, qui laisse une trace qui lui fait écrire, à l’adresse de son père : « Sache que j’ai fait de mon mieux pour suivre la voie que tu m’as tracée. »
Sarkominus par un hommage biaisé, met en valeur le pathos pour occulter le souvenir de la faute inexpiable des ploutocrates. Il veut que le spectacle sidérant de la cruauté arrête la pensée et engendre le silence et l’amnésie. Il y a l’amnésie et l’impunité, qui ne se contente pas d’occulter le passé, car l’une et l’autre fomentent un monde où il sera possible de réitérer semblable trahison. « Je veux leur dire ma vérité sur la politique et sur la morale, proclame Sarkominus. Je veux dire aux gens du pays de Droite qu’ils auront à choisir entre ceux qui aiment le pays de Droite et ceux qui affichent leur détestation du pays de Droite. Je veux leur dire qu’ils auront à choisir entre ceux qui assument (comprendre : « absolvent ») toute l’Histoire du pays de Droite et les adeptes de la repentance qui veulent ressusciter les haines du passé en exigeant des fils qu’ils expient les fautes supposées de leur père et de leurs aïeux. Je suis convaincu que pour un habitant du pays de Droite, haïr le pays de Droite, c’est se haïr lui-même. Je suis convaincu que la haine de soi est le commencement de la haine des autres » (10). Dans une ultime perversité, celui qui conserve le souvenir fraternel de Môquetus, celui qui conserve vivant le sens de son sacrifice, est désigné comme agent de la haine.
3. Où Démocrite raconte sa promenade en compagnie de la dryade Eurydice.
J’ai interrogé le jeune Môquetus sur le moyen de pénétrer le Tartare, établissement à la fâcheuse réputation, car c’est « le séjour odieux, / Que d'un triple rempart enfermèrent les dieux. /Autour le Phégéthon aux ondes turbulentes, / Roule d'affreux rochers dans ses vagues brillantes. / La porte inébranlable est digne de ces murs : / Vulcain la composa des métaux les plus durs. / Le diamant massif en colonnes s'élance ; / Une tour jusqu'aux cieux lève son front immense ; / Les mortels conjurés, les dieux et Jupiter, / Attaqueraient en vain ses murailles de fer » (11).
« - Pour le Tartare et les Enfers, m’a répondu Môquetus, le problème reste le même : ce n’est pas d’entrer qui est périlleux, c’est d’en sortir. Seule Anankè et ses filles, qui dirigent le monde, pourront vous exfiltrer et vous ne devrez votre salut qu’à cette ode qu’Orphée vous appris pour les appeler. Reste, qu’il est prudent d’emprunter un accès discret, afin de circuler dans l’enceinte sans se faire remarquer. Eurydice, comme dryade, commande aux végétaux, et elle ordonnera à un arbre de croître jusqu’à ce que ces branches nous élèvent jusqu’en haut des murailles. De là haut, je vous indiquerais où trouver Auguste Comtus. Mais je ne pourrais vous accompagner plus loin. »
J’avais rendez-vous dans cinq heures – heure où les fils de Bia lanceraient leur diversion. Le lieu de rendez-vous se trouvait dans la vallée des « Innocents condamnés à morts », à la lisière d’un petit bois qui jouxte la rive du Phégéthon, en face à l’angle Est de la muraille du Tartare.
J’ai fais la route en compagnie d’Eurydice. Sa conversation est des plus agréables - quoique décousue, car elle passe sans crier gare de questions relatives aux sciences naturelles à d’autres franchement philosophiques.
Par exemple, elle m’a arrêté pour me dire :
« - Mes yeux ne sont plus constitués que des atomes d’âme qu’ils contenaient, aussi tout ce que je peux voir de vous, c’est votre âme. Votre apparence corporelle a, pour moi, plongé dans l’invisible. »
Elle me souriait, silencieuse.
Vous imaginez bien que cette remarque a stimulée ma curiosité, aussi lui ai-je demandé si cette déficience perceptive n’était pas trop handicapante. Elle est restée silencieuse et m’a regardée bizarrement.
« - Si vos yeux ne perçoivent que mon âme, repris-je, vous ne voyez pas ma longue barbe blanche. »
Elle ne m’avait pas encore répondu « en effet » que je rougissais en songeant qu’elle ne devait pas voir mes vêtements non plus.
Plus tard, elle m’a demandé, en me scrutant : « Vous êtes un homme libre ? »
« - La liberté ! Vaste question ! », me suis-je exclamé en riant.
« - Vaste ? Il me semble, moi, que l’on est libre ou qu’on ne l’est pas », m’a t-elle affirmée d’une manière que j’ai trouvé un tantinet péremptoire.
« - Le tiers exclus !, ai-je soupiré. Vous aurez sans doute trop lu Aristote ! Il est des questions qui ne se plient pas à la logique binaire de ce philosophe. Il nous arrive certainement d’arpenter le domaine de la Liberté, mais celui-ci n’existe qu’autant que nous parvenons à dépasser de l’état de Nécessité. D’un point de vue matérialiste, le domaine de la Liberté commence avec la réduction du temps de travail, puisque la matière de la liberté, c’est du temps précieusement libéré du soucis d’assurer notre subsistance. Les sages sont libres car ils se satisfont d’un rien. Les animaux le sont aussi, car « l’animal qui éprouve un besoin sait exactement de quoi il a besoin, [tandis] que l’homme qui éprouve un besoin ne le sait pas » (12). Aussi l’homme perd t-il un temps considérable, au détriment de sa liberté, à suivre des impulsions qu’il croit être des besoins. »
« - Je ne crois pas que vous ayez répondu à ma question, reprit-elle. Il me semble que ma question est des plus simple : où on a des engagements ou on n’en a pas. »
« - En introduisant cette dernière notion, vous complexifiez encore la question, lui fis-je observer. Nous sommes enclins à considérer, par exemple, les droits démocratiques comme des libertés – et jusqu’à un certain point ils le sont -, mais à la réflexion, ces droits ne sont-ils pas d’abord le corrélat d’un engagement mutuel des citoyens à veiller collectivement sur la bonne gestion de la Cité ? En telle sorte que l’exerce de nos libertés est aussi une sorte de devoir que nous accomplissons pour conserver la Cité démocratique. »
Elle resta un moment silencieuse. Puis, curieusement, elle s’excusa de m’avoir posées ces questions « gênantes », d’autant, précisa-t-elle, qu’elle n’accordait pas tant d’importance au fait que l’on soit libre ou non. Je l’approuvais sans réserve en affirmant ironiquement qu’il fallait laisser aux idéalistes le soin de pondre des élucubrations sur l’Idée de la liberté.
Soudain des gamins qui sortaient du « Séjour des enfants morts » - que nous longions -, vinrent à notre rencontre. Eurydice devient absolument délicieuse. Elle les accueillit en leur prodiguant de tendres caresses et en riant de leurs facéties. Je n’avais pas imaginé chez elle une telle passion pour les enfants. Elles les embrassaient et, de temps à autres, elle me lançait des regards très joyeux. Un peu plus tard, elle m’a dit son regret d’être morte sans avoir eu d’enfants et elle ajouta qu’en avoir étaient sans doute la plus belle chose que deux êtres pouvaient faire ensemble.
Je décidais de la taquiner en raillant Aristote, qu’elle semblait grandement estimer, en soulignant combien ce philosophe élaborait sa science en s’affranchissant des évidences. En particulier lorsqu’il affirme que « toujours la femelle donne la matière, et le mâle fournit le principe créateur. Selon nous, c'est là réellement l'action de l'un et de l'autre » et qu’ « ainsi, le corps vient de la femelle, et l'âme vient du mâle » (13). N’est-il pas évident que l’enfant ressemble à ses deux parents, tant pour le physique que pour le tempérament, ce qui oblige à convenir que « la femelle aussi secrète de la semence ; mais ses gonades sont retournées vers l’intérieur : c’est pourquoi elle éprouve [elle aussi] le désir de s’accoupler » (14). « N’est-il pas malheureux de dépenser tant d’énergie intellectuelle pour occulter ce que nous avons sous les yeux, à savoir que la femme désire elle aussi ? », lui ai-je demandé. Elle m’a répondu que ma manière de voir les femmes était moins naïve qu’elle ne l’avait d’abord imaginé.
Nous reprîmes notre marche, silencieusement. Un peu plus tard, elle m’a dit ceci, qui m’a frappé : « Vous n’osez pas me le dire, mais ça vous déplaît une femme qui manipule les chairs des cadavres, qui toilette le corps des âmes folles, qui éponge les plaies… » J’étais interloqué. Je lui ai répondu que, venant d’elle, rien ne me semblait laid ou scabreux. A force de me pousser dans mes retranchements, je lui ai accordé (à contrecœur) que l’on pouvait s’interroger sur ses motivations à aller au devant d’une telle souffrance. J’ai vu que je l’avais blessée et je m’en suis voulu.
Plus tard, elle m’a montrée le « Champ des larmes » qui s’étendait devant nous. Elle y était « assignée », en compagnie de ceux qu’un « dur amour a rongés d'une langueur cruelle » (15). Puis, elle s’est plainte amèrement de justice « expéditive » des Enfers. Si cela avait un sens d’attribuer à Môquetus un logement dans la vallée des « Innocents condamnés à morts » – ainsi lui rendait-on une justice qui lui avait été dénié de son vivant -, elle ne comprenait pas quelle consolation elle était censée trouver à côtoyer les âmes en peine ? Les juges des Enfers, affirma t-elle, sont particulièrement rétrogrades dès que la sexualité féminine entre en ligne de compte : parce que son amour avec son époux, Orphée, n’avait pu se concrétiser, les juges en avait déduit qu’elle était forcément malheureuse, et cela jusqu’à la fin des temps. A quoi je répondis, que je ne comprenais pas, moi non plus, les préjugés sur les questions sexuelles, puisque « l’amour lave de tout reproche l’acte amoureux » (16). Elle m’a dit que nous étions sur la même longueur d’onde.
Elle m’a donnée son bras et montrée le petit bois où Môquetus devait nous retrouver. Elle m’a suggérée de nous y enfoncer et de l’y attendre à l’abri des regards. Eurydice, avant d’entrer dans le bois, posa sa main sur l’un des arbres, auquel elle sembla murmurer quelques paroles magiques. Puis elle m’attira dans une clairière. Soudainement, elle s’est exclamée en m’agrippant : « Je me demande bien ce que vous avez bien pu dire aux fils de Bia pour qu’ils acceptent de vous aider à entrer dans le Tartare. Vous rendez-vous compte que pourriez ne jamais en ressortir ? » Je tentais de la rassurer en plaisantant, mais - peut-être étais-ce l’effet du changement de température ou de luminosité dans le sous-bois -, elle vacilla. Par chance elle tomba dans mes bras, s’évitant ainsi une mauvaise chute. Je l’aidais à s’allonger et lui recommandait de prendre du repos, l’assurant qu’elle pourrait dormir tranquillement car j’irais à jusqu’à l’orée du bois pour y guetter l’arrivée de Moquêtus.
4. Où Démocrite raconte son entrée dans le Tartare
Môquetus arriva en courant. Il me tendit une fiole de Kykéôn en m’affirmant que j’étais depuis trop longtemps présent aux Enfers et que la dose que m’avait donné Orphée risquait de ne plus faire effet. Je bus le breuvage. Je ressentis presque aussitôt une sorte de vertige, mais fort heureusement Môquetus m’offrit son bras. Il me murmura : « Eurydice va éveiller l’hamadryade (17) qui loge dans ce grand chêne. »
Eurydice m’apparu soudainement presque terrifiante. Ses épaules, qu’elle avait dénudées, me semblèrent puissantes comme celles d’un lutteur. Elle étira ses bras au dessus de sa tête. Son regard porté vers la cime d’un chêne, était luisant et noircis par une sorte de fureur. Son buste conservait une étrange fixité, alors même que ses hanches, peu à peu s’animaient, tressaillaient, puis suivaient des ondulations convulsives. Ses pieds, dans une pesante cadence, semblaient tantôt caresser et tantôt pétrir la terre. Soudain, je lui découvrais le sourire d’une... lionne.
Les mots « sourire de lionne » se répétèrent dans ma tête, sans que je ne puisse rien y faire. Je fermais les yeux et je me concentrais sur ses sourdes proférations : « Je m’élance, semblable à la prêtresse de Bacchus qu’agitent les fureurs de ce dieu, semblable à celles qui, sur le mont Ida, font résonner les tambourins, à celles à qui les Dryades, ces demi-déesses, et les Faunes à la double corne, ont soufflé un enthousiasme inconnu. Car on me redit tout, lorsque mon transport est calmé. Moi seule je connais l'amour secret qui me brûle » (18). Soudain, elle poussa un cri rauque et déchiré, semblable à un grognement d’ourse. Je gardais les yeux fermés. Les mots « sourires de lionne » se remirent à marteler dans ma tête, jusqu’à ce que je visse se peindre dans mon imagination ce récit de Nonnos de Panopolis : « L'hamadryade tend la tête hors du feuillage, chante cachée à demi sur le haut de son chêne, et glorifie le nom du dieu des guirlandes, tandis que la nymphe aux pieds nus de la fontaine lui répond. Les ourses furieuses jettent d'horribles hurlements dans les montagnes. La panthère aiguise ses dents, et bondit dans les airs, tandis que le lion joue doucement avec la lionne, et envoie à sa compagne un tendre rugissement » (19).
Môquetus me murmura : « Maintenant ! Nous devons saisir une branche. Le chêne semblait s’étirer. A ma grande frayeur, il me sembla que mon bras aussi s’étirait, s’allongeait pour poursuivre la branche. Quand je l’ai saisi, j’ai senti que je m’élevais dans les airs. La branche en s’étirant nous portait au dessus du Phégéthon impétieux, puis nous éleva jusqu’au sommet des murailles. Là Moquêtus m’ordonna de lâcher la branche. J’avais le Tartare sous les yeux, avec ses petits bâtiments gris alignés, qui accueillaient les détenus.
Môquetus sortit une corde de son sac, et confectionna un harnais. Nous restions silencieux. Soudain, nous entendîmes une cavalcade de centaures qui quittaient précipitamment le Tartare. Môquetus me désigna plusieurs points des Enfers où démarraient des incendies. « Les manoeuvres de diversion des fils de Bia ont débuté, me dit le garçon. Laissez-vous glisser, je vous retiendrais. Une fois au sol, dirigez vous vers la troisième porte de la troisième bâtisse et taper trois fois. Auguste Comtus vous ouvrira. »
5. Où Démocrite rapporte sa conversation avec le faune Auguste Comtus
Une fois au sol, il m’a suffit d’attendre que les deux centaures resté de garde entament leur ronde, pour bénéficier des minutes nécessaires pour rejoindre la geôle de Comtus. J’y frappais trois fois. Elle s’ouvrit.
Comtus paru. Il portait un pyjama orange. Des liens, qui entravaient ses pattes de bouc, le contraignaient à se mouvoir à petits pas.
« - Ah ! Démocrite, avez-vous vu mon petit Sarkominus ? Comment se porte t-il ? Avait-il bonne mine ? », m’a demandé Auguste Comtus en refermant précipitamment la porte.
Je lui ai répondu que je l’avais rencontré quelques jours plutôt et qu’il semblait se porter comme un charme.
« - Ah ! Si vous saviez quel mauvais sang je me fais à cause de lui !, reprit Auguste Comtus. Vous ne savez pas ce que sont les angoisses d’un père ! Il en a fait de belle n’est-ce pas ? »
« - Elever des enfants est chose difficile, soupirais-je. Réussir en la matière implique bien des combats et soucis, y échouer apporte un chagrin sans égal » (20).
« - C’était pourtant un bon garçon, mon petit Sarkominus, reprit Comtus. Mais, voyez-vous, il a eu de mauvaises fréquentations. Il est trop bon, alors il se laisse entraîner. Si je n’avais point été brouillé avec les dieux, il aurait reçu son éducation sur l’Olympe... Mais, comme vous le savez, j’ai du émigrer et m’installer à Neuillus-sur-Sequana. Dans ce genre d’environnement, où vous devenez une proie ou vous devenez un voyou. Ce n’est pas une excuse sociologique, c’est la vérité. Pourtant, quand je repense à ces instants où, sur mes genoux, blottit contre moi, il me prononçait des « je t’aime, mon petit papa… », je me dis que les choses auraient pu se passer différemment. Comme il était doux et affectueux ! Il adorait les fleurs. Tous les matins, j’avais mon petit bouquet posé sur mon lit. Sans doute m’a t’il assassiné, mais il a, sans nul doute, commit ce forfait sous l’emprise des Olympiens. Je suis même le seul blâmable d’un défaut de surveillance qui lui a permit de commettre un parricide… Mais bon... Si je fais abstraction de ce regrettable évènement, je peux affirmer avoir été le plus heureux des pères. »
« - Vous ne m’avez pas invité à vous rejoindre dans les Enfers, pour me parler des joies de la paternité, n’est-ce pas ? », hasardais-je, non sans dissimuler mon inquiétude.
« - Cela ne vous intéresse pas ?, me demanda le faune très surpris. Pourtant, les premières années de la vie d’un être sont de la toute première importance. »
« - Sans doute, concédais-je, mais le temps m’est compté, et vous avez suggéré, dans votre lettre, que si je vous visitais aux enfers vous me feriez quelques révélations qui m’aiderais à comprendre le phénomène des prémonitions et des prédictions. »
« - Ah oui !… Les prédictions !, reprit Auguste Comtus. C’est une question difficile.... Pour que vous compreniez bien, il me faut d’abord vous resituer ma lettre dans son contexte, c’est-à-dire celui de la grande brouille qui opposa les faunes et les dieux.
Tout commença lors d’une restitution publique d’un rapport d’étape de l’évaluation de la race humaine. Zeus, dans ses conclusions, laissa entendre que l’on ne pouvait plus exclure de préconiser l’élimination des hommes actuels et leur remplacement par une race nouvelle. Il invoquait une insatiabilité qui condamnait les humains à détruire une nature, qu’ils auraient dû regarder comme un bien commun, appartenant indivisiblement aux hommes et aux dieux. Il compara les hommes à un troupeau de chèvres abruties, qui dévore la végétation jusqu’à la racine sans se soucier du lendemain. Vous imaginez bien que des propos aussi gratuitement stigmatisants, tant pour les hommes que pour les chèvres, outrèrent les faunes. Pan, notre père, prit la parole pour rappeler que la race des hommes était encore très jeune et qu’il fallait se garder des jugements hâtifs. Puis il rappela à Zeus sa difficile adolescence et la patience dont les dieux firent preuve à son endroit ! Celui-ci rougit à l’évocation d’une époque où on ne se lavait plus et ne sortait de l’Omphale que pour nous insulter. Pan ajouta que les faunes se porteraient garants des hommes et qu’ils sauraient leurs enseigner dans les meilleurs délais le respect de la nature.
Pan inventa la musique pour que les hommes développent leur sens de l’harmonie et pour stimuler leur désir de trouver un accord avec la nature. Il était persuadé que la musique, le chant et la danse offrait à l’humanité un exutoire à ses penchants destructeurs. La même énergie qui poussait les hommes à la déprédation pouvait être convertie en force créatrice. Il suffisait en somme de déplacer l’objet de leur violence, en telle sorte que leur énergie, au lieu de s’acharner contre la vie, s’oriente vers des espaces imaginaires. Ainsi, les cris se transformerait-ils en chants, l’élan brutal des coups en gestes et pas de danse, et les éclats et les fracas en cadence et rythmes enivrants.
Pan découvrit un enfant abandonné, un bébé d’une grande beauté, nommé Daphnis. Il l’éleva, lui confectionna la syrinx (flûte de Pan), et lui révéla les secrets de l’art musical. Adolescent, Daphnis entra dans le monde pour y répandre ses harmonies. Il fascinait et séduisait les hommes et les femmes, tant par ses mélodies que par sa beauté. Bientôt, les faunes se prirent à croire qu’ils allaient réussir, là où les Olympiens avaient toujours échoués : l’instauration du règne de l’harmonie entre les hommes et la nature. Mais, un jour, Daphnis, sur le ton de la plaisanterie, affirma que sa passion pour l’harmonie était, chez lui, bien supérieure à celle que l’on éprouve dans un sentiment amoureux. Eros et Aphrodite, qui étaient venus l’écouter, prirent la remarque en mauvaise part. Et bientôt nous vîmes Daphnis dépérir, se consumer d’amour pour une petite Xénia, une demoiselle vulgaire qui le repoussait et ne l’aimait pas et auquel il adressait toutes ses pensées. L’échec de Pan fit rire tout l’Olympe.
Vexé, le faune Marsyas reprit le flambeau et tenta à son tour de transformer le coeur de l’espèce humaine. Il découvrit un enfant abandonné, fort laid, qu’il nomma Olympos et à qui il enseigna tous les secrets de l’art musical. Il offrit à l’enfant la flûte d’Athéna, que Marsyas avait ramassée après que la déesse l’eut jeté, au motif que ses joues gonflées par le souffle, l’enlaidissaient. Olympos suscita l’admiration des hommes par sa créativité sans égale. « Olympos, le premier, introduisit parmi les Grecs le jeu des instruments à cordes, se rappelle Plutarque. Olympos est considéré par les musiciens comme l’inventeur du genre enharmonique ; car, avant lui, tous les airs étaient diatoniques ou chromatiques. Voici comment l’on présume que se produisit cette découverte. Olympos, se mouvant dans le genre diatonique faisait souvent passer la mélodie directement à la parhypate diatonique (Fa), en partant tantôt de la paramèse (Si), tantôt de la mèse (La), et en sautant la lichanos diatonique (Sol). Il remarqua la beauté du caractère de cette progression, admira la gamme construite sur cette analogie, l’adopta et y composa des airs dans le ton dorien. Ce faisant, il ne s’attachait plus aux particularités ni du genre diatonique, ni du chromatique, ni de l’enharmonique. Tel fut, en effet, le caractère de ses premières compositions, dites enharmoniques » (21)
Marsyas, qui avait eu soin de choisir un élève aussi laid que lui, développait avec son protégé une théorie qui prétendait que la véritable beauté n’était pas « extérieure », mais « intérieure », et que la musique était, de tous les arts, le mieux à même de mettre au jour la beauté « intérieure ». Apollon, qui était venu l’écouter, prit sa remarque en mauvaise part. Aussi défia-t-il le faune dans un concours musical. Marsyas joua de la flûte et Apollon de la lyre. Les nymphes qui arbitraient la joute ne purent les départager, tant Marsyas et Apollon excellèrent chacun dans leur instrument. Pour la seconde manche, Apollon joua de la lyre en chantant et défia Marsyas d’en faire autant. Marsyas ne pu évidemment relever le défi, puisqu’on ne peut jouer de la flûte et chanter en même temps. Déclaré vainqueur, Apollon exigea de « voir » la fameuse « beauté intérieure » de Marsyas afin de pouvoir la comparer à sa propre « beauté extérieure ». Comme Marsyas ne pouvait la lui montrer, Apollon s’empara d’un couteau et il dépeça le faune, sous les yeux terrifiés d’Olympos. Perpétuellement, hanté par le souvenir des hurlements déchirants et le spectacle d’Apollon inspectant l’écorché, la peau du faune posée sur l’épaule, Olympos renonça à composer quelque œuvre que ce fut. Il dépérit rapidement. Vous imaginez bien, qu’après ce tour, les faunes furent une nouvelle fois l’objet de la risée générale de l’Olympe.
Résolu à venger les faunes, je m’exilais. Au cours d’une promenade je découvris un nourrisson abandonné. Confusément, j’eu le sentiment d’avoir trouvé l’instrument de ma vengeance. Je l’élevais pour en faire le prophète d’une nouvelle religion : la religion de l’Homme, appelée à libérer l’humanité du joug des olympiens. Cette religion nouvelle, qui ne rend de culte qu’à la Raison, repose sur un principe trinitaire qui reconnaît que la Raison est trois et une à la fois ! Trois, car elle se manifeste comme « Raison réelle », c’est-à-dire Raison qui nous impose sa loi, par exemple quand nous disons : « Je vais vous ramener à la raison ! » ; comme « Raison imaginaire » par laquelle nous accédons à la perception mentale de notre singularité, par exemple, quand nous disons : « J’ai mes raisons » ; et comme « Raison symbolique » qui médiatise notre rapport à autrui, par exemple quand nous disons « J’ai toujours raison ». En plus d’être trois et une à la fois, la raison est immanente, puisqu’elle est la chose la mieux répartie entre les hommes, mais aussi transcendante, puisqu’elle est universelle. Et, pour finir, la Raison installe le règne de la liberté, puisque là où il n’y a plus de mythes, il n’y a plus de limites. »
« - Tout ceci ne m’éclaire pas beaucoup sur les prémonitions et les prédictions », fis-je observer.
« - J’y viens !, reprit Comtus. Le réseau d’informateurs des Olympiens ne tarda pas à découvrir mes activités séditieuses et il rapporta mes théories à Zeus, qui les prit en mauvaise part. Je connais trop bien les procédés du tyran de l’Olympe et je ne doute pas un instant que c’est sous l’impulsion de Zeus que mon tendre petit Sarkominus m’a assassiné. Mon âme, à peine entrée dans les Enfers, fut arrêtée et traînée jusqu’au Tartare. Là, les interrogatoires se succédèrent. Ils me mirent dans la même cellule que Prométhée, qui se faisait dévorer le foie par des aigles, pour que je mesure la cruauté dont les olympiens sont capables. Comme je ne supporte pas la souffrance physique, j’ai avoué tout ce qu’ils voulaient entendre. J’ai donc signé des déclarations j’avouais que Sarkominus était le descendant d’Hercule, celui-là même dont Prométhée taisait le nom. Vous imaginez mon sentiment culpabilité, car j’ai mis mon pauvre petit Sarkominus dans une situation bien délicate ! Je connais bien les Olympiens... Ils vont le piéger ! Et tout sera de ma faute ! »
« - Mais, risquai-je, les Olympiens ne sont pas naïfs, ils doivent bien se douter que vous leur avez menti. Ils ont du croiser vos aveux avec ceux de Prométhée. »
« - Mais figurez-vous qu’il ne lâche toujours rien ! », s’exclama Comtus en me désignant Prométhée ligoté sur son lit. Soudain Comtus se leva et hurla à l’adresse de Prométhée : « Tu vas parler, ordure ! Tu vas leur dire, que ce n’est pas Sarkominus, espèce de pervers !?! »
« - Je vous en prie, calmez-vous !, suppliais-je. Vous allez attirer l’attention des geôliers. »
« - Pardonnez-moi Démocrite, murmura-t-il, mais il m’écœure. Gros prétentieux qui a prétendu avoir donné les arts aux hommes ! Alors, que, comme vous l’avez fort bien dit, les hommes, enfants de la nature, les ont inventé eux-mêmes, grâce à leur capacité d’observation des bêtes et en devenant, auprès de celles-ci « leurs apprentis et disciples dans les choses principales dont nous avons affaire : comme de l’araignée, en la tissure et couture, de l’hirondelle en architecture, du cygne et du rossignol en la musique » (22). Les Olympiens ont bien fait de le mettre hors d’état de nuire, car si l’on avait toléré ce précédent, nous n’aurions pas tardé à croiser des dieux assez fous pour croire qu’ils avaient créés l’univers, que cela avait été un gros boulot, du genre de ceux qui vous bouffe le week-end et ne vous laisse que le dimanche pour vous reposer. »
« - Et vos prédictions ? », insistai-je, inquiet du temps qui passait.
« - Démocrite, me pardonnerez-vous ? J’avais besoin de vous !, s’exclama t-il avec un air un peu idiot. J’ai joué leur jeu des Olympiens et j’ai obtenu le droit de vous écrire. Pour tromper les Olympiens j’ai écris des phrases qui me passaient par la tête, dans un style énigmatique, assez générales pour qu’on puisse les interpréter en n’importe quel sens. Plus les phrases sont absurdes, plus elles ont de chance de découvrir des interprétations qui mettent en lien la phrase avec la vie de Sarkominus. En effet, pour interpréter une prédiction, on recherche des synonymes des mots qu’elle contient, et on finit toujours, en trouvant le synonyme d’un synonyme par découvrir un signifiant qui nous évoque quelque chose de concret dans la vie d’une personne. Mais au milieu de ces sottises, j’ai placé quelques phrases qui ne pouvaient manquer de vous intriguer. Et cela pour vous attirer aux Enfers afin de vous demander un petit service. Je vous le demande à vous, parce que, voyez-vous, Démocrite, j’ai confiance en vous. Démocrite, il faut que vous alliez trouver Sarkominus pour l’avertir du mauvais coup que lui prépare les Olympiens. »
« - Mais on ne fait pas des choses comme ça !, m’écriais-je furieux. On n’attire pas les gens aux Enfers pour leur demander des services ! »
« - Je m’excuse, trouva à répondre Comtus. Mais c’est pour mon petit garçon. »
« - Mais ce n’est pas une raison !, m’écriais-je. De toute manière, il y a un petit problème... Sarkominus et ses conseillers ont eu connaissance de vos prédictions... Ils y croient... Ils ont déjà préparé une armée pour envahir l’Olympe. Normalement Sarkominus doit attendre mon retour, pour que je lui confirme qu’il est bien le descendant d’Hercule chargé de chasser les Olympiens. Mais vous savez combien il est impulsif… et quand je suis parti, il m’a dit : « entre Hercule et moi, c’est du sérieux. »
Comtus était effondré.
Soudain Prométhée prit la parole : « Qu’avais tu besoin de descendre aux enfers, Démocrite ? Tu a déjà la réponse à ta question. Il te suffit de relire ton « D’Homère, ou de la correction épique et des termes qui lui sont propres » et d’y retrouver ce que tu y as écris sur la synonymie. »
Comtus se redressa et se jeta sur Prométhée en hurlant : « T’écoutais tout, espèce de tordu ! Tu faisais semblant de dormir ! Mais maintenant tu vas dire qui c’est ? Tu vas parler crapule !?! », mais le titan se mura de nouveau dans le silence.
Abasourdi, Auguste Comtus, se mit à sangloter.
Je fus, tout d’un coup, pétrifié par des cris.
Prométhée dans son pyjama orange s’agitait sur son lit et poussait des hurlements en forme d’hululements sinistres. « Là, regardez », me fit Comtus en pointant du doigt un pigeon qui se posait sur la lucarne de la geôle. Comtus attira ensuite mon attention sur des petits grains de blé qui tombait depuis un trou du plafond sur le corps de Prométhée. Le pigeon s’envola et se posa sur le rebord du lit du titan. Les hurlements de Prométhée décuplèrent. Le pigeon se posa sur le corps de Prométhée et picora un à un les grains de blé, portant la terreur de Prométhée à son comble. Bientôt, le titan sombra dans l’inconscience.
« - C’est le dernier truc de Zeus, me murmura Comtus. La torture psychologique… Gouverner en utilisant les phobies plutôt que la violence physique... Il parait que c’est plus efficace… Démocrite, les gardiens vont venir pour vérifier l’état de Prométhée. Il va falloir que vous partiez. Il faut que vous prononciez l’ode aux Moires qu’Orphée vous a apprit. Les Moires apparaîtront et elles vous ramèneront vers la surface. »
Je fis comme il me dit, et je sentis des bras invisibles me soulever. Je m’endormis.
Notes
(1) Après huit mois de guerre civile, l'insurrection libyenne dirigée par le CNT (Conseil national de transition) triomphe. L'insurrection se revendiquait de principes démocratiques, et aura reçu, à ce titre, l'appuie militaire des USA, de la France et de la Grande-Bretagne. Aide qui est allée très au delà de ce qu’autorisait la résolution « 1973 » de l'ONU pour qui l’intervention devait se limiter à protéger les civils. Concrètement l’intervention occidentale s’est traduite par des bombardements systématiques des troupes loyalistes, l’envoie d’arme et l’intervention de troupes au sol pour des opérations « secrètes ». Le 19 octobre 2011, le colonel Kadhafi et l'un de ses fils, qui fuyaient Syrte, leur dernier bastion sur le point de tombé, sont bombardés par des avions français, et bientôt rejoint par des troupes du CNT, ils sont lynchés et exécutés sommairement. La guerre civile aurait fait 30.000 morts d’après le CNT. L’OTAN annonce qu’il a mené 9618 « sorties offensives ». Les mauvais esprits font observer que ces exécutions servent les intérêts de nombre de membres du CNT, qui ont étroitement collaboré avec le régime de Kadhafi (à commencé par son président, qui fut le ministre de la justice sous lequel les infirmières bulgares furent torturées et condamnées à mort au cours d’un procès inique). Mais aussi les intérêts des occidentaux : la CIA et le MI6 étaient assez peu désireuse que Kadhafi rappelle que ces deux services lui livraient des islamistes, qu’il enfermait pour leurs compte dans des prisons secrètes et qu’il faisait parler avec des moyens « non approprié » en démocratie. La France ne souhaite par nom plus se voir rappeler comment, via la société Amesys, filiale française de Bull, elle a vendu au régime libyen en 2007 un système d'espionnage généralisé de la population libyenne, appelé Eagle, associé à un logiciel Glint permettant d’enregistrer, de décoder, de stocker et de redistribuer les communications Internet, satellitaires ou téléphoniques, qu’elles soient passées d’une cabine ou d’un portable. Sans parler des ventes d’armes et des contrats pétroliers que les occidentaux ont signés avec le régime Libyens.
Lors de son premier discours, dans la Libye libérée de Kadhafi, Moustapha Abdeljalil, président du CNT, annonce alors que la « charia » (loi coranique) sera la principale source du droit de la nouvelle Libye : « En tant que nation musulmane, nous avons adopté la charia islamique comme source du droit, donc n'importe quelle loi contredisant les principes de l'islam est légalement nulle», a déclaré. Il ajoute : « Par exemple, la loi sur le divorce et le mariage [qui, en Libye, interdisait la polygamie], cette loi est contraire à la charia et elle n’est plus en vigueur. »
(2) Platon, République, V 457c-d et 457a
(3) Hérodote, Histoires, VI, 20, 6, 21
(4) Billet de Guy Môquet adressé le jour de son exécution à Odette Lecland, également internée au camp de Choisel à Châteaubriant. 22 octobre 1941. Billet conservé au Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne.
(5) Aristote, Ethique à Nicomaque, 1171b.
(6) Démocrite, Fragment CCIX, Maximes de Démocrate, 65
(7) Louis Aragon, Le témoin des martyrs, in L’Homme communiste
(8) Témoignage de l'abbé Moyon, curé de Saint Jean de Beré, appelé par l'autorité civile et militaire pour assister les victimes, cité par Mgr Jean-Joseph Villepelet, Un évêque dans la guerre.
(9) Extrait d’un poème de Guy Môquet dédié au commando de 3 communistes dit du "Commando de Nantes" qui abattit le Feldkommandant de Nantes, Karl Hotz, le 20 octobre 1941. Cité dans La vie à en mourir. Lettres de fusillés 1941-1944, Editions Tallandier, 2003
(10) Nicolas Sarkozy, Discours à Nice (30/03/07)
(11) Virgile, L'Enéide, L. VI, 548-554
(12) Démocrite, Fragment CXCVIII, Strobée, Florilège, III, IV, 72
(13) Aristote, Traité de la génération des animaux, II, V, 11-12
(14) Démocrite, Fragment CXLII, Aétius, Opinions, V, V, I.
(15) Virgile, L'Enéide, L. VI, 441
(16) Démocrite, fragment CCLXXI (Strobée, Florilège, IV, XX, 33)
(17) Les Hamadryades sont des nymphes des arbres. Elles sont comparables aux dryades, sauf qu'elles sont liées à un seul arbre, et meurent avec lui s'il est abattu.
(18) Ovide, Les héroïdes, épître IV
(19) Nonnos de Panopolis, Dionysiaques, chant 44.
(20) Démocrite, Fragment CCLXXV, Strobée, Florilège, XXIV, 29
(21) Plutarque, De la musique, IV, VII
(22) Démocrite, fragment CLIV, Plutarque, Quels animaux sont les plus avisés, 20, 974A.



