Chapitre II Où l’on montre que le tyran court après ce qui lui manque le plus, à savoir l’amour.
Résumé de l'épisode précédent : La veille, le sage Démocrite s’est efforcé de calmer les habitants de la petite colonie grecque de Cap negriti, passablement inquiets depuis l’élection de César Sarkominus ; et il a du repousser au lendemain son exposé sur le « système du monde ».
1. Où l’auteur relate son premier et bref dialogue avec le sage Démocrite
Au réveil, je préparais pour Démocrite une assiette de figues et un bol du lait albâtre qu’offrent les chèvres. Il faisait encore frais. Le sol un peu meuble m’indiquait que quelques gouttes de pluie étaient tombées durant la nuit. De la hauteur du cap, j’aperçu, d’un côté, la brume gris-bleu qui formait une rivière serpentante dans la plaine et, de l’autre côté, la mer opaque, lisse et désertée par les oiseaux. Une journée de chaleur pesante nous était promise.
Ma journée de travail s’annonçait éprouvante, aussi devais-je être économe de mes forces, me mouvoir avec lenteur, ne porter que de petites charges, tout en feignant d’en soulever d’énormes, pour tromper l’attention des maîtres. J’espérais, pour retarder la journée de travail, que Démocrite me retiendrait pour quelques conversations, mais il n’en fit rien. J’avais bien tenté de lancer une conversation, mais en vain.
« - Démocrite, lui ai-je dis, je regrette de ne n’avoir pu entendre votre récitation du Petit système du monde ». Le sage leva les yeux vers moi. Je devinais son sourire dissimulé dans sa barbe blanche, son amusement devant l’aplomb d’un enfant (j’avais treize, peut-être quatorze ans). Il porta son attention sur mes figues qu’il ouvrit en deux. Je repris sur un ton sentencieux : « J’ai trouvé immonde tous ces imbéciles épouvantés, plus préoccupés par leur petites angoisses personnelles, que de s’instruire ! ». Le sage leva les yeux vers moi, et me fit cette observation : « choisissez vos mots avec soins, mon garçon ! Ce qui est immonde, ce sont tous ces uniformes ignominieux de juges, de légionnaires, de miliciens, ainsi les monstres qui sont dedans… C’est faire un mésusage de la langue que de prétendre que des hommes tels que Théodotos, Méandros ou Aristée sont des êtres immondes. » Je restais un instant interdit, avant de lui répondre, sans élever la voix, mais en empruntant un timbre de voix aussi dur que possible : « Oui, mais moi - pour le cas où vous ne vous en seriez pas aperçu -, je suis l’esclave de l’un de ces hommes ! » Le sage me répondit : « Et alors ? » Ce que je pris pour une marque d’indifférence et de mépris, qui me mit en colère. Je quittais sa chambre. Je résolu de n’en pas foutre une rame de la journée, de dégueulasser le travail autant que possible, ne m’interdisant d’ailleurs pas de commettre, si je le pouvais en toute impunité, quelques larcins au détriment de mon idiot de Maître. Rétrospectivement, par ce « et alors ? », je crois que Démocrite voulait seulement m’interroger sur les conséquences que je tirais de ma situation d’esclave.
Je ne me souviens plus du déroulement exact de ma journée, sans doute semblable à toutes celles que j’avais vécues à la colonie, mais je me souviens que, le soir venu, j’ai rejoins l’agora pour y entendre Démocrite.
2. Où le philosophe Xénophon rapporte la remarquable intervention du littérateur Gainoïus au cours d’un séminaire sur la tyrannie « heureuse »
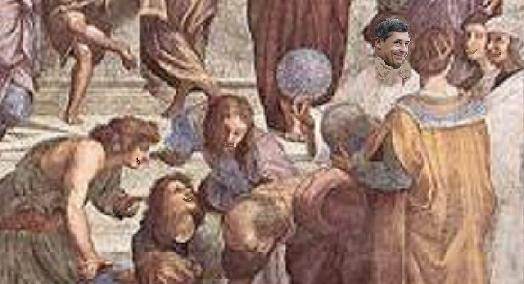
Gainoïus au séminaire sur la tyrannie, fresque Pompéi
Mon maître Théodotos refit des siennes, dès le début de soirée :
« - Estimé Démocrite, grand sage dont la Grèce s’enorgueillie, pérora-t-il, pardonne-nous, si, une nouvelle fois, nous te prions de reporter l’audition de ta récitation du Petit système du monde. Quand tu connaîtras nos raisons, je ne doute pas que tu nous approuveras. Nous avons, ce soir, parmi nous, le noble Xénophon, qui est venu donner une série de conférence à Massilia (1), et qui s’est empressé de nous rejoindre quand il a apprit ta venue. Tu comprendras que la possibilité d’organiser un débat entre Démocrite et Xénophon marquera à jamais les annales de notre petite colonie. C’est pour notre communauté une occasion sans pareille de mettre les pieds dans la vie de l’esprit ! »
« - Rien ne pouvait me faire plus plaisir que de revoir Xénophon », affirma Démocrite.
« - En plus d’un plaisir, c’est un honneur pour moi, répondit Xénophon. Je souhaitais te rencontrer afin de te soumettre une question qui nous taraude, Zénon, Simonide et moi-même. C’est une question, qu’à bien considérer, tu es le seul à pouvoir éclairer. Voici les faits : il y a un an, j’organisais à Corinthe un séminaire international sur la question de la tyrannie. Zénon, Simonide et feu notre ami Chrysippe, étaient présents, ainsi qu’un grand nombre de jeunes gens et de visiteurs étrangers qui nous honoraient de leur présence. Douze séances de travail étaient programmées, mais, à force de contributions plus brillantes les unes que les autres, je fus, à la douzième séance, bien en peine de trouver un sujet que nous n’ayons déjà épuisé. Venu - pour ainsi dire -, les mains dans les poches, j’ai suggéré un jeu : celui d’inventer une tyrannie « parfaite », une tyrannie « heureuse ». C’était un simple jeu, une spéculation divertissante, pour meubler la dernière journée de notre séminaire. J’ai soumis aux participants le syllogisme suivant : la prémisse majeure (2) était qu’un système politique n’approche la perfection et procure le bonheur à ses citoyens qu’autant qu’il cultive les qualités qui lui manquent le plus. Par exemple, les hommes libres, qui fondent la démocratie, doivent cultiver le respect de la loi, c’est-à-dire le respect de ce qui limite leur liberté ; les aristocrates, qui fondent leurs droits sur leur seule naissance, doivent cultiver les hautes vertus, puisqu’il n’y a rien de plus trivial que le fait d’être sorti du ventre de sa mère. La prémisse mineure du syllogisme était que quelque chose - à découvrir - manquait au tyran et qu’il lui faudrait cultiver cette chose pour créer une tyrannie heureuse. Ma proposition fut applaudie et nous étions tellement excités par cette activité ludique que Platon entra dans notre salle pour nous rappeler qu’il y avait encore, dans les lycées, des gens qui s’y réunissaient pour y travailler, et que nous devions faire moins de bruits. Simonide, auteur de l’essai « Le tyran contemporain : archaïsme ou modernité ?, enquête sociologique auprès d’une cohorte de quinze tyrans » hasarda une hypothèse, qu’il argumenta à partir de données extraites d’un entretien semi-directif qu’il avait eu avec un tyran, qu’il nomme Hiéron par soucis déontologique d’anonymiser son informateur. D’après ce soi-disant Hiéron, ce qui manque le plus au tyran, c’est l’amour. L’interviewé confie à l’enquêteur : « l’amour est de loin le sentiment qui consent le moins à loger dans le cœur du tyran » notamment parce qu’il doit, pour se maintenir, être méfiant et brutal. Il ajoute qu’un tyran ne connaît pas de bonheur dans le mariage, parce qu’il doit épouser une notable et que « les soins qui viennent des femmes les plus fières sont de loin les plus désagréables » ; face au mignon sur lequel il jette son dévolu, il découvre que la terreur qu’il ne peut manquer de lui inspirer anéantit toute perspective de tendresse véritable : « quand on a de l’affection pour lui, s’en faire détester et l’importuner si on le touche, n’est ce pas un malheur cruel et déplorable ? » L’amitié est pour le tyran hors de propos : que valent, en effet, les complaisances des gens qui vous craignent ? Et le tyran n’ignore d’ailleurs pas que « nul ne tend plus de pièges au tyran que ceux qui font le plus semblant de l’aimer » (3). Simonide nous suggéra alors cette hypothèse : si un tyran développait sa faculté d’aimer et parvenait à susciter l’amour chez son peuple, ne parviendrait-il pas à établir une tyrannie heureuse ? Nous saluâmes l’hypothèse de Simonide par des éclats de rires et, un tonnerre d’applaudissement qui ne s’interrompit qu’avec les coups de bâton que Platon, dans la salle du dessous, donna au plafond. Le calme revenu, je proposais de donner la parole à l’assistance. J’interpellais les participants, demandant si l’un d’eux pouvait nous aider à imaginer un tyran aimant son peuple et aimé de celui-ci. Il y eut un long silence, que je tentais de désamorcer avec des boutades du type « comme la première intervention est la plus difficile, alors passons directement à la seconde… » Je commençais à désespérer, quand j’aperçu avec bonheur une main se lever dans le public. Un homme du nom de Gainoïus se leva. Je l’encourageais à parler. Il se présenta comme un littérateur du pays de Droite.
« - Si je devais écrire les discours d’un tyran, nous dit-il, je ferais en sorte qu’il se présente à son peuple en prononçant ce genre de phrase : « Pour devenir votre César, il me fallait me donner tout entier, aimer sans réserve, abolir toutes les barrières et toutes les distances, et par conséquent accepter de devenir plus vulnérable, prendre le risque de souffrir. » (4) Ce tyran serait un homme lyrique.
« - Ce n’est pas mal… peut-être un chouïa pompeux, fis-je passablement déçu. Et donc, que dirait-il, dans ses envolées lyriques, votre tyran ? »
« - Et bien, poursuivit Gainoïus, il dirait avec un air grave et un peu sévère, quelque chose comme : « C’est l’amour qui crée le devoir. Si une partie de la jeunesse d’aujourd’hui a perdu le sens du devoir, c’est qu’elle n’aime pas assez. C’est parce qu’on ne lui a pas appris à aimer mais à détester. Mais c’est peut-être aussi parce qu’on ne lui a pas assez témoigné d’amour. C’est peut-être parce que ne se sentant pas assez aimée, elle se révèle elle-même en difficulté pour aimer. » (5)
Après avoir échangé quelques regards étonnés avec des participant, Chrysippe s’exclama enthousiaste : « J’aime beaucoup l’humour de ce Gainoïus… son côté pince-sans-rire est irrésistible… bravo ! Continuez ! »
Zénon renchérit : « C’est drôle, et cela ne manque pas de subtilité ! Gainoïus résout génialement la contradiction entre amour et tyrannie : il suffit de faire de l’amour un instrument de culpabilisation pour que ce doux sentiment devienne tyrannique. C’est plein de finesse… Félicitation ! »
« - D’autant plus, repris-je, que le tyran de Gainoïus déclare son amour pour son peuple pour mieux insinuer un sentiment de terreur dans la jeunesse en l’accusant de ne pas respecter ses devoirs, faute de savoir aimer ; mais, aussitôt, il s’emploie à culpabiliser les parents et les adultes en, insinuant qu’ils n’auraient pas su aimer ces jeunes gens, au point de les avoir rendu haineux et incapables de remplir ses devoirs… Gainoïus vient d’imaginer la chose la plus cocasse et la plus effrayante : la tyrannie par l’amour ! Je vous en supplie, poursuivez ! »
Gainoïus, bredouillant, reprit : « Merci pour vos remarques… Je n’y avais pas pensé moi-même… Ce que j’invente, ça sort tout seul, ça me vient comme ça… mais, dites-moi, la tyrannie par l’amour, on pourrait la décliner en telle sorte qu’elle touche toutes les catégories de citoyens, n’est-ce pas ?… » Nous le regardions un peu étonné. Nous fîmes « oui » de la tête, pour l’encourager à parler.
« - Je dis ça, reprit Gainoïus avec un sourire immense, parce que mon tyran pourrait dire aux étrangers : « Si certains n’aiment pas le pays de Droite, qu’ils ne se gênent pas pour le quitter. » (6) puis s’exclamer devant le peuple : « On leur demande seulement d’aimer le pays de Droite. » (7)
« - C’est pas mal, fis-je. Un peu classique le coup du métèque qui n’aime pas assez son pays d’accueil… C’est même inusable ! A quelles autres catégories de la population pensiez-vous ? »
« - Le tyran, poursuivit Gainoïus, pourrait s’adresser ainsi aux édiles : « comment faire aimer la République à tous ceux qu’elle laisse à l’écart : travailleurs pauvres, mères qui élèvent seules leurs enfants, ruraux qui voient partir tous les services publics, agriculteurs à la pension de retraite dérisoire, ouvriers de l’industrie en concurrence avec la main d’œuvre bon marché du Tiers-Monde, jeunes qui mettent des années à accéder à un emploi stable, personnes âgées abandonnées à leur solitude ? » (8)
« - C’est bien vu, s’exclama Simonide. Cette formulation insinue que si certaines catégories de citoyens manquent d’amour pour la République, la faute en incomberait aux puissants et aux administrateurs de la Cité qui la gèreraient mal. Mais en aucun cas, le tyran n’insinue qu’il faudrait remédier aux injustices de la Cité. Manière de dire aux grands : si vous voulez garder votre place faites-vous aimer du peuple malgré le règne de l’injustice. Chacun sait qu’une tyrannie ne peut survivre si les fonctionnaires du palais vivent sans crainte de représailles. Ici, la capacité à se faire aimer devient le critère d’évaluation des serviteurs de l’Etat ! Ce n’est pas banal. Vous êtes talentueux, Gainoïus ! »
« - Vous savez, répondit Gainoïus en bafouillant, moi, je suis une sorte de poète. Ce que j’écris, ce n’est pas réfléchi. C’est la muse qui fait tout. »
« - Tout ceci est très amusant, interrompit Zénon, mais au final peu convainquant car on imagine mal qu’un peuple soit assez corrompu pour préférer l’amour d’un tyran à l’amour qu’il éprouve pour sa propre liberté… Une telle inversion de valeur suppose un décervelage, une éducation à la servilité qui débuterait dès l’enfance. »
Gainoïus resta un instant pensif avant de relancer son propos : « Mais oui, bien sûr ! Vous avez raison ! Il faut imaginer un programme éducatif ! Je le sens bien ce programme éducatif ! Dans mon pays, chacun connaît plus ou moins l’histoire d’un jeune garçon qui fut un héros de la liberté, un symbole de la rébellion contre les envahisseurs Teutons. Ce garçon, du nom de Môquetus, fut martyrisé et laissa une lettre bien triste adressé à sa mère. Imaginons qu’au lieu de s’incliner devant le courage sans pareil de cet enfant, mon tyran explique que ce héros est beau, non pour son courage, mais parce qu’il aime ses parents. Il dirait par exemple : « Les plus petites paroles d’amour qu’un grand garçon de 17 ans adresse à sa mère et à son père prennent une grandeur tragique quand ce sont les dernières, non parce que la vie va cesser mais parce qu’après il ne sera plus possible d’aimer. J’ai suffisamment d’expérience de la vie, de ses épreuves comme de ses joies pour vous le dire avec certitude. Aimer, c’est la seule chose qui compte vraiment. Seront plus heureux ceux qui parmi vous le comprendront avant qu’il ne soit trop tard. » (9) L’aptitude à aimer sa maman serait érigée en valeur suprême et les pédagogues évoqueraient les grands hommes en répondant principalement à la question : aimaient-ils ou n’aimaient-ils pas leur maman ? Hannibal : aimait ou n’aimait pas sa maman ? Cicéron : aimait ou n’aimait pas sa maman ? Attila le Huns : aimait ou n’aimait pas sa maman ? »
Gainoïus suscita une vague de rire et d’applaudissements frénétiques, du moins de ceux qui ne se roulaient pas déjà par terre. Et quand les coups de bâton de Platon résonnèrent, toute la salle entonna à tue-tête « Platon : aime ou n’aime pas sa maman ? Platon : aime ou n’aime pas sa maman ? » Nous tapions des mains et des pieds sur le sol pour répondre au coup de bâton de Platon.
Nos vies et nos études reprenant leur cours normal, cette journée peu ordinaire, cher Démocrite, finit par s’effacer de notre mémoire… Jusqu’à ce que nous apprenions que Sarkominus avait recruté Gainoïus pour qu’il rédige ses discours. La nouvelle de la promotion de notre joyeux camarade nous amusa beaucoup. Puis, nous apprîmes l’élection de Sarkominus et reçûmes, chacun, un exemplaire du recueil des discours de Sarkominus, dédicacé par Gainoïus. Il nous remerciait pour notre « aide précieuse », car sans nous, affirmait-il, il n’aurait jamais eu l’audace de promettre au peuple une tyrannie heureuse. Et en conclusion, il nous assurait nous être « éternellement redevable » de nos « conseils » et de nos « chaleureux encouragements. »
Cher Démocrite, voilà la question qui me vient à l’esprit. N’avons-nous pas commis le mal en riant d’un sujet aussi sérieux que celui de la tyrannie ? Peut-on rire de tout ? N’est-il pas plus sage d’imiter mon vénéré maître, Socrate, qui se contentait de pratiquer l’ironie, par exemple en questionnant ses interlocuteurs tout en feignant l’ignorance, pour mieux les acculer à révéler les failles de leur raisonnement ? Ironiser sur tout, je ne dis pas… mais rire sur tout, est-ce vraiment sain ? Tu as du prendre connaissance du rapport du légiste à propos de la mort de notre estimé confrère et ami Chrysippe : « Il mourut à force d'avoir trop ri : voici à propos de quoi. Ayant vu un âne manger ses figues, il dit à la vieille femme qui demeurait avec lui, qu'il fallait donner à l'animal du vin pur à boire ; et que là-dessus il éclata si fort de rire qu'il en rendit l'esprit » (10)
3. Où le sage Démocrite démontre que si la peur est épidémique, le rire et le courage ne sont pas moins contagieux
Le silence se fit. L’assemblée se tourna vers Démocrite pour l’entendre. L’éclat du rire puissant du sage répondit aux dizaines de pairs d’yeux tournées vers lui.
« - Excusez-moi, murmura Démocrite en essuyant une larme, je ris en souvenir de Chrysippe qui savait si bien dérouter l’esprit et nous laisser mi-figue, mi-raisin. »
Puis, reprenant son air doux et sérieux, il s’adressa à Xénophon : « Cher Xénophon, tu as mille fois raison de distinguer le rire et l’ironie. L’ironie sait mettre au jour les failles d’une logique. Mais, n’est-ce pas le propre de toute logique que de rencontrer sa faille. Toute logique, lorsqu’elle est poussée à son terme, ne devient-elle pas aussi illogique qu’inhumaine ? Notre ami Chrysippe, avec quelques plaisanteries, réglait leur compte à ceux qui prétendaient embrasser la totalité du réel avec leur petite logique. Il lui suffisait de prononcer un « celui qui communique les mystères à des gens qui ne sont pas initiés est un impie : or, celui qui préside aux mystères les communique à des personnes non initiées ; donc celui qui préside aux mystères est un impie » ou encore un « ce que vous n'avez pas jeté, vous l'avez : or vous n'avez pas jeté des cornes ; donc vous avez des cornes. » Cela pour rappeler que la logique est un bâton pour avancer à tâtons dans le monde et non un guide certain. L’ironie révèle les failles d’une logique, mais le rire, lui, met en relation, dans la fulgurance, deux plans logiques à priori incompatibles entre eux. Par exemple, on dit de tyrans qu’ils réalisent de « grandes » impostures, de « grands » crimes contre la république et parfois même de « grands » crimes contre les hommes. Nous leur accordons donc une forme de grandeur, même si cette grandeur est maléfique. Rire du tyran c’est saisir cette chose inouïe : cette « grandeur » n’est qu’une montagne des petitesses : petitesses du tyran, petitesse des esprits médiocres qui tremblent devant la liberté, petitesses des sbires qui, pour lui plaire, rivalisent de soumission et de cruautés, petitesses de ceux qui soutiennent pour mieux défendre leurs intérêts, petitesses des lâches qui auraient pu s’opposer et ne l’ont pas fait, petitesse des indifférents qui auraient pu soulager une souffrance et qui s’en sont abstenu. Le rire appliqué au tyran, fait s’évanouir sa soi-disant grandeur, et met au jour un tas gigantesque de médiocrités, de bassesses et de lâchetés. Petitesses semblables aux grains de sable, qui s’accumulent pour former des tas, qu’il est facile, au début, de disperser d’un coup de pied, mais qui finissent par former des dunes immenses. Notre ami Chrysippe nous à laissé le symbole de la figue et du raisin en guise de testament. Le figuier est l’arbre généreux et courageux, qui s’accroche au moindre creux de rocher et à la moindre fissure pour puiser l’eau dont il a besoin. Et le vin pur, c’est l’ivresse. Le rire tient de la figue et du vin ! C’est un massage stimulant pour l’homme qui s’accroche au désir de vivre et refuse d’être terrassé par la peur. Et, comme le vin, le rire reprend dans le corps une sensation de vertige et de bien-être. Le rire, c’est communicatif. Il rapproche les cœurs. C’est l’antidote à la panique, qui, elle aussi, est communicative. Mais le courage n’est pas moins communicatif. Tu connais sans doute, Xénophon, ces vers de Catulle à propos de Sapho :
« Il goûte le bonheur que connaissent les dieux
Celui qui peut auprès de toi
Se tenir et te regarder,
Celui qui peut goûter la douceur de ta voix,
Celui que peut toucher la magie de ton rire,
Mais moi, ce rire, je le sais,
Il fait fondre mon cœur en moi. »
Xénophon resta un temps silencieux. Il dissimulait mal la contrariété que lui inspirait la réponse habile de Démocrite. Il fit alors cette suggestion, qu’il prononça avec délectation : « Il est tard, aussi devrions-nous aller nous coucher. Mais, j’aurais grand plaisir, demain, à poursuivre notre conversation. Nous pourrions examiner si, à l’instar du plaisir que nous prenons à rire des tyrans, nous pouvons trouver une joie équivalente à rire… des dieux. » Xénophon souriait du défi qu’il lançait Démocrite. Un frisson à parcouru l’assistance terrifié par cette proposition impie. Démocrite donna son accord en mettant en garde : « c’est une question délicate car il est très difficile d’égaler l’humour des dieux et de leur ‘‘rire inextinguible’’ » (11) Puis, il remercia l’assemblée de son accueil et de son écoute attentive.
4. Où l’on présente un philosophe des plaisirs nommé Fillonus
Fillonus, chef des fonctionnaires du palais, parce qu’il était tout particulièrement satisfait de sa journée, était, de même, heureux d’aller se coucher.
Sarkominus avait surnommé Fillonus, « mon plus-que-parfait collaborateur » (12), sans doute parce qu’à l’instar de la forme verbale, cet homme semblait revenu d’un passé inconnu des Anciens eux-mêmes. On prétendait que seuls les hommes du préhistorique de l’Age d’Or eussent pu l’égaler en sagesse. Il inspirait le respect et même un mouvement de recul chez ceux qui le croisait : son regard ténébreux, dissimulé sous des sourcils épais et broussailleux, son teint gris, stigmate de l’action de la bile noire sur son estomac, témoignait de sa nature mélancolique, froide et apathique et périodiquement agitée par le souffle brûlant de pensées secrètes et incommunicables.
La frugalité était, chez lui, une habitude ancrée. Aucune femme ne parvenait à le séduire. Son épouse, confiait-il à ses intimes, l’avait d’abord charmé par la grâce à son prénom : Pénélope. Ce doux prénom, il lui arrivait de le murmurer, parce qu’il lui évoquait l’irrésistible, l’adorable et ingénieuse épouse d’Ulysse qui, faisant et défaisant sans cesse sa tapisserie, avait su, dix ans durant, égayer ses journées avec un budget de pelotes de laine des plus raisonnables. Il voulait, comme homme d’Etat, faire partager à ses concitoyens « le bonheur de la vie frugale ».
Non pas qu’il eu un goût pour les privations ! Non ! Les privations n’étaient à ses yeux qu’instrument indispensable au plaisir. Bien souvent il récitait ces paroles profondes de son Maître Epicure : « Nous sommes intimement convaincus qu’on trouve d’autant plus d’agréments à l’abondance qu’on n’y est moins attaché. Du pain et de l’eau procurent le plaisir le plus vif, quand on les mange après une longue privation. L’habitude d’une vie simple et modeste est donc une bonne façon de soigner sa santé, et rend l’homme par surcroît courageux pour supporter les tâches qu’il doit nécessairement remplir dans la vie. Elle lui permet de mieux apprécier, à l’occasion, les repas luxueux et, face au sort, cette vie modeste l’immunise contre l’inquiétude. » (13) Epicurien dans l’âme, il s’autorisait même, dans de rares (et d’autant plus excitantes) occasions des plaisirs luxueux. Il possédait de nombreux chars rutilants et des chevaux parmi les plus magnifiques, et lorsqu’il ressentait quelques vague à l’âme, il ne manquait jamais de se rendre au stade pour y lancer un attelage, qu’il fouettait jusqu’au sang, afin de le porter jusqu’à des vitesses enivrantes. Il s’imposait un régime quotidien de pain sec et d’eau, mais pour mieux goûter ce qu’il appelait ses « cures de bombance » dans des palais égyptiens, exotiques et sensuels (14). Et à ceux qui prétendaient voir là une contradiction, il répondait, sibyllin, en citant ce précepte antique des pharaons : « Hosni soit qui mal y pense, je ne moubaraquerais pas de ma poche. »
La frugalité n’est pas l’ennemie des plaisirs, et la privation, répétait-il, est le ressort même du plaisir : « Le nourrisson longtemps privé de sa mère, n’a-t-il un bonheur magique à la retrouver ? Le pauvre à qui ont a ôté ses derniers moyens de subsistance n’éprouve t-il pas un bonheur inouïe le jour où il parvient à s’enrichir ? » Le bonheur, expliquait Fillonus, résultait d’un mouvement mécanique dont l’intensité était fonction d’un différentiel entre deux états, l’un, douloureux et, l’autre, non douloureux, l’un privatif et l’autre rassasiant. Plus l’écart était grand entre l’un et l’autre, plus le plaisir était immense.
Il se doutait bien que sa politique entièrement axée autour du seul projet de trancher dans toutes les dépenses de l’Etat, ferait de nombreux mécontents. Mais, il ne doutait pas non plus qu’en privant les citoyens de leurs moyens de subsistance, il offrait aux chanceux la possibilité de vivre l’expérience extatique de passer du rien au plein. Et même si son œuvre devait rester incomprise, insistait-il, il ne s’en détournerait pas. Ceux qui ont eu l’occasion de voir après qu’il eu tranché dans des dépenses, par exemple, après une réduction de la portion de pain distribuée aux vieillards ou la création d’une taxe sur les oboles reçues par les infirmes, devinaient, à son teint soudain rosé, reposé, à son œil brillant et sa bouche molle et humide dessinant une sorte de sourire, qu’il avait une véritable passion pour son office.
5. Où l’on apprend comment Fillonus enseigna à Sarkominus le moyen d’inculquer aux ploutocrates le sens de la gratitude.
En fin de matinée, Fillonus visita Sarkominus. Il frappa longuement à la porte de l’appartement du César, jusqu’à ce qu’un esclave effrayé lui ouvre la porte. Des gémissements le guidèrent jusqu’à la chambre à coucher. Il y trouva Sarkominus sanglotant, étendu sur son lit. Fillonus tenta bien un geste de réconfort, mais cela déclencha chez Sarkominus une saccade de sanglots spasmodiques.
La présence de l’esclave, témoin de cet abaissement du César, lui revint soudainement en mémoire. Il alla vers l’esclave pour lui demander : « d’autres que toi ont vu notre grand César dans cet état ? ». L’esclave eut à peine le temps de faire « non » de la tête, que Fillonus lui plantait un poignard dans le cœur, l’empaquetait dans une tenture vigoureusement arrachée et dissimulait son corps dans une malle bien vite enfermée dans un cagibi.
« - Mon doux César, dit-il en nettoyant ses mains souillées de sang dans une cuvette, d’où vous vient ce gros chagrin ? »
Sarkominus parvint à bégayer un : « Je suis un tyran… et personne ne m’aime ! »
« - Par tout les dieux, qu’allez-vous imaginer !, s’exclama Fillonus, tout le monde vous aime ! Des centaines de personnes font la queue devant le palais pour vous rencontrer. J’ai remarqué dans la file d’attente le fameux duo d’histrions Elkabbachus et Apathus, venus soumettre à votre approbation leur prochain spectacle sur le thème de vos amours avec Messaline. Vous devriez les recevoir, cela vous distraira. »
« - Sac à merde ! », hurla Sarkominus. Fillonus sursauta. Mais aussitôt le laquais Hortefeucus, nommé « Commissaire aux questions métèques » par Sarkominus, entra précipitamment dans la chambre.
« - Sac à merde (car c’est ainsi qu’il appelait son serviteur), va donc me chercher Messaline, Elkabbachus et Appatus ! »
Hortefeucus sortit précipitamment et revint quelques instants plus tard accompagné de Messaline, de sa suivante Datia et d’une troupe d’acteurs.
« - Regarde bien, Messaline, fit Sarkominus. Elkabbachus et Apathus vont te montrer ce que le peuple pensera demain ! »
L’intrigue était simple et efficace : Messaline, interprétée par un Apathus revêtu d’une robe de taffetas rose, se désolait d’être négligée par son époux. Puis le Chœur entrait en scène et racontait que Messaline, rendue furieuse par cet abandon, se livrait à toute sorte d’excès. Elkabbachus, portant un phallus démesuré (15), interprétait Sarkominus. Il expliqua au public que sa petite taille était la rançon de son membre exorbitant. Le Chœur reprit la parole pour plaindre amèrement Sarkominus d’avoir une telle épouse. A la fin, tout rentrait dans l’ordre : Elkabbachus-Sarkominus engrossait « sa petite lionne lubrique », et Messaline-Apathus se sentait de nouveau débordante d’amour pour le plus puissant des Césars.
Hortefeucus applaudit à tout rompre et poussa des « bravo ». Messaline, furieuse, le bouscula pour s’écrier en pointant du doigt Fillonus : « Vous avez fait de mon époux votre marionnette ! Mais toi, Sarkominus, n’oublie jamais que c’est moi qui t’ai créé ! »
Sarkominus trembla de colère et se tourna vers Hortefeucus : « Espèce d’étron gélatineux (car c’est ainsi qu’il appelait son serviteur), tu vas rester planté là ? Débarrasse-moi d’elle ! » Hortefeucus s’empara de Messaline, mais aussitôt, Datia, la suivante de Messaline, grimpa sur le dos du laquais pour lui lacérer le visage avec ses ongles effilés. « Débarrasse-moi d’elle ! » hurla de nouveau Sarkominus. Le malheureux Hortefeucus avait beau protester en invoquant que « quand il y a une femme, ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes » (16), Sarkominus n’en continuait pas moins à hurler : « Débarrasse-moi d’elle ! ». Le laquais-Commissaire aux questions métèques finit par empoigner l’épouse et sa servante par la chevelure, et, sous une pluie de coups de pieds et de morsures, à les traîner jusqu’à leurs appartements, où il prit toutes les précautions nécessaires pour qu’elles y demeurassent recluses.
Sarkominus, l’air désespéré, adressa à Fillonus un : « Tu vois bien…, je ne suis pas aimé… »
« - Mais si !, s’exclama, Fillonus. Le Peuple, lui, il vous aime. »
« - Non !, sanglota Sarkominus. Il ne m’aime pas pour moi-même. Ce matin, en traversant la foule, un maître m’a interpellé d’un : « Ô Sarkominus, toi qui leur fait peur, quand donc remettras-tu tout ces esclaves paresseux au travail ? » ; plus loin, un esclave, m’a lancé : « Ô Sarkominus, toi qui inspire la crainte, quand donc feras-tu mordre la poussière à ceux que tu appelles très justement les Maîtres-voyous ? » ; puis, un riche m’a demandé : « Ô Sarkominus, toi qui inspire la peur au pauvres, quand donc les forceras-tu à accepter les salaires que nous leur proposons ? » ; puis un pauvre m’a interpellé d’un : « Ô Sarkominus, quand donc abattras-tu ta colère sur les spéculateurs ? » ; un professeur m’a crié : « Ô Sarkominus, quand donc viendras-tu dans les écoles pour apprendre aux élèves ignares à respecter leur maître ? » ; et un élève m’a lancé : « Ô Sarkominus, n’est-ce pas que tu vas leur rabattre leur caquet à cette petite intelligentsia qui se croit savante et qui n’enseigne que des choses inutiles ? » Tu vois, Fillonus, ils ne m’aiment pas pour moi-même. Ils aiment que je fasse peur à ceux qu’ils haïssent. Ce n’est pas ça le vrai amour ! »
« - Mais, les ploutocrates, eux, reprit Fillonus, ce sont vos amis ! Ils vous aiment ! »
« - Mais non ! C’est pareil : ils m’utilisent », miaula Sarkominus.
« - Oh ! Comme vous y allez !, reprit Fillonus. En vérité, ils vous aiment, mais ils le cachent. Et je vais vous dire pourquoi... » Fillonus prenant un air circonspect s’approcha tout près de Sarkominus et lui murmura à l’oreille : « Ils vous aiment, mais d’un autre côté, ils vous envie, à cause de vos succès et de votre génie. Ils se sentent rabaissé en votre présence, alors leur amour se trouble, ils n’osent plus l’exprimer. »
« - Evidemment, qu’ils m’envient !, s’exclama Sarkominus. Mais qu’est-ce que je peux y faire ! »
« - Et bien, pour les guérir de leur vilaine envie, affirma doctement Fillonus, montrer leur l’exemple : ne les enviez pas ! »
« - Mais, je ne les envie pas… », répondit Sarkominus.
« - Vous n’en aurez que plus de facilité à leur montrer que vous ne les enviez pas et à devenir un exemple pour eux !, poursuivit Fillonus. L’envie est le sentiment opposé à celui de la gratitude. L’envieux veut insatiablement posséder ce qu’autrui possède et il déteste l’autre pour le bonheur qu’il éprouve à posséder. A l’inverse, celui qui éprouve de la gratitude admire et aime l’autre parce qu’il sait donner. Soyez leur pédagogue ! Enseignez-leur la gratitude, enseigner leur à aimer celui qui donne, comme ça, ils voudront ensuite ressembler au donateur et finiront par se débarrasser de leur vilaine envie ! »
« - Mais comment leur enseignerais-je la gratitude ? », demanda Sarkominus.
« - Pour mettre les choses en pratique, voilà mon conseil, poursuivit Fillonus. Videz les coffres du palais et faisant des cadeaux à vos amis ploutocrates. Chacun de ces cadeaux sera la preuve admirable de ce que vous ne les enviez pas, et l’instrument de votre pédagogie de la gratitude. Rappelez-vous qu’un César doit donner l’exemple ! »
Ces propos allèrent droit au cœur de Sarkominus. Il convoqua les fonctionnaires du Palais affecté à la garde du trésor pour leur ordonner de préparer des sacs d’or et de les porter aux plus riches citoyens de la ville, accompagnés d’un petit mot signé de sa main : « pour que vous vous sentiez moins envieux envers votre ami, Sarkominus, qui a beaucoup de gratitude. » (17) Pour s’assurer que les ploutocrates feraient preuve, en retour, de gratitude, Sarkominus se fia, en guise de « baromètre à gratitude », à un cabinet d’avocats, spécialisé dans l’immobilier, qu’il avait lui-même créé et dont il conservait la propriété (17). Quand un messager lui annonça que les ploutocrates qui avait reçu ses paquets cadeaux fiscaux se battaient à l’entrée de son cabinet d’avocat pour lui acheter les maisons qu’il avait en stock, Sarkominus fut une nouvelle fois stupéfait par l’ingéniosité et l’intelligence de Fillonus : les ploutocrates prenant exemple sur lui, avaient belle et bien assimilé les principes de la gratitude. Soudainement prit de scrupules, il voulu s’assurer qu’il n’y avait point d’artéfacts ou de biais dans le raisonnement du sage Fillonus. Il tenta, donc, une nouvelle vague de dons, en supprimant des taxes qui pesaient sur la spéculation foncière. Le capharnaüm provoqué par l’affluence de clients fortunés envahissant son cabinet d’avocats acheva de le convaincre de la solidité des raisonnements de son « plus-que-parfait collaborateur ».
« - Vous voyez ! Ils vous aiment ! », s’écria Fillonus pour l’encourager à prendre de nouvelles mesures. Durant une heure, Sarkominus s’efforça de perfectionner sa technique d’évaluation de la gratitude des ploutocrates grâce à un messager qui faisait des allers-retours entre le cabinet et le palais, et qui lui décrivait les effets de tel don ou de telle suppression de taxes.
Au milieu de l’après-midi, ils décidèrent de faire une pause. « Ma crotte ! » (car c’est ainsi qu’il appelait son serviteur) hurla Sarkominus. Hortefeucus paru. « Dis-moi, ma crotte, peux-tu descendre à la salle du trésor, pour nous dire ce que nous avons en solde ? » Hortefeucus grimaça : « c’est que… dit-il en bredouillant, quand il y a une pièce à compter, ça va, c’est quand il y en a plusieurs qu’il y a des problèmes. » Furieux, Sarkominus, lui ordonna de descendre sur le champ à la salle du trésor.
Horfeucus revint quelques minutes plus tard, accompagné par Gainoïus et par le mage Guéantus, tous deux blêmes.
« - Alors ? », demanda Sarkominus. Hortefeucus soulagé, tenant une pièce à la main, répondit : « tout va bien, j’ai eu chaud, il ne restait plus qu’une pièce dans le coffre, je n’ai pas eu de problèmes pour la compter. »
« - Fillonus !, hurla le mage Guéantus en pointant du doigt le « plus-que-parfait serviteur », tu lui as fait vider les caisses du palais ! »
« - Guéantus !, l’interrompit Gainoïus, s’il te plait ne hurle pas, d’abord, je déteste ça et ensuite, je t’avais bien dit qu’il ne fallait pas laisser Sarkominus sans surveillance… Mais comme tu ne m’écoutes jamais et que tu as toujours des divinations tellement importantes à faire, moi, je dis, que ce vidage de caisses, ça devait arriver. »
« - Mais quand même !, s’indigna le mage Guéantus. Il a vidé les caisses du palais ! C’est fou ça ! »
« - Oui, mais moi, je ne peux pas tout le temps surveiller Sarkominus. Et puis, c’était ton tour !, répliqua Gainoïus. Je n’ai pas des choses aussi importantes à faire que des divinations, c’est vrai, mais j’ai aussi du travail. »
« - Mais bon sang, je ne t’accuse pas, Gainoïus !, s’exclama le mage Guéantus. C’est la faute de ce fourbe de Fillonus ! Et tu sais pourquoi il a fait ça ? Pour pouvoir assouvir sa passion de faire des coupes dans les dépenses ! Regarde-le comment il rigole par en dessous. » Puis s’adressant à Fillonus, il lui lance : « tu es content de toi ? Espèce de malade ! »
« - Oui, mais c’est bien la peine d’être mage et devin, si c’est pour ne pas prévoir ce genre de pépin… », maugréa Gainoïus.
« - Je n’aurais pas du vider les caisses ? », demanda désespéré, Sarkominus.
« - Mais non, mais non, Fillonus et Guéantus ont une petite dispute, mais tout va bien, fit Gainoïus. Ne t’en fais pas, Guéantus va arranger tout ça. N’est-ce pas Guéantus ? Quand à toi, Fillonus, sache que Sarkominus n’est pas une marionnette. Et puis, n’abuse pas, car Sarkominus, ne l’oublie pas, c’est Guéantus et moi qui l’avons fait ! »
Fillonus sortit et, aussitôt la porte refermée, on l’entendit danser dans les couloirs du palais et chantonnant : « Je suis à la tête d’un Etat en quasi faillite (19), je vais pouvoir faire des coupes partout… »
Gainoïus et Guéantus prirent Sarkominus par la main, car il devait partir pour le congrès de l’Internationale des ploutocrates auquel étaient conviés les Grands de ce monde. Sarkominus allait pouvoir retrouver son héros, Dobélioubouche l’Atlantidéen, mais aussi Angéla la reine des Teutons, Vladimir le Scythe et Tony le Picte. En guise de dernières recommandations Guéantus expliqua à Sarkominus : « J’ai parlé de votre projet d’Union de la Mare Nostrum avec l’ambassadeur des Shins, et il m’a dit que leur empereur est emballé par ce projet. Alors pour éviter les confusions, et pour que votre intervention soit percutante, vous vous concentrez sur votre projet d’Union de la Mare Nostrum et la paix universelle qui va avec. Sur les autres sujets, moins intéressants, plus techniques, vous me laissez faire. Si vous voulez, vous faites « oui » de la tête de temps en temps, ça sera très bien. »
Notes :(1) Marseille
(2) Dans le syllogisme, la prémisse majeure et la prémisse mineure précède la conclusion : Tous les hommes sont mortels (premisse majeure), or Socrate est un homme (premisse mineure), donc Socrate est mortel.
(3) Xénophon, Hiéron ou sur le tyran, I, 30 ; I, 28 ; I, 36 ; I, 37
(4) Nicolas Sarkozy, Discours à Bercy (29/04/07)
(5) Nicolas Sarkozy, Discours au Zénith (18/03/07)
(6) Nicolas Sarkozy, Discours à Villebon-sur-Yvette (20/03/07)
(7) Nicolas Sarkozy, Discours à Metz (17/04/07)
(8) Nicolas Sarkozy, Discours à Périgueux (12/10/06)
(9) Nicolas Sarkozy, Discours au Zénith (18/03/07)
(10) Diogène Laërce, Vie des philosophes, L. VII, 185
(11) Homère, Odyssée, Chant VIII, v. 326
(12) « Fillon est plus que parfait », confiait Sarkozy à des journalistes, le 22 mars 2007 dans un avion qui l'amenait aux Antilles. Le 11 septembre 2007, Sarkozy déclarait à des journalistes : « Le Premier ministre est un collaborateur. Le patron, c’est moi. »
(13) Epicure, Lettre à Ménécée
(14) François Fillon est passionné de voiture de course automobile qui aura participé à plusieurs éditions du 24 Heures du Mans Classic et qui aura abondamment fait usage des deniers de Conseil général de la Sarthe, qu’il a présidé, pour renflouer cette manifestation. Le Canard Enchaîné n°4583, en date du 27.08.08 relève que Matignon a revendue 50 véhicules d’occasion pour faire l’acquisition de nouveaux véhicules. Fillon s’est manifestement fait plaisir puisque la moitié de la somme dépensée pour renouveler le parc automobile de Matignon a été utilisée pour l’achat de sa seule voiture : une Citroën C6 suréquipée et blindée au Kevlar à plus de 120.000 euros. Chose étrange, révélée par France Soir du 24.02.11., alors qu'il pourrait rentrer chaque week-end en voiture dans son manoir de Solesmes, avec en plus d’ajouter à la joie de rouler, celle de ne dépenser que 60 € d'essence et 40 € de péages, il utilise un avion Falcon de la République, pour un coût de 27.000 €. Fillon ne déteste pas non plus les voyages d’agréments. Le Canard Enchaîné n°4711 du 09.02.11 révèle comment, à l’occasion de vacances privées, il aura bénéficié d’ « un vol entre Assouan et Abou-Simbel dans un jet aimablement prêté par le sympathique Hosni Moubarak en personne » et d’un hébergement au palace Mövenpick (sans parler de la maison privée dans les jardins d'un palace Mövenpick pour les personnes qui l’accompagnait). « S'il fallait faire le compte de tous ces menus frais, la facture serait hors de portée, même pour la bourse d'un Premier ministre », note le Canard.
(15) Le costume comique masculin dans les comédies antique grecques, comportait bien souvent un énorme phallus postiche doté d'un gland vermillon. Reste que le virilisme démonstratif compte parmi les codes de base du style Sarkozy. Le canard enchaîné rapporte cette phrase de Sarkozy, reprise par E. Fassin dans un article paru dans Libération (Sexe, identité et trahison, Libération du 04.01.2010) : « Les Français veulent un président qui en a, et qui sait s’en servir. »
(16) Le 5 septembre 2009, à l'université d'été de l'UMP, à Seignosse, Hortefeux, ministre de l’Intérieur, déclare à propos des arabes : « Quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. » Pour cette tirade, le 4 juin 2010, Hortefeux sera condamné à 750 euros d'amende et 2000 euros de dommages et intérêts pour injure à caractère raciale.
(17) La loi dite, improprement, « sur le travail, l’emploi et le pouvoir d’achat » (TEPA) votée à l’été 2007, va offrir aux plus riches un « bouclier fiscal » qui exonère de payer, en impôt, plus de 50% de son revenu. Il va de soi, qu’il s’agit de 50% du revenu qui n’a pas pu être préalablement défiscalisé grâce aux « niches fiscales » (dont le coût cumulé, en 2008, représente une perte de 73 milliards pour les caisses de l’Etat) ou dissimulés grâce aux paradis fiscaux. En outre, le « bouclier » comptabilise comme « impôt » des cotisations sociales comme la Contribution sociale généralisée (CSG) et la Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Sur les revenus déclarés pour 2008, 16350 heureux contribuables se sont vu remboursé 585 millions d’euros. Les plus riches d’entre eux, soumis à l’Impôt de solidarité sur la fortune, soit 47% des bénéficiaires du « bouclier » se taillent la part du lion, en se partageant 580 millions d’euros, soit 75780 euros par tête de pipe.
(18) Sarkozy, président est resté propriétaire de son cabinet d’avocat spécialisé dans l’immobilier. Ce cabinet transformé en société d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS), rémunèrent ses membres aussi bien par honoraires que par le versement de dividendes. Le 6 mars 2007, la société « Selas Arnaud Claude-Nicolas Sarkozy » est rebaptisée « Arnaud Claude et associés » et la gestion des parts de Sarkozy est confiée à son associé, en telle sorte qu’il en perçoit les dividendes tout en reversant un « loyer » d’un montant inconnu à Sarkozy. Le cabinet compte parmi ses clients Martin Bouygues, le groupe pharmaceutique Servier, Bernard Arnault et LVMH, ainsi que des vedettes du showbiz.
(19) Le 21 septembre 2008, Fillon déclare : « Je suis à la tête d'un Etat qui est en situation de faillite sur le plan financier, je suis à la tête d'un Etat qui est depuis 15 ans en déficit chronique, je suis à la tête d'un Etat qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Ca ne peut pas durer. »



