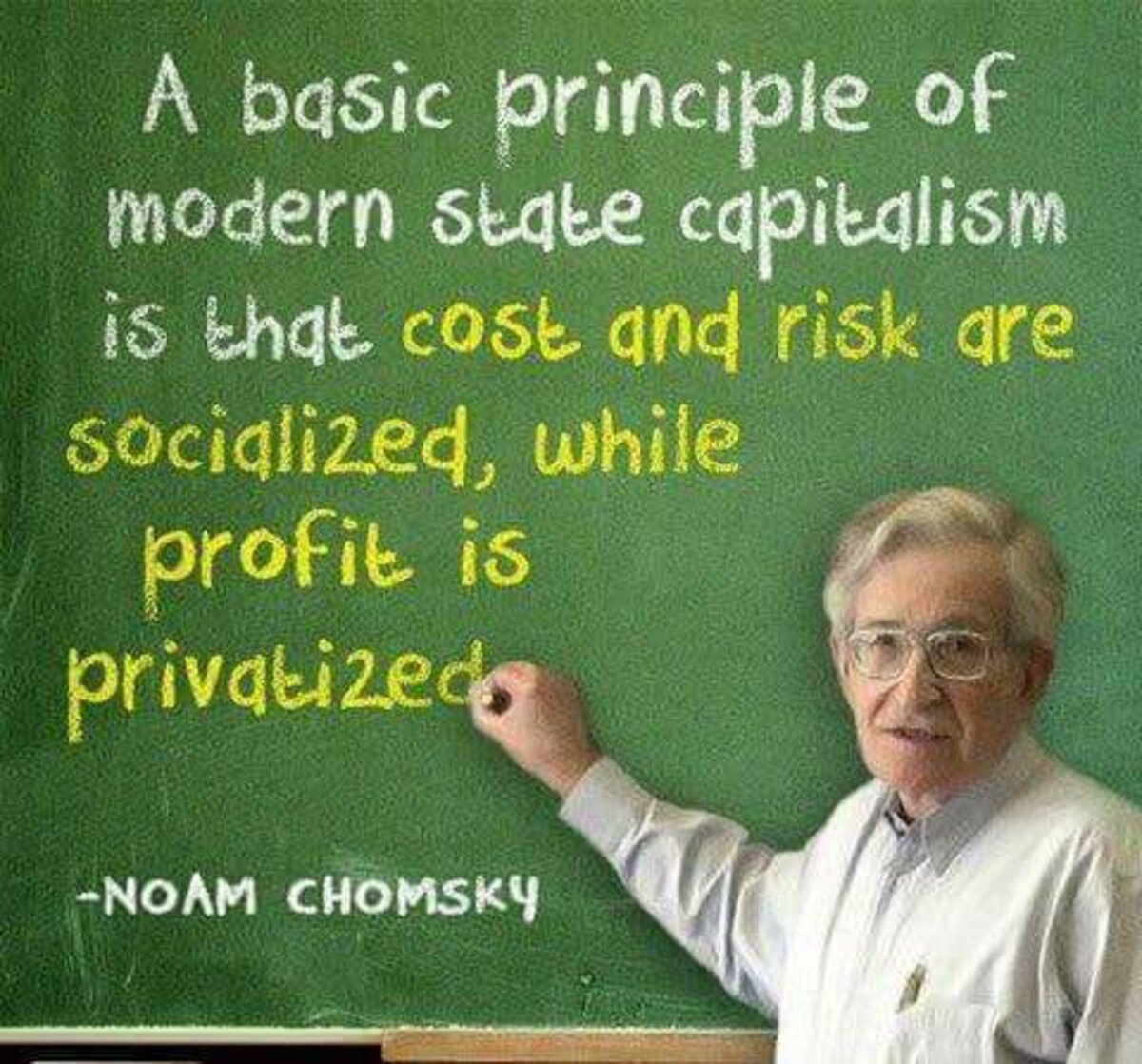
« Un principe de base d’un état capitaliste moderne est que les couts et les risques sont socialisés, pendant que les profits sont privatisés ». Noam Chomsky
Au-delà de cette affirmation de chomsky on peut penser que, d’une manière générale, le capitalisme privatise la production et socialise la reproduction :
La source de revenus financiers qui est reconnu comme ayant de la valeur c’est ce qui est produit. Par contre, les processus de reproduction/ restauration (éducation, santé, assurances sociales …) sont considérés comme des coûts qu’il faut minimiser si on ne peut pas les rentabiliser.
La valeur de la société capitaliste se mesure par sa capacité à produire (grandeur des outils de production, nombre de salarié)…, et de sa production (Bourse PIB, note obtenue au agences de notation..)
Par contre, ce qui sert à reproduire/restaurer, à recréer, a peu de valeur. Il est nécessaire d’en réduire et d’en socialiser les couts : les hôpitaux, le travail social, l’éducation, la police les structures de régulation ….
La limite de ce modèle
Le choix de privatiser les bénéfices et de socialiser les couts est un choix tenable économiquement tant qu’il y a des ressources dans lesquelles on peut puiser sans les épuiser.
Mais, au moment où il n’y a plus de ressources à épuiser, il devient nécessaire d’intégrer le cout de la reproduction dans la manière de comptabiliser la valeur d’un produit. C’est là-dessus qu’on bute en ce moment.
Dans l’idéologie capitaliste traditionnelle, on fait l’hypothèse qu’on peut tenter de rentabiliser ces activités de reproduction/restauration et en réduire les couts en appliquant à ces secteurs d’activité les règles de l’entreprise privée : c’est l’hôpital payé à l’acte ; C’est le chercheur universitaire à qui on demande de trouver les moyens de s’auto financer.
On a bien vu avec la privatisation de la santé comment ce modèle est une source de misère et de souffrance et surtout d’inefficacité. On l’a vu aussi les risques pour la santé publique et le renchérissement des couts que représente le choix de privatiser les transports (voir le métro de Londres) ou la gestion de l’eau pour laquelle de plus en plus de ville reviennent sur leur privatisation. Sans doute verra-t-on bientôt le même phénomène avec la privatisation de la production et la distribution de l’énergie.
L’économie circulaire : un début de réponse ?
Ce n’est sans doute pas par hasard que la notion d’économie circulaire surgit au moment où l’on atteint la limite de nos ressources.
L’émergence de l’économie circulaire est un premier pas vers une sortie de ce modèle productiviste.
Par exemple : tant que je peux exploiter le bois d’un forêt sans me préoccuper de son renouvellement, je peux mesurer la valeur du prix du bois au cout d’exploitation. Une fois qu’on a tout coupé ou que le prélèvement n’est plus rentable, on va exploiter une autre parcelle en attendant que « cela repousse ». Le cout de la reproduction est à la charge de la nature et n’a que peu de valeur. Il pèse sur la collectivité dans la mesure où il transforme les modes de vie de l’environnement direct, comme on a pu le voir avec l’exploitation de la truite du Nil autour du lac Victoria en Afrique. C’est aussi ce qui se passe avec l’exploitation de la mer. On pouvait jusqu’à aujourd’hui détruire un fond marin pour piller les bancs de poisson, ensuite s’en aller impunément et attendre quelques années que la nature fasse son œuvre de réparation avant de revenir l’exploiter de nouveau. Mais depuis que le rythme de production est supérieur à la capacité de restauration de la nature, cette stratégie n’est plus possible. Elle n’est tout simplement pas durable.
L’épuisement des ressources nous oblige à intégrer les couts systémiques, comme les couts de la pollution ou les couts de la reproduction, dans la valeur de la production. C’est ce qu’on a commencé à faire bien timidement avec la taxe carbone. Mais la taxe carbone n’est encore que le début d’une démarche d’intégration des couts systémique de la reproduction dans le cout de production.
Le modèle paysan de la rotation des cultures et de la pratique de la jachère peut nous aider à une réflexion sur la question de l’économie circulaire. Comment une production peut-elle créer les conditions d’une autre production qui ressource les effets de dégradation de la première production ? Par exemple la mono culture du maïs et du blé épuise la terre et favorise l’émergence de parasite. La jachère favorise le rééquilibrage du sol et la production du miel ou d’autres production qui régénèrent le sol.
Mais la pression des besoins de 9 milliards d’humains ne laisse pas de répit à la nature. Il ne s’agit plus de « laisser faire la nature » notre capacité de déprédation est devenue trop importante à cause de nos besoins et de nos moyens techniques. Il s’agit de trouver un modèle économique de production qui intègre notre puissance de déprédation au cout de la production.
La déforestation et le pillage des billes de bois centenaires en Afrique qui laissent une terre aride en est un exemple bien visible. Piller un bois qui ne se renouvellera pas avant deux ou trois cents ans pour faire des meubles de jardin à bas prix pour nos jardineries d’Europe, illustre bien ce problème de la séparation du cout de production et de la valeur de reproduction. Surtout que le pillage de la nature ailleurs, dévalorise nos forêts qui ne sont plus rentables par rapport à la concurrence déloyale du vol quasi légal du bois Africain.
De la même manière, le cout extraordinairement bas de l’exploitation du pétrole rend possible de produire à l’autre bout du monde et d’importer n’importe quoi à bas prix.
Que deviendrait le prix du transport aérien ou maritime si on intégrait dans le cout du carburant les effets sur l’environnement et le cout de la reproductibilité du pétrole ? Difficile à dire, mais en tout cas ce qui est sûr c’est que, vu les conséquences sur le prix du transport, on aurait gardé nos capacités de production proches de nous ! on aurait une économie de proximité florissante.
L’entreprise apprenante un précurseur de ce modèle ?
Cette question d’intégrer les couts de reproduction au cout de production commence à être une réalité dans les démarches d’entreprise apprenante : On s’est rendu compte que la complexité du monde et sa rapidité d’évolution nous obligeait à réintégrer la reproduction des compétences à la production. Il ne s’agit plus seulement pour les acteurs de l’entreprise de savoir produire il faut aussi savoir reproduire ses compétences à produire. Voire même à produire de nouvelles compétences.
La séparation artificielle entre la formation et le travail s’estompe dans une dynamique systémique complexe. On se rend compte qu’il ne suffit plus de valoriser la capacité à produire d’un acteur de l’entreprise, il faut aussi valoriser la capacité à reproduire, régénérer sa force de travail : d’où ce phénomène de mode des « soft skill » dans le recrutement et la formation. Le diplôme ne suffit plus à définir la capacité de travailler il faut aussi tenir compte des comportements d’adaptabilité que le candidat doit avoir et que la formation est supposée développer
Au fond, un modèle de travail émerge, encore mal structuré dans l’ubérisation ou le télé-travail. C’est une façon de travailler qui suppose l’autonomisation des acteurs, qui peut nous faire penser que pour certaines activités la distinction entre ce qu’on appelle traditionnellement « le travail » et le « hors travail » s’estompe et devient difficile à organiser et mesurer par d’autres personnes que l’acteur lui-même.
Ainsi, on ne sait plus quand « on travail » et quand « on ne travaille pas ». Et cette distinction n’est plus mesurable et on ne sait plus comment contrôler et valoriser financièrement cette façon de travailler. L’absence de modèle organisateur de cette nouvelle façon de travailler autorise à des dérives dans l’exploitation des travailleurs : Burn out de cadres, exploitation des acteurs Ubérisés….
Avec un peu de recul on peut constater que cette séparation artificielle entre la production et la reproduction à des fins de mesure et de valorisation financière est relativement récente dans l’histoire du monde. C’est l’avènement du capitalisme financier qui a rendu possible et nécessaire cette séparation. Dans la France agricole à 95% jusqu’au 20 ième siècle chacun avait sa petite entreprise dans laquelle chaque famille faisait beaucoup d’autres choses que de travailler la terre. Une pratique agricole ou l’on ne pouvait pas distinguer facilement le temps du travail et les temps de non-travail. Les échanges majoritairement informels, la diversité peu identifiée des activités de chacun rendait impossible toute mesure de l’activité tout « pesage » de l’emploi ou de l’activité.
Changer le code source du capitalisme
La généreuse idée des 35 heures c’est fracassée contre cette incapacité à changer le code source de notre mode de production. Que seraient devenu les 35 H si le cout du travail ne se mesurait plus seulement à la valeur de la production mais intégrait le cout de la reproduction. On aurait peut-être un PIB moindre, mais surement un plus grand nombre de personnes formées, adaptables, capables d’évolution et pouvant contribuer plus efficacement à changer la société.
Sans porter de jugement sur la valeur d’un modèle ou d’un autre, on peut constater que tenir compte de la valeur complexe des dynamiques du vivant, impose d’intégrer la reproductibilité dans la valorisation de la production.
Une des principales transformations du code source du capitalisme post covid serait de chercher à intégrer la valeur de la reproduction dans le cout de la production.



