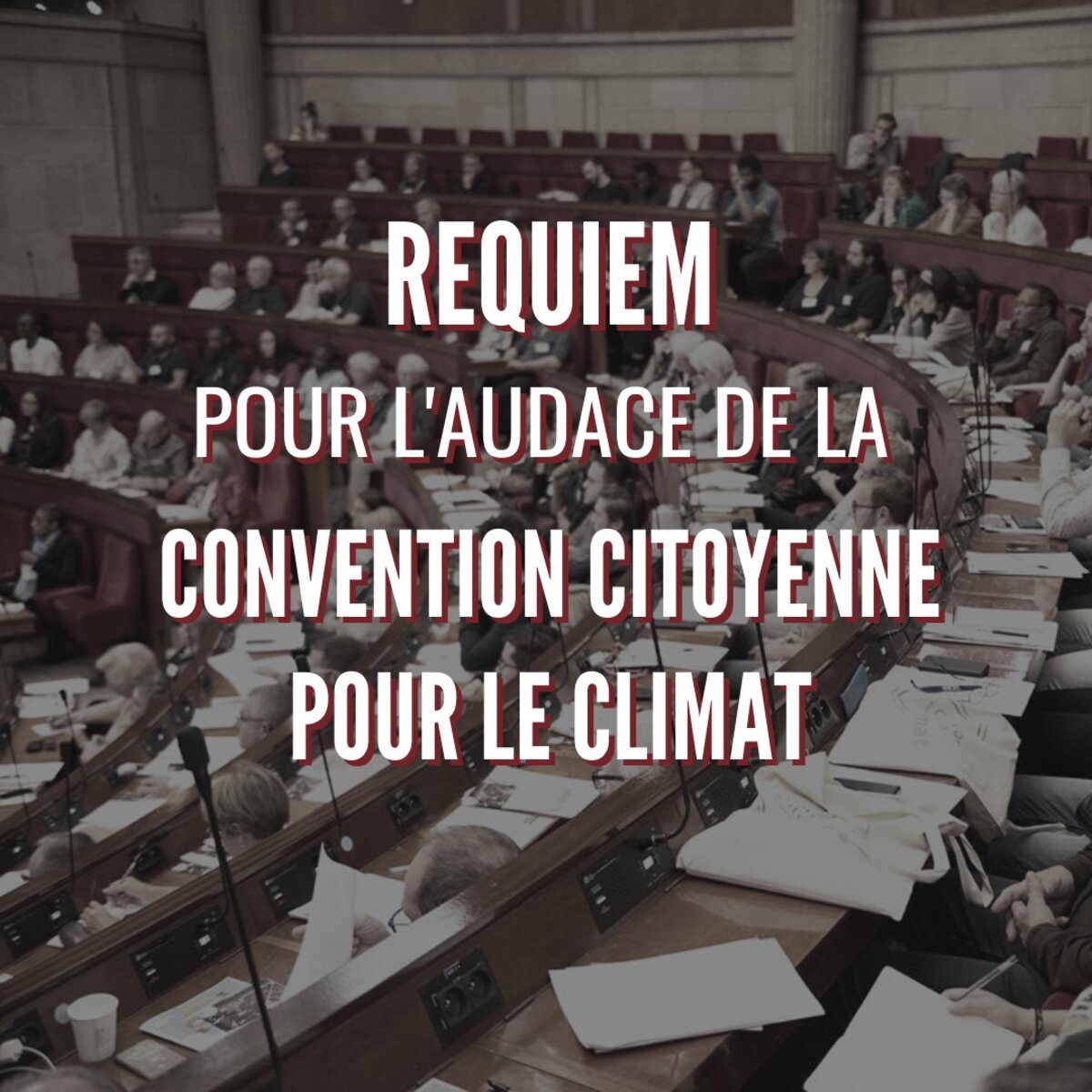
Agrandissement : Illustration 1
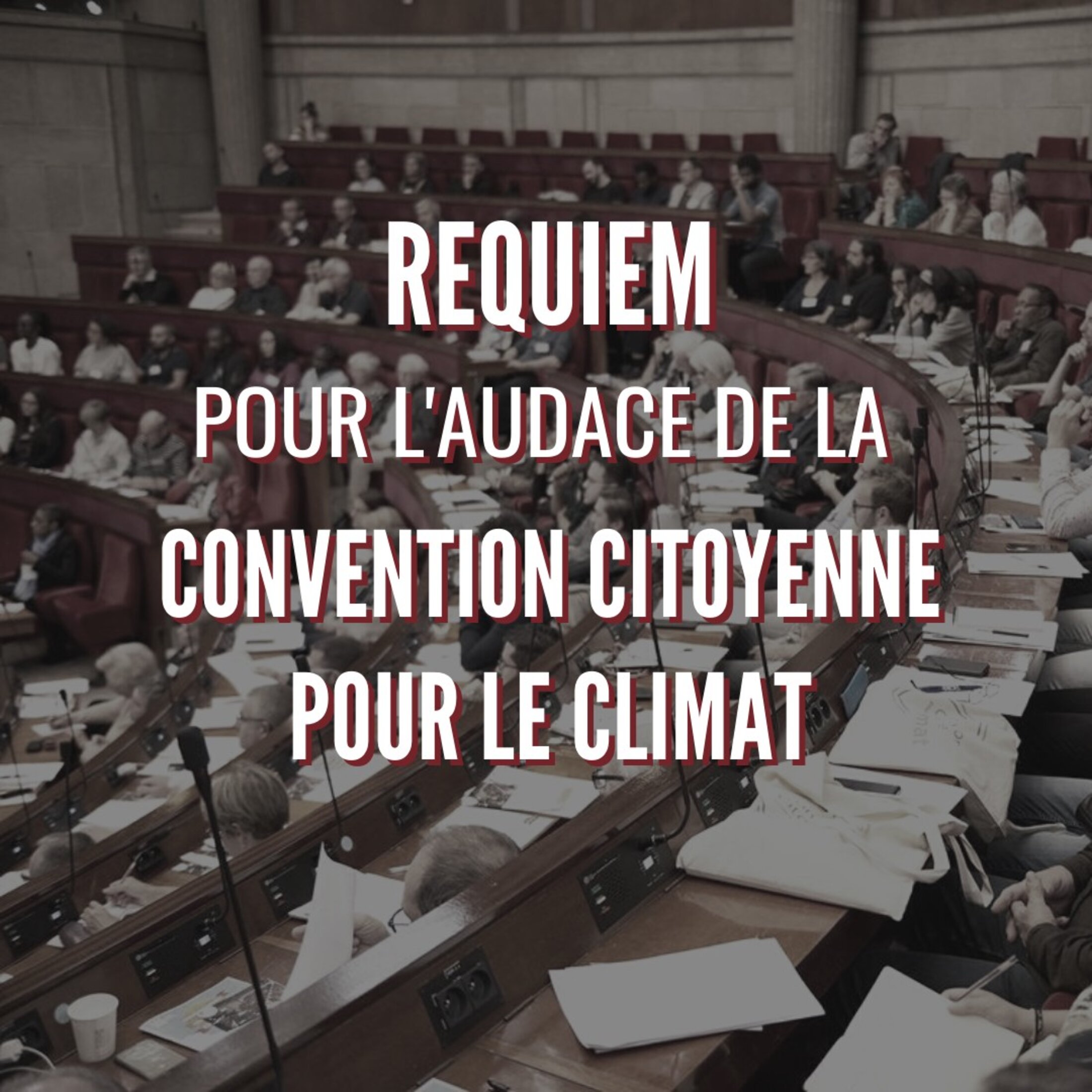
Requiem pour l'audace de la Convention Citoyenne pour le Climat
I - Récit d'une séance d'anthologie à la Convention Citoyenne pour le Climat (1)
(ce qui suit est une retranscription des débats lors d'une séance de la CCC ; pour lire notre analyse sur le sujet, vous pouvez directement passer à la deuxième partie)
Il est un peu plus de onze heures, ce samedi 20 juin 2020. L'ambiance est électrique à la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC). Sylvie vient de présenter la proposition (PT5) du groupe « Produire et travailler » : réduire le temps de travail de 20% et revaloriser le SMIC de 20% d'ici 2030. Les réactions pleuvent.
Salle 79.
- Mélanie est contre. En sortie de crise sanitaire on ne peut imposer ça aux entreprises, et puis il y a un risque d'effet rebond : les gens partiront en week-end, prendront quand même leur voiture, iront faire les magasins et consommer des produits importés de Chine. Il faudrait une Convention Citoyenne sur le Travail.
Salle 225.
- Yolande est pour. Si on baisse le temps de travail les émissions de gaz à effet de serre (GES) baisseront aussi. On aura plus de temps pour s'engager dans nos vies, pour aller cueillir des orties et ramasser des chataîgnes, entretenir les espaces verts. On aura pas forcément plus de salaire pour aller consommer.
- Réponse cinglante d'une autre participante : ce que vous nous avez présenté est valable pour un monde idéal et nous en sommes loin. Je pense que la réduction du temps de travail va engendrer délocalisations et fermetures d'entreprises. J'estime que ce serait une catastrophe pour notre pays.
- Puis un homme argue que les petits artisans rechignent à recruter en France car le coût du travail est trop important. La France n'est pas assez compétitive pour permettre cela.
Salle 301.
Le facilitateur avertit : on a déjà dépassé le temps.
- Une jeune femme invoque ses proches qui sont passés aux 35 heures dans la douleur. Les gens bougeront quand même et donc pollueront. Les citoyen·nes de la Convention passeront pour des guignols auprès de la France avec une telle proposition. Applaudissements.
- un autre homme est contre : cela risque d'augmenter le prix de production de 20%. Baguette de pain à 1,50€, pétrole à 1,70€, augmentation des taxes. Et puis la santé : 28 heures dans les centres hospitaliers ? il prédit une catastrophe monumentale.
Salle Eiffel.
- Une facilitatrice demande de ne pas répéter ce qui a déjà été dit.
- Pour Lionel les 28 heures c'est hors mandat par rapport aux objectifs de réduction des GES. C'est un affront fait aux agriculteurs qui travaillent déjà beaucoup et peinent à vivre.
- Amandine pense que cette mesure n'aura pas réellement d'impact sur l'objectif de réduction des GES.
Le facilitateur exhorte les citoyens à faire bref.
- Hubert dit que leurs propositions vont créer des emplois en masse, que le chômage sera une vieille histoire, et donc qu'il n'y aura pas besoin de partager le travail.
- Pierre assène : ce n'est pas les droits humains et sociaux qu'on doit adapter à l'économie, c'est l'économie qu'on doit adapter aux droits humains et sociaux. La réduction du temps de travail est une bonne mesure. Il met en avant les gains de productivités réalisés : on travaille moins pour produire autant. Pierre commence à être coupé par le facilitateur. Il déplore qu'on réduise brutalement le temps de travail alors qu'on aurait déjà dû le faire un petit peu chaque année. Il enchaîne sur le fait que pendant ces années le patronat s'est gavé : il n'a pas redistribué les gains de productivité en salaire ou en réduction du temps de travail. Le dangeureux communiste est encore coupé par les facilitateurs. Il essaye de continuer. Mais leurs réprimandes couvrent les propos de Pierre, qui ne peut terminer. La caméra se détourne de lui.
Sur "Zoom".
- Guy explique que cette réduction aura une incidence sur les salaires, et donc sur la protection en général : comment financer le chômage, la maladie, les retraites et la dépendance ?
Hémicycle.
Cafouillage dans la répartition de la parole. On entend la douce voix de Cyril entre celle de deux citoyen·nes.
- Mélanie estime que cette proposition est totalement déconnectée de la réalité. Indéfendable dans le contexte actuel, car en ce moment les Français eux se demandent juste s'ils auront encore leur emploi à la rentrée.
- Un énigmatique monsieur glisse que M. Macron essaye actuellement de relocaliser des entreprises en France, et que ce n'est donc pas le moment de réduire le temps de travail.
Le facilitateur continue à perdre du temps pour dire qu'on perd du temps.
- Une participante s'insurge contre l'erreur monumentale de ses concitoyen·nes. La réduction du temps de travail sera centrale dans les prochaines années. La France a la plus grosse productivité. Quand on sera à 12% de chômage il faudra partager le travail. Elle cite Bruno Le Maire : le travail pour tous. En plus, la révolution numérique supprime des emplois, et puis il faut réduire la croissance si on veut réduire les GES, et aussi on va libérer les gens pour avoir des projets de société dans des associations. Elle apporte son soutien à la personne qui a porté le projet.
- Une autre explique qu'au début elle était totalement contre cette proposition : ils sont complètement tarés s'était-elle dit. Puis après avoir réfléchi à la démocratie malade, au manque de temps des gens pour s'intéresser à la démocratie, elle est convaincue qu'il faut accorder des heures à la démocratie, au bénévolat sur l'environnement et la solidarité humaine. Cette mesure c'est à partir de 2030 donc il ne faut pas s'affoler. Le Français a toujours peur, mais il faut accepter qu'on change de société. Et puis elle a confiance dans les parlementaires qui adapteront cette mesure en fonction des secteurs et des postes.
Le facilitateur perd toujours du temps pour dire qu'on en a plus.
- Sylvie (celle du début) à la tribune argue qu'il faut se projeter, c'est dans dix ans ! Elle rappelle que le temps partiel choisi est bénéfique aux travailleurs, mais que le temps partiel subi (travailleurs peu qualifiés, emplois du temps saucissonnés) est mauvais pour la justice sociale.
- Agny met en garde ses concitoyen·nes. Ce n'est pas à elles et eux de décider si les mesures proposées donnent une mauvaise image de la Convention. Mélanie qui a gardé le micro allumé, dans une autre salle, la coupe (on a le droit de donner notre avis !). Il y a de la tension, le débat dure depuis 30 minutes. Puis elle invoque les économistes (Jean Gadrey) qui ont réfléchi à ça, les pays et entreprises qui s'y sont mis. Le modèle et le système ne nous conviennent pas, il faut aller plus loin. Alors osons. On propose de transformer les emplois, de créer de nouveaux emplois écologiques, donc on peut désintensifier le travail. Réduire le chômage coûte 70 milliards d'euros par an, partager le travail ce serait économiser 2 à 3% du PIB. Il faut savoir aller jusqu'au bout. Tonnerre d'applaudissements des pro-28 heures.
Cyril dit qu'il y a des prises de parole demandées depuis longtemps. Re-cafouillage du côté des facilitateurs.
Salle 79.
- Nicolas parle des médias qui ont dit hier que leurs propositions étaient dignes d'un régime totalitaire. Risque que les citoyen·nes se fassent lyncher.
Salle Eiffel.
- Marie-Hélène affirme qu'avec la crise actuelle c'est pas possible. Et puis ça fait 44 ans qu'elle fait 50 heures par semaine, elle toujours élevé deux enfants seule et a toujours fait du bénévolat à côté. « De toute façon les 28h ce sera encore pour les mêmes. Et c'est toujours les mêmes qui travaillent moins, et c'est toujours les mêmes qui travaillent plus, et pour des salaires minables. » Applaudissement nourris.
On a perdu trop de temps on doit passer au vote, gronde le facilitateur.
Salle 301.
- Eloïse ne dit pas de voter pour ou contre. On nous a demandé d'être ambitieux et de pas avoir peur, et ce qu'en j'entends c'est la peur, la peur des médias, la peur du lynchage et ça ça m'fait mal. On est dans une urgence climatique, je le répète, on est là pour se battre, on est dans une urgence. Cette mesure est là parce qu'on remet en cause notre modèle de société, on remet en cause tout. C'est cette idée là qui va ressortir de la convention : on a besoin d'une remise en cause de notre société, alors maintenant soyez ambitieux et votons. Applaudissements, on entend des bravooooooos.
Hémicycle.
-Un homme salue la mesure mais rappelle la menace qu'elle représente pour la société. Agny lui réplique - sans respecter les tours de parole - et invoque Larrouturou. On la coupe.
- Armelle n'est ni contre l'un ni contre l'autre. On veut une société qui change, et donc une société qui arrête d'avoir des heures fixes. Il y a des secteurs où on a besoin de réduire le temps de travail, et d'autres non. Il faut une société qui s'adapte.
Fin du débat. Le facilitateur remercie pour les riches et passionnants échanges désormais clos. Le scrutin est ouvert. Une blague est glissée, on entend des rires. Les soucis de connexion prolongent le suspense. Le vote est sans appel. 91 citoyen.nes ont voté contre, 49 pour. La proposition est rejetée. Applaudissements.
II - Rendez-nous le débat sur le temps de travail
Vous regarder débattre est autrement plus captivant que de regarder les simagrées des député·es sur LCP. Nombre d'entre vous se souciaient du discrédit que cette proposition des 28 heures aurait jeté sur votre travail. Ce débat sur les 28 heures ne vous a pas discrédité, comme le craignaient quelques-un·es d'entre vous. Bien au contraire, qu'apparaisse dans vos propositions l'ébauche d'une remise en question du travail, bien qu'encore insuffisante, soufflait une promesse de radicalité. Nous ne sommes pas les seul·es fous et folles à affirmer qu'il faut travailler moins, ou plus du tout, il y en a au moins 49 autres.
Des institutions comme le Center for Economic and Policy Research cherchent à démontrer la corrélation indéniable entre temps de travail et émission de GES (2). Le think tank britannique Autonomy décrit la semaine de 9 heures comme une solution incontournable pour le respect des accords de Paris (3), etc. Les économistes fournissent donc nombre d'arguments d'autorité à ce sujet, cependant avons-nous réellement besoin de les multiplier pour saisir la logique désarmante de cette affirmation : puisque la production pollue, il faut moins produire, c'est-à-dire moins travailler.
Écologie et emploi du temps sont liés. Dans un futur écologique, on aura éliminé les productions superflues ou considérées néfastes, ainsi que leurs emballages commerciaux, après avoir collectivement redéfini nos besoins. Ainsi disparaitront les services marketing et publicité qui cherchent à enfermer l'individu dans son rôle de consommateur. La production de voitures ou de smartphones diminuera par substitution d'outils plus propres (vélo plutôt que voiture), mise en commun, et prolongation de leur durée de vie. Un grand nombre de travailleur·ses seront ainsi libéré·es de tâches désormais superflues. Ce temps gagné, trop souvent considéré comme « emplois supprimés », n'aura pas paupérisé celleux qui les exerçaient, au contraire. Des tâches nécessaires, rendues parfois plus difficiles car moins mécanisées, sont assurées par un plus grand nombre de personnes, qui toutes travaillent moins qu'avant. La production agricole impliquera beaucoup plus de personnes qu'actuellement, comme l'exigent le partage de la pénibilité des tâches et les méthodes paysannes qui prennent soin des milieux vivants. Le temps gagné est en parti reconverti dans des tâches restées nécessaires à la communauté (désherber les carottes, balayer la rue ou pédaler pour faire tourner la machine à laver). Mais la disparition du salariat, de la spécialisation forcée, des contraintes psychologiques et juridiques, font dorénavant du travail un objet d'émancipation collective et individuelle, et non plus d'asservissement.
Nous libérer du travail, et même si cela devait passer par un acte réformiste et progressif d'une lente réduction du temps de travail, n'est finalement pas seulement une question comptable : pour x heures chômées, y émissions évitées. Plus encore, c'est la possibilité de redéfinir notre rapport au monde, à l'existant et aux temporalités économiques qui lui sont assignées. André Gorz a notamment dit : « En réduisant leur temps de travail, il risquait surtout d’échapper à l’emprise de la rationalité économique découvrant que plus ne vaut pas nécessairement plus, que gagner et consommer plus ne signifie pas nécessairement vivre mieux, donc qu’il peut y avoir des revendications plus importantes que les revendications salariales. » (4). Qu'il est bon de nous imaginer dépris du temps capitaliste : notre quotidien ne sera plus sous son emprise. Finies les injonctions à voyager vite, dormir peu, faire beaucoup, ne pas perdre de temps. Nous avons plus de temps, et pouvons donc nous permettre d'aller plus lentement. Les voyages durent des mois et non plus des semaines.
Un avenir écologique n'exige pas la création de millions d'emplois verts, car ce n'est pas un « plein-emploi » qui aura raison du chômage. Un avenir écologique, ne s'inquiète pas des mots de l'économie : PIB, chômage, croissance, emploi. Il rompt avec les dogmes, les croyances économicistes qui modèlent notre rapport au monde. Il propose des milliers d'expérimentations, de manières de se relier, de faire ensemble, d'appréhender les milieux vivants et d'en faire émerger de quoi vivre. Un avenir écologique propose du temps, et ce temps, il faudra d'abord le reprendre à l'économie.
(1) A retrouver en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=NREkrPQUiwM&feature=youtu.be&list=TLPQMjEwNjIwMjDWLkSDJtVd5Q&t=6497



