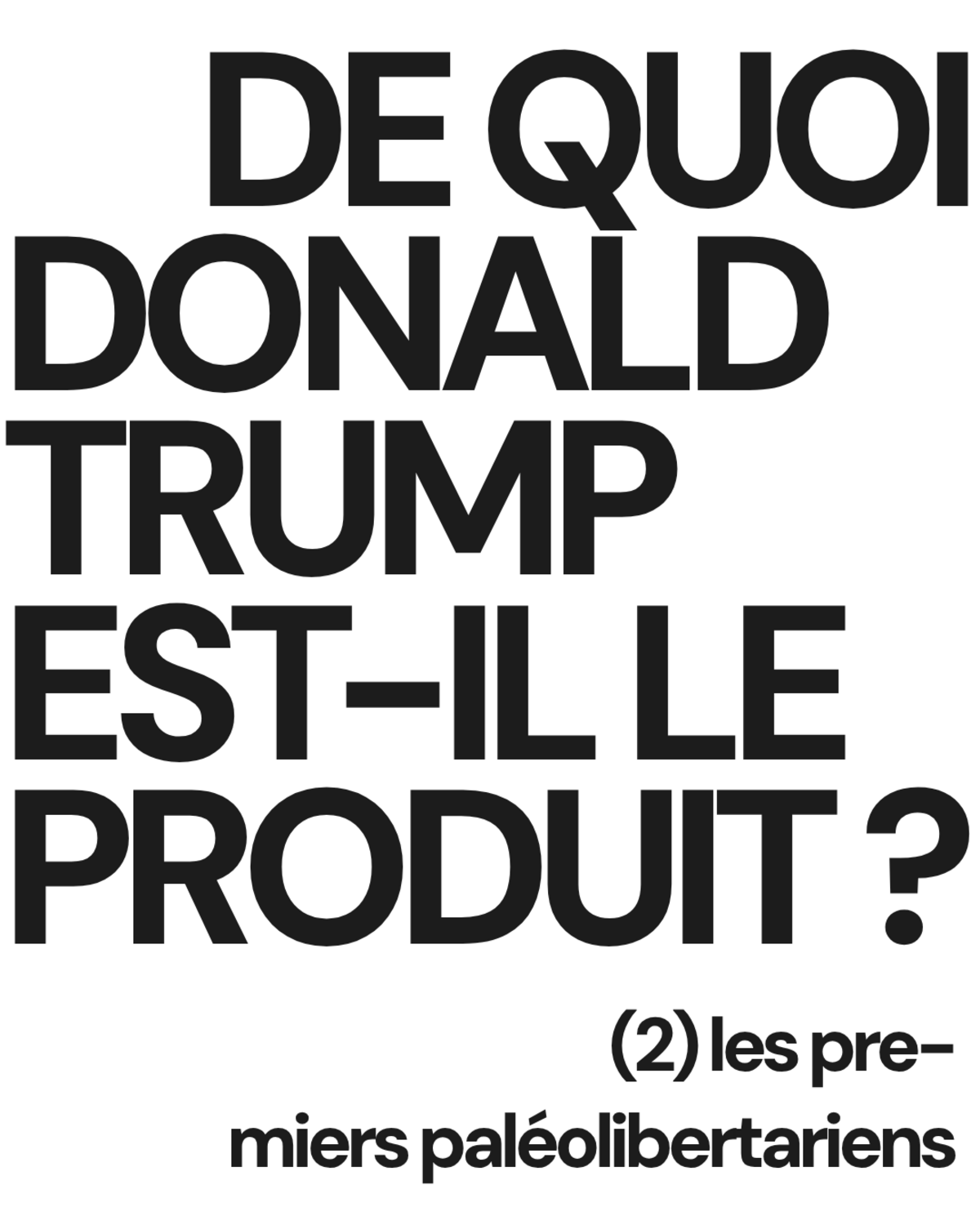
Agrandissement : Illustration 1
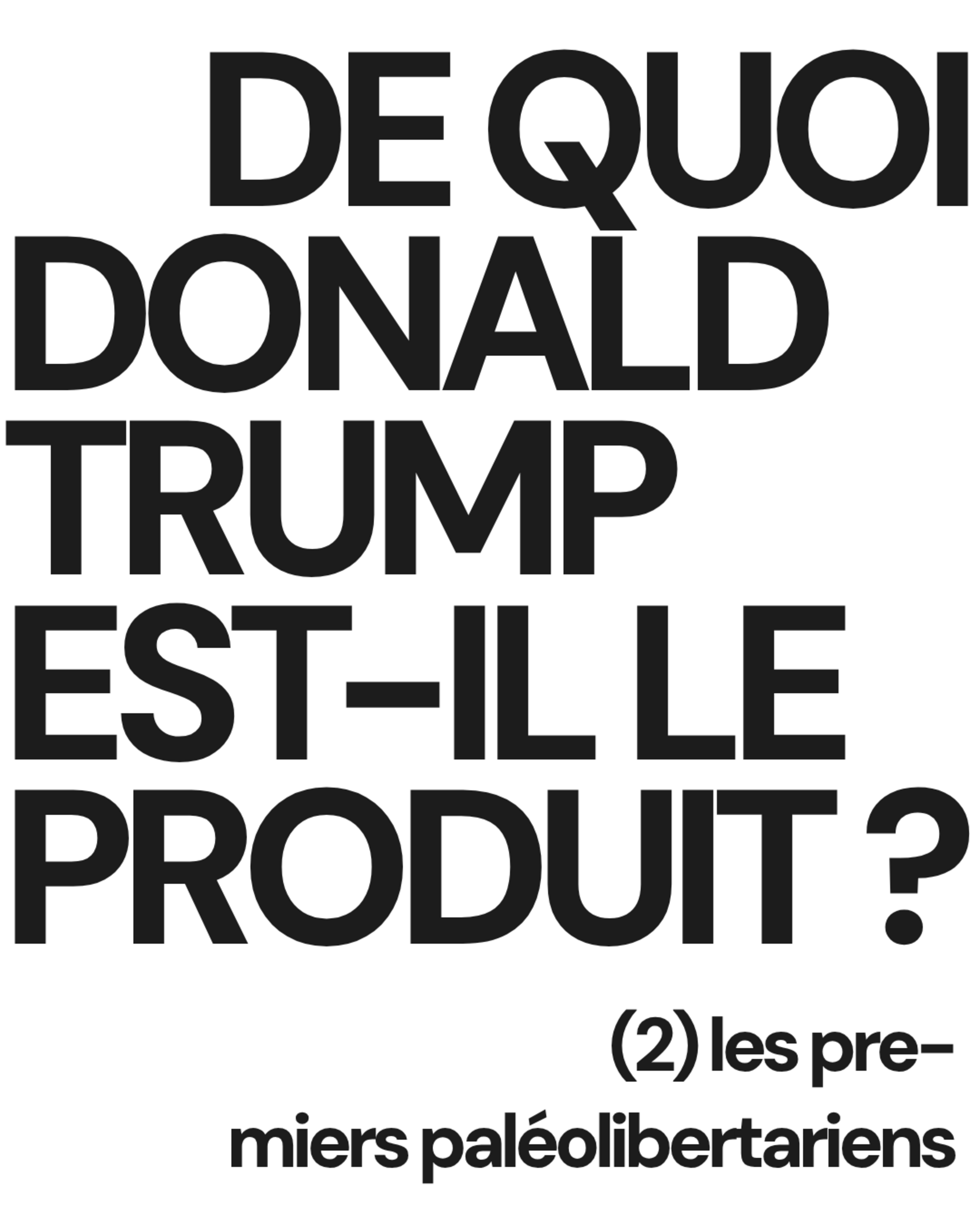
LUDWIG VON MISES
La littérature sur le néolibéralisme présente souvent les pères fondateurs du mouvement comme des libéraux, tant sur le plan politique qu'économique. Leur souci premier aurait été de s'opposer à la montée des totalitarismes, qu'il s'agisse du nazisme, du fascisme ou du stalinisme. Pourtant, un examen plus approfondi des débuts du mouvement montre que ses représentants autrichiens - Ludwig von Mises et son protégé Friedrich Hayek en particulier - étaient avant tout préoccupés par le déclin des empires, dans le sillage de la Première Guerre mondiale, et par la montée en puissance du socialisme, y compris sa variante sociale-démocrate.
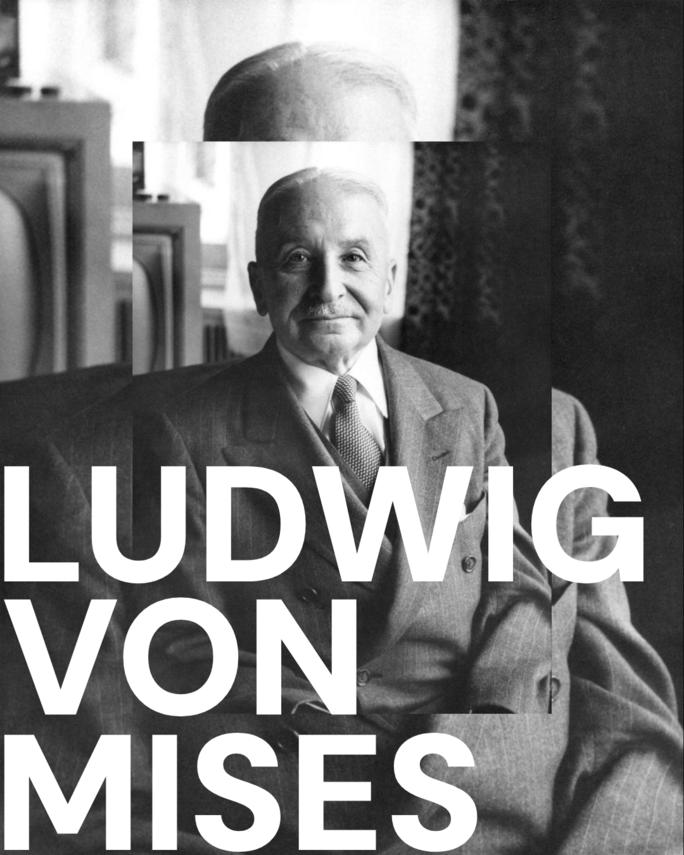
Agrandissement : Illustration 2
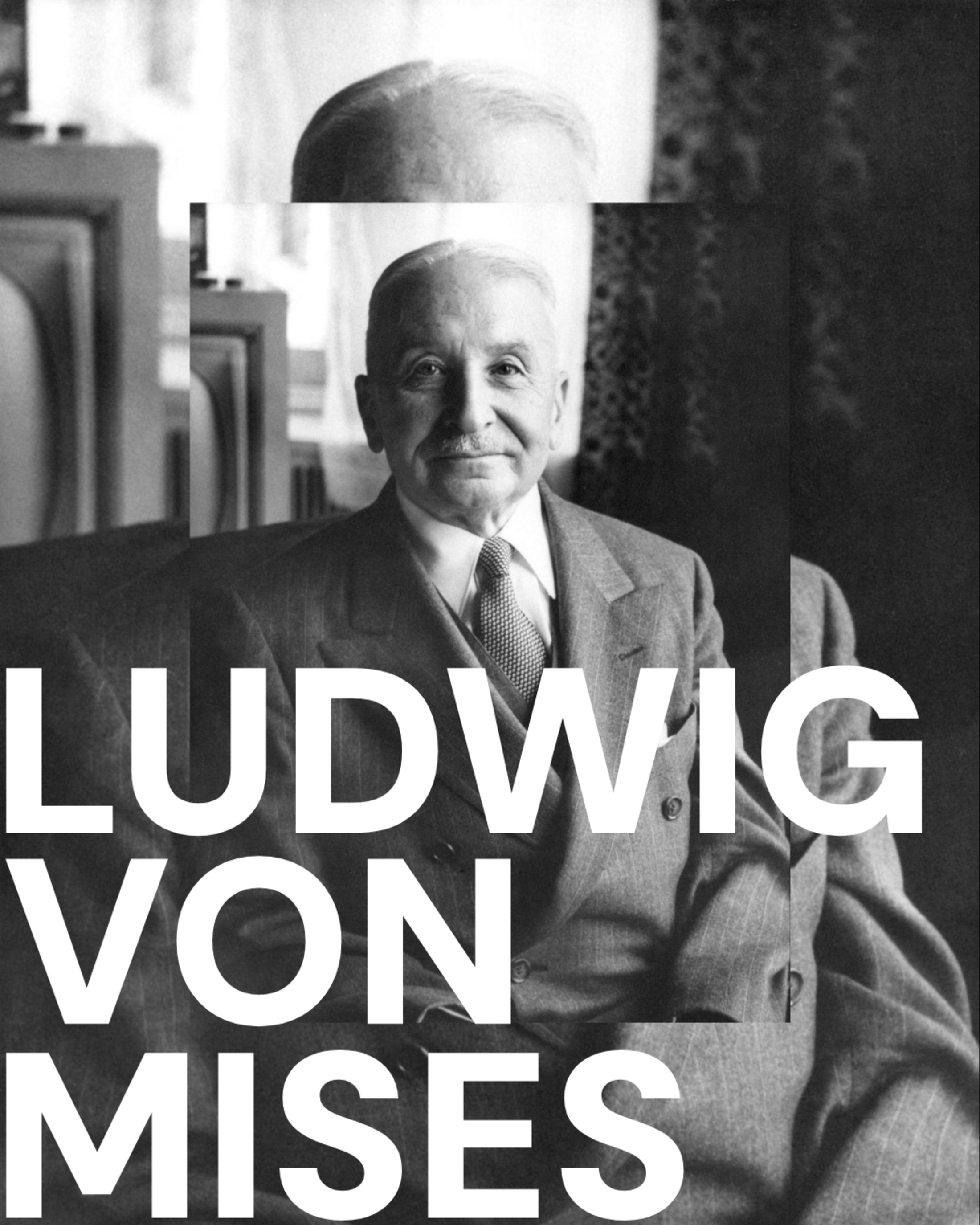
Né à Lemberg (aujourd'hui Lviv) en 1881, Ludwig von Mises s'est fait connaître dans les rangs de l'École autrichienne d'économie en menant la charge contre le socialisme. Développant un long article écrit en 1920, son livre Socialism : An Economic and Sociological Analysis, publié deux ans plus tard, a lancé ce que l'on a appelé le “débat sur le calcul économique en régime socialiste”, qui opposait les défenseurs du libre marché comme Mises lui-même, Hayek ou encore Max Weber, aux partisans de la “planification rationnelle socialiste” tels que Otto Neurath.
Mises soutenait que seul le marché peut rendre compte de la complexité et de l'hétérogénéité des désirs individuels, et donc optimiser leur satisfaction. Les relations marchandes, expliquait-il, sont capables de traduire les préférences subjectives en utilités comparables parce qu'elles seules reposent sur cet instrument magique qu'est le mécanisme des prix. Selon les économistes autrichiens en effet, les prix sont des signaux informant les membres d'une société de ce que les autres veulent et de ce qu'ils ont à offrir. Dans la mesure où ils ne sont pas faussés, ils permettent donc aux acteurs du marché d'élaborer leurs propres plans librement et efficacement.
En revanche, selon Mises, les planificateurs ne peuvent formuler que des hypothèses grossières sur les besoins des citoyens qu'ils gouvernent. Incapables de discerner les aspirations et les aptitudes spécifiques de chacun, leurs calculs sont voués à produire des résultats médiocres et à engendrer un mécontentement généralisé au sein de la population. La force de la rhétorique de Socialism réside dans son appel à la rationalité : quoi que l'on pense des intentions et des valeurs des socialistes, le livre affirme que leur projet est voué à l'échec puisque le mécanisme des prix n'y a aucune place. Selon les propres termes de Mises, le programme socialiste conduit à “l'abolition de l'économie rationnelle1”.
Si sa critique a ancré un défi au long cours pour la gauche, Mises s'est un peu laissé emporter par ce qu'il considérait comme sa victoire définitive dans le débat sur le calcul. Contrairement à Hayek, qui l’avait suivi dans son attaque contre la planification, il ne s'est pas contenté de défendre les thèses qui allaient devenir la doctrine néolibérale standard, comme la réaffectation du rôle de l'État ou la critique de la notion de justice sociale. D'une part, la confiance de Mises dans le pouvoir immanent des prix était telle qu'au lieu de se contenter d'appeler l'État à protéger les mécanismes du marché contre les revendications démocratiques, il s'est rallié sans réserve au souhait libertarien de se débarrasser complètement de l'État. D'autre part, loin de se contenter de mettre en garde contre les effets pervers des politiques publiques égalitaires, il proclame que l'égalité elle-même est une notion fallacieuse : “Tout le pouvoir humain serait insuffisant pour rendre les hommes réellement égaux”, écrit-il dans son livre Liberalism, publié en 1927. “Les hommes sont et resteront toujours inégaux”.
Mises a avant tout formulé son opposition de principe à l'égalité en invoquant la méritocratie : tous les individus n’ont pas la chance d’être dotés des mêmes capacités, et contraindre ceux qui en ont le plus porterait préjudice à tout le monde. Cependant, comme le montre Quinn Slobodian dans Hayek’s Bastards, il était ouvert à la possibilité que les inégalités soient innées - “on peut supposer que les races diffèrent en termes d'intelligence et de volonté” -, mais aussi enclin à croire que les gens préféreraient n’évoluer qu’au sein de leur propre groupe ethnique - “il y a peu d'hommes blancs qui ne frémiraient pas à l'idée de millions de Noirs ou de Jaunes vivant dans leur propre pays” - et certainement assez libertarien pour les laisser opter pour la ségrégation sur la base qu'ils jugeraient la plus appropriée. Aussi est-ce pour de bonnes raisons que les paléolibertariens aux penchants suprémacistes ont élu domicile à l'Institut Mises.
1Voir William Callison, The Politics of Rationality in Early Neoliberalism: Max Weber, Ludwig von Mises, and the Socialist Calculation Debate” in JHI (83.2)
MURRAY ROTHBARD
Murray Rothbard (1926-1995) fut et demeure une figure intellectuelle centrale du mouvement libertarien aux États-Unis. Fondé sur le droit inaliénable des individus à posséder des biens, à en disposer comme ils l'entendent et à se libérer de toute obligation à laquelle ils ne sont pas contractuellement liés - sauf celle de ne pas porter atteinte aux droits de propriété d'autrui -, son libertarianisme a été inébranlable tout au long de sa vie. Sa fidélité envers cette conception maximaliste de la liberté individuelle l’a rendu hostile à toute forme d'intervention de l'État, que ce soit au nom de la justice sociale, de l'efficacité économique ou même de la sécurité nationale. Où il a fait preuve de plus de flexibilité, en revanche, c’est dans les choix stratégiques qu'il a adoptés pour faire avancer sa cause.

Agrandissement : Illustration 3
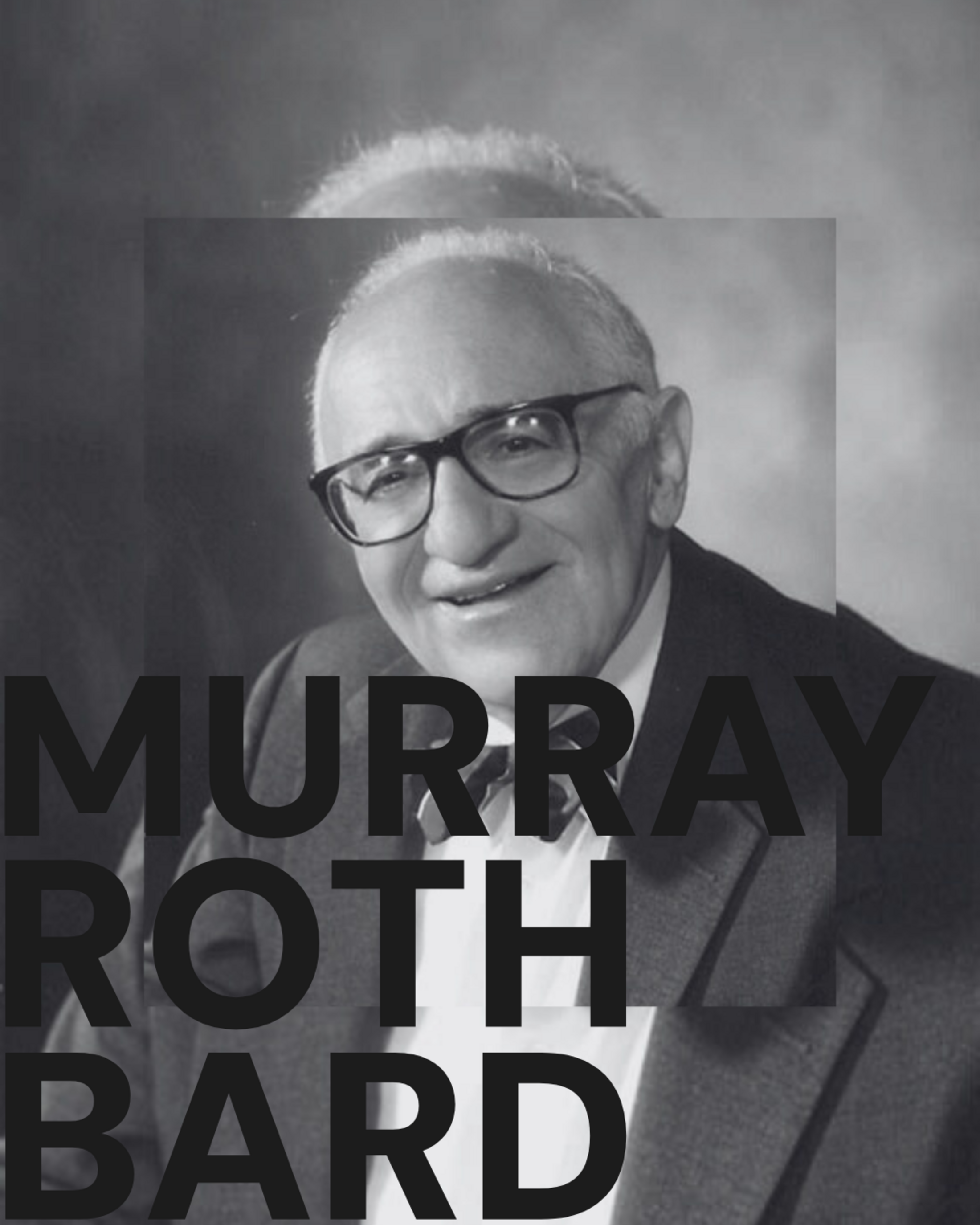
Élevé à New York par des parents juifs émigrés, Rothbard commence par gager le progrès de ses idées sur une Old Right déjà en perte de vitesse. Étudiant en économie à l'université de Columbia, il va même jusqu’à soutenir la candidature du sénateur ségrégationniste Storm Thurmond lors de la course présidentielle de 1948. Après avoir découvert l'École autrichienne d'économie et fait de Ludwig Von Mises son mentor, il a bénéficié du patronage du très conservateur Volker Fund, a écrit occasionnellement pour la National Review, et a rejoint la Société du Mont-Pèlerin dans les années 1950.
Cependant, Rothbard se sent bientôt de plus en plus mal à l'aise avec la droite fusionniste de William Buckley. Malgré son anticommunisme farouche, le soutien des conservateurs à l'impérialisme américain tout au long de la Guerre froide, et en particulier pendant la guerre du Viêt Nam, va à l'encontre de son pacifisme libertarien. Défendre la nation contre des ennemis extérieurs, soutient-il, est somme toute la manière dont l'État justifie son pouvoir despotique. D'où le bref flirt de Rothbard avec la Nouvelle Gauche anti-guerre à la fin des années 1960. Ayant forgé le concept d’anarcho-capitalisme, il nourrit l'espoir que les anarchistes de tous bords pourront s'unir contre le Big Government et tente même de défendre cet argument dans le magazine de gauche radicale Ramparts.
Rapidement désenchanté par l'idée d'un front anarchiste unifié, Rothbard décide de rejoindre les cercles néolibéraux, avec lesquels il a plus d’affinités, ce qui lui permettra de cofonder le Cato Institute au début des années 1970, avec l'aide financière de Charles Koch. Mais là encore, il est rapidement déçu quand il voit que l'aile hayékienne de l'institut se détourne du libertarianisme et se donne pour vocation de devenir un groupe de réflexion pour l'administration Reagan et le Parti républicain.
À la recherche d'un nouveau foyer, Rothbard le trouve à Auburn, en Alabama, où il crée, avec Lew Rockwell, le Mises Institute en 1982. Rockwell est à la fois un libertarien convaincu comme Rothbard et un fervent partisan de la ségrégation raciale, non certes en tant que politique d’état mais sur la base du volontariat. Les communautés devraient en effet être libres de choisir avec qui elles veulent cohabiter, soutient Rockwell. Or, si elles étaient en mesure d’exercer cette liberté, nul doute qu’elles choisiraient de s'entourer des membres de leur propre race. Rothbard, qui avait retenu la suggestion de son mentor Mises selon laquelle, nonobstant le nazisme, la théorie de la race pouvait contenir une part de vérité, s'empresse d'adopter le point de vue de son nouvel ami. Une société libertarienne, affirme-t-il désormais, exige des personnes culturellement et même naturellement disposées à comprendre et à apprécier les valeurs libertariennes. En revanche, une société exempte de ségrégation, et qui s’emploie en outre à proclamer l'égalité des races et des sexes, se condamne à produire une “sous-classe parasitaire” et un État nounou de plus en plus totalitaire pour répondre aux besoins de celle-ci.
Néanmoins, ce que Rothbard et Rockwell appellent maintenant le paléo-libertarianisme a besoin d'alliés pour prospérer. C’est dans l'autre camp paléo qu’ils vont alors les chercher, à savoir dans la coterie paléo-conservatrice, créée en réaction à la montée en puissance des néoconservateurs au sein du parti républicain. Les deux groupes se rencontrent à Dallas en 1990 et forment rapidement un club - le John Randolph Club, nommé, comme le raconte Quinn Slobodian, “d'après un esclavagiste dont la phrase fétiche était : “J'aime la liberté, je déteste l'égalité””. Lors de la campagne présidentielle de 1992, la paléo-alliance soutient la candidature de Pat Buchanan, qui veut tout à la fois abroger les lois sur les droits civiques des années 1960, les programmes sociaux du New Deal et l'interventionnisme impérial des États-Unis. Buchanan ne réussit pas à obtenir l'investiture républicaine et, quelques années plus tard, Rothbard lui tourne à son tour le dos. À lui et à sa cohorte de paléo-conservateurs, dont le protectionnisme, selon lui, “se transformait en une foi totale dans la planification économique et l'État-nation”.
Une fois de plus marginalisé, Rothbard n'a pas vécu assez longtemps pour assister à la renaissance de son credo paléo-libertarien. Sa mémoire perdure cependant parmi ses admirateurs de la Silicon Valley, mais aussi grâce à Javier Milei, le Président argentin, qui a donné le nom de Rothbard à son chien cloné préféré.
Pour en savoir plus, regardez en libre accès notre entretien vidéo avec Quinn Slobodian, historien du libéralisme et en particulier le chapitre 2 : "Le blues des néolibéraux à la fin de la Guerre froide".


