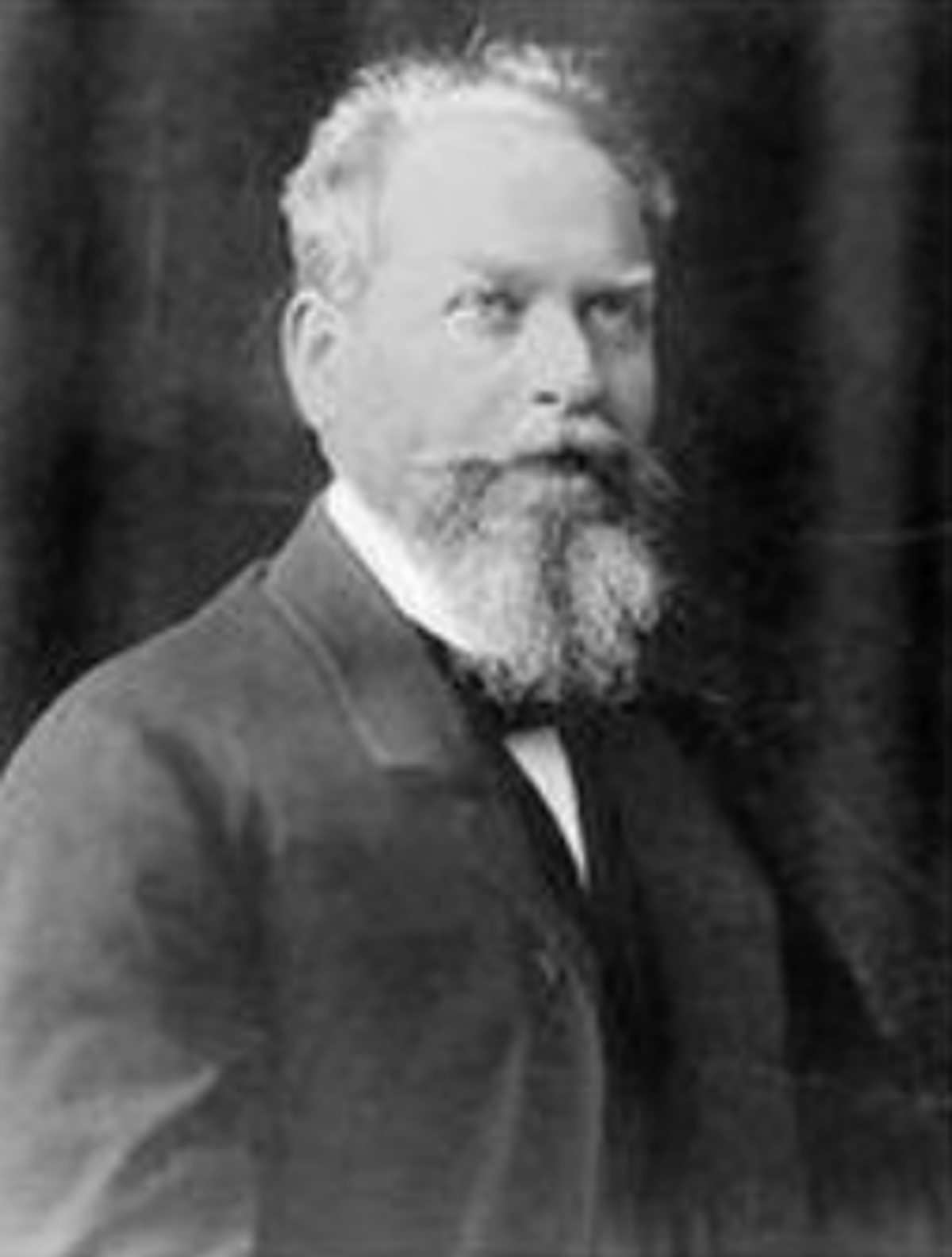
Husserl
Husserl est le père de la doctrine “phénoménologique” qui définit un sujet qualifié précisément de “transcendantal et phénoménologique”. De quoi s’agit-il ? Rien de plus et rien de moins qu’un retour au sujet défini comme “conscience”, au fond un retour à un certain “cogito” cartésien. Pour Husserl, le “cogito” reposait sur un principe excellent, celui de l’expérience du “doute” ou ce qu’il appelle lui-même la “réduction”. Je doute de tout, sauf du fait que je pense, disait Descartes ; j’évacue le monde et j’évacue aussi mon moi humain et ma vie psychique, pour ne garder que le sujet capable de décrire ces derniers, ajoute Husserl, radicalisant ainsi le geste de Descartes. Le reste de l’opération, c’est ce sujet pur “transcendantal” (et phénoménologique” dans la mesure où il se contente d’appréhender les “phénomènes”, les choses telles qu’elles se présentent) : non une forme a priori comme chez Kant, non le moi avec toutes ses pensées et ses sentiments, mais cette tension de tout mon être qui en vérité est conscience pure, pur “vécu” saisissant le monde et permettant après coup (mais seulement après coup) de l’objectiviser c’est-à-dire d’en faire un objet de connaissance. Il faut dire qu’à travers les phénomènes, ce sont les “essences” que vise la conscience phénoménologique : c’est-à-dire les choses elles-mêmes, les choses dans leur vérité, et les choses dans leur vérité ce sont les choses telles qu’elles se révèlent exactement pour moi : avec du sens. L’essence est à rechercher dans le sens et réciproquement. — Avec Husserl, il faut néanmoins parler de subjectivité plutôt que de sujet, car ce qu’il décrit c’est la vie même de la conscience, certes une conscience ramenée et réduite à une fonction de description des phénomènes (voire d’elle-même), mais néanmoins une conscience active et non passive comme le serait un substrat de type aristotélicien.
Sartre
Reprenant largement les idées de Husserl, Sartre développe la phénoménologie dans le sens de l’« existentialisme » : pour lui l’activité de la conscience reste prépondérante, mais cette activité se tourne résolument vers l’existence plutôt que vers les essences. La conscience est pure extériorité, ou extériorisation : elle ne peut se viser elle-même et n’y a aucun intérêt. Car sa vie est dehors, là bas, au loin, dans le monde. L’homme conscient se définit comme ek-sistence, ou encore “transcendance”, toujours allant “vers” le monde et situé “au-delà” de “lui-même”, excédant sa propre conscience de soi, en somme comme le dit Sartre, “une façon de ne plus être sa propre coïncidence.” La conscience est avant tout une relation, une direction vers-. Le “soi” de la conscience doit être paradoxalement pensé comme “hors-de-soi”, ou plus exactement comme un rapport avec un objet qui n’est pas soi. La conscience n’est même pas exactement “en rapport”, elle “est” ce rapport. Ce rapport dit de “transcendance”, c’est-à-dire cet écart obligé entre le sujet et l’objet, sans absorption possible de l’un par l’autre, c’est bien ce que Husserl a nommé l’intentionnalité (au sens que l’esprit vise toujours quelque objet, et non pas au sens courant de « avoir l’intention de faire » ceci ou cela). En somme on a beaucoup exagéré l'aspect "réflexif" de la conscience, comme si le fait de "se penser" avait un sens. Non, il faut se souvenir que l'on pense toujours à quelque chose d'autre. La conscience est toujours conscience de quelque chose, elle "vise" ou elle "pose" un objet : comme le dit Jean-Paul Sartre "la conscience est positionnelle d'objet", mais elle est "non-positionnelle de soi". Elle est intentionnelle au sens où elle se tourne vers quelque chose, elle est ce mouvement, cette ouverture vers le monde. En conséquence, la conscience n’est pas un intérieur clos et ne peut l’être.
« Connaître, c'est « s'éclater vers», s'arracher à la moite intimité gastrique pour filer, là-bas, par-delà soi, vers ce qui n'est pas soi, là-bas, près de l'arbre et cependant hors de lui, car il m'échappe et me repousse et je ne peux pas plus me perdre en lui qu'il ne se peut diluer en moi: hors de lui, hors de moi. (…) Du même coup, la conscience s'est purifiée, elle est claire comme un grand vent, il n'y a plus rien en elle, sauf un mouvement pour se fuir, un glissement hors de soi ; si, par impossible, vous entriez « dans» une conscience, vous seriez saisi par un tourbillon et rejeté au dehors, près de l'arbre, en pleine poussière, car la conscience n'a pas de « dedans»; elle n'est rien que le dehors d'elle-même et c'est cette fuite absolue, ce refus d'être substance qui la constituent comme une conscience. » Situations I, « Sur une idée fondamentale de Husserl : l’intentionnalité ».
La conscience est donc une projection dans le monde, un “éclatement”. Or cela définit aussi bien l'"existence" selon les philosophes existentialistes : l’existence humaine (ek-sistence) est une extériorisation, elle s’oppose à l’être inerte des choses. Les choses se contentent d'être "ce qu'elles sont" ; un être humain existe c'est-à-dire qu'il tend aussi vers ce qu'il n'est pas encore (il n’est pas seulement un sujet mais un pro-jet), avec cette particularité de pouvoir nier ce qui est pour transformer le monde, voire de nier ce qu’il est pour affirmer sa liberté fondamentale et se créer lui-même. En ce sens, la conscience produit du néant, elle est un pouvoir néantisateur et libérateur. Vivre dans le monde, s’extirper hors de soi n'est pas seulement le fait de la conscience, la condition propre de l'homme, cela devient même un devoir, une règle de vie. “Ce n’est pas dans je ne sais quelle retraite que nous nous découvrirons : c’est sur la route, dans la ville, au milieu de la foule, chose parmi les choses, homme parmi les hommes.” C’est ainsi qu’apparaît dans la philosophie de Sartre le thème de l’"engagement". Engagement dans l’histoire, la politique (une cause, un parti), l'écriture, une relation amoureuse, etc. La conscience est plus que jamais activité et non passivité, exigence envers soi et non jouissance de soi, résistance et non soumission, fidélité aux autres et aux événements vécus en commun.
Merleau-Ponty
Enfin l’approche phénoménologique de Merleau-Ponty, contemporain et ami de Sartre, s’avère particulièrement actuelle. Ce qui l’intéresse, ce sont aussi les rapports du sujet avec le monde, principalement à travers le phénomène — éminemment subjectif — de la perception Mais il reproche à ses prédécesseurs d’avoir négligé le rôle du corps ou plutôt d’avoir manqué la description réciproque du corps et du monde. Au profit en général du seul sujet, c’est-à-dire en réalité un seul des deux pôles concernés. Il s’agit de décrire une expérience qui est à chaque fois un “rapport d’être”, un échange et une expérience réunissant un corps et son environnement, ou un corps et un autre corps. La philosophie de Merleau-Ponty serait moins éloignée que celle de Sartre des conceptions psychanalytiques, celle de Lacan notamment, qui vont définir la subjectivité à la fois comme "signifiance" et "jouissance", mettant la sexualité au coeur de la vie psychique et donc subjective.
dm



