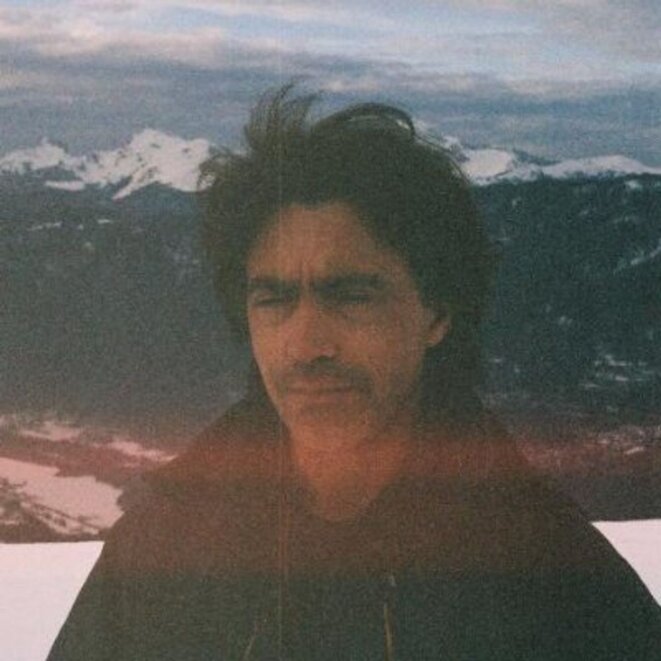Agrandissement : Illustration 1

Introduction
La mort n’est pas tant le contraire de l’existence que sa conclusion, ou littéralement sa fin. Leur jonction se fait alors dans le temps. Hormis Dieu peut-être, exister n’a de sens que dans le temps ; quant à la mort, elle représente, pour l’homme, la preuve la plus incontournable de sa condition temporelle et terrestre : la mort est ainsi l’épreuve même et ultime du temps.
Si l’on peut définir le temps comme une limite, faut-il en dire autant de la mort ? Faut-il, par “limite”, entendre simplement le caractère “fini” de l’homme, sa “finitude” ? Et si la mort est une limite, est-elle obligatoirement une fin ? Que pourrait bien signifier une expression comme “fin dernière”, dont les connotations semblent religieuses ?
Dans son livre La mort, Vladimir Jankélévitch organise son approche de la question selon les trois temps successifs : avant la mort, pendant la mort, après la mort. Or, si l’on tente de reconstituer la réflexion philosophique à ce propos, l’on s’aperçoit que celle-ci ne s’est longtemps intéressée qu’au troisième temps : la mort après la mort ; soit son aspect le plus métaphysique, l’Idée de la mort : l’incompréhensible. N’est-ce pas surtout, en la réduisant à une idée, une manière de dénier le réel la mort - et le temps lui-même ? La pensée de la mort avant la mort précède également celle de la mort “en face”, si l’on peut dire, car elle est à nouveau une façon de différer son approche la plus radicale : il s’agit souvent, d’ailleurs, de la mort des autres : l’inadmissible. Enfin vient la mort pendant la mort, seule véritable mort, la mort propre, à même l’existence : l’impossible même.
I - L’idée de la mort ou l’incompréhensible
1) La thèse spiritualiste
La pensée philosophique de la mort consiste souvent en des doctrines qui lui donnent un sens en assignant ce qui se situerait après elle. La première de ces doctrines, appelée souvent orphico-platonique, est fondée sur le dualisme du corps et de l’âme : face à l’éternité de l’Être et de l’âme, se dresse la caducité du monde sensible et du corps. Chacun s’en va vivre son destin : Platon : « [La mort], est-ce autre chose que la séparation de l’âme d’avec le corps ? On est mort, quand le corps, séparé de l’âme, reste seul, à part, avec lui-même, et quand l’âme, séparée du corps, reste seule, à part, avec elle-même » (Phédon).
Pour Thomas d’Aquin et la scolastique en général, l’homme est composé d’un corps matériel et mortel, et d’une âme immatérielle et immortelle. L’âme est la “forme du corps”, c’est-à-dire un principe qui donne l’unité du corps en le structurant ; et cependant elle lui survit. Ainsi la théorie aristotélicienne de la matière et de la forme, de la puissance et de l’acte, est-elle compatible avec la doctrine chrétienne, qui prévoit l’immortalité des âmes.
Avec Hegel (et bien avant, Héraclite), nous entrons dans le domaine des interprétations dialectiques. La vie se présente comme une sorte d’inadéquation entre le singulier (par exemple une âme, ou une âme et un corps) et l’universel (l’Esprit) : ces derniers y sont en conflit permanent, le second tendant à réduire le premier. Et la mort vient mettre fin à cette inadéquation ; c’est le moment de la coïncidence où la singularité rejoint l’universel, c’est-à-dire pour Hegel l’abstraction, l’Idée.
Mais après tout, avec les doctrines panthéistes, l’on peut simplement définir l’universel comme la totalité des choses et des êtres, comme la Nature, et assimiler celle-ci à Dieu ; ainsi à sa mort, l’être individuel se dissout dans la vie de la totalité ; la vie humaine n’est qu’un moment dans le rythme de l’univers. — Partant, si c’est la vie qui définit la mort, la mort n’est pas un vrai sujet de réflexion : l’homme libre ne pense à rien moins qu’à la mort, et sa sagesse n’est point une méditation de la mort, mais de la vie.
2) L’explication matérialiste
Pour une conception purement matérialiste de la vie, niant absolument toute réalité de l’esprit, la mort n’est pas davantage un “problème”. Épicure, par exemple, définissant le réel par la sensation, montre assez facilement que, hors de toute sensation la mort n’est rien : « Familiarise-toi avec l’idée que la mort n’est rien pour nous, car tout bien et tout mal résident dans la sensation ; or, la mort est la privation complète de cette dernière (...). Ainsi, celui des maux qui fait le plus frémir n’est rien pour nous, puisque tant que nous existons, la mort n’est pas, et que quand la mort est là nous ne sommes plus » (Lettre à Ménécée).
De même, pour le matérialisme moderne, le “grand réservoir des âmes” n’est plus à situer dans le ciel des Idées, ni au Paradis, ni au sein d’une nature divinisée, mais tout simplement dans la matière : “poussière, tu redeviendras poussière !” Ce qui ne veut pas dire que, par ailleurs, tout désir d’éternité soit aboli, toute perpétuation de l’individu oubliée. Pour Marx, par exemple, si la mort apparaît comme la dure victoire de l’espèce sur l’individu, l’individu en échange se perpétue, d’une certaine façon, dans l’espèce. Ainsi l’acte de la procréation, chez l’être humain, s’expliquerait en partie par un désir d’immortalité.
Quoi qu’il en soit, le dualisme de l’âme et du corps n’a plus cours, et le destin de l’homme se confond finalement avec les pérégrinations du corps. Le corps se présente comme une unité organique, une singularité vivante opposable à tout ce qui l’entoure. Or, selon Bichat, c’est cette dualité même qui explique le phénomène de la vie et donc de la mort : « la vie est l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort. (...) La mesure de la vie est donc, en général, la différence entre l’effort des puissances extérieures et celui de la résistance intérieure. »
Cette idée d’une “tension” entre la vie et la mort, encore un peu manichéenne, fait place aujourd’hui à une approche plus scientifique, quasiment “informatique”, de ces phénomènes : « la mort fait partie intégrante du système sélectionné dans le monde animal et dans son évolution » (François Jacob, La logique du vivant). Le mot clef est celui d’évolution, que l’on définit justement en fonction de plusieurs critères, dont le premier est la sexualité. « L’autre condition nécessaire à la possibilité même d’une évolution, c’est la mort. Non pas la mort venue du dehors, comme conséquence de quelque accident. Mais la mort imposée du dedans, comme une nécessité prescrite, dès l’œuf, par le programme génétique même » (id.).
Enfin, il reste à voir l’aspect purement médical de la mort, c’est-à-dire la détermination même de l’instant mortel. Non pas, métaphysiquement : qu’est-ce que la Mort ; mais, concrètement, qu’est-ce qu’un mort , c’est-à-dire un cadavre ? La détermination du moment de la mort a toujours constitué un problème, et l’on comprend bien pourquoi. Ce témoignage, datant déjà : « Des faits incontestables prouvent encore que des sujets livrés trop brusquement au couteau anatomique, ont donné par leurs cris, des marques certaines de vie, lorsqu’ils en ont senti le tranchant, à la honte éternelle de l’Anatomiste imprudent, honte égale à l’indignation de la famille du survivant. » (Winslow Jacques-Bénigne, Dissertation sur l’incertitude des signes de la mort et de l’abus des enterrements et embaumements précipités). Les deux critères cliniques et officiels jusqu’à tout récemment étaient simples : arrêt de la respiration et arrêt cardiaque. Mais il existe depuis toujours des cas mystérieux de réanimation après une mort apparente plus ou moins longue : des cœurs se remettent à battre et des gens revivent. Inversement, des techniques complexes de perfusion et de respiration artificielle permettent de maintenir en vie des blessés, des vieillards, des malades dont le cerveau est irrémédiablement atteint. Aussi, en mai 1966, l’Académie de Médecine de France a arrêté un nouveau critère : l’arrêt de l’activité cérébrale. Le cerveau seul donne à l’homme sa réalité : là où il est mort, l’être humain n’est plus. Quand l’électro-encéphalogramme montre un tracé plat pendant un certain délai (par ex. 48 heures), on peut être certain que cela est irréversible, que la mort est bien réelle. La question se complique encore, cependant, du fait qu’on s’est mis à mieux distinguer entre la mort du cortex et la mort totale du cerveau (cortex + tronc). Le cortex une fois mort, il n’y a plus de vie consciente et relationnelle possible : les cellules grises sont nécrosées. Mais il reste une vie végétative autonome possible, dont la durée peut être très longue : on parle souvent de “coma prolongé” ou d’”état végétatif chronique”. Au contraire, quand il y a mort totale du cerveau (l’électro-encéphalogramme est complètement nul), il n’y a plus de vie autonome possible, même végétative, c’est-à-dire que celle-ci cesse dès que l’on débranche les appareils : on parle alors de “coma dépassé” ou de “mort neurologique”.
Mais la question de savoir quand précisément intervient la mort est insoluble dans l’absolu. Car il faut considérer la mort, non comme un acte instantané, mais vraisemblablement comme un processus. On sait par exemple que la mort cérébrale ne survient que plusieurs minutes après l’interruption de la fonction cardiaque et respiratoire. — Nous verrons plus loin les redoutables problèmes éthiques que cette relative indétermination peut poser.
3) Penser la mort
L’inconvénient des thèses spiritualiste et matérialiste, c’est qu’elles dispensent à proprement parler de “penser la mort”, puisqu’elles apportent à ce problème une solution toute faite. Or, traditionnellement, le philosophe qui n’a pas renoncé à l’idée de la sagesse se définit comme celui qui apprend à mourir : « Philosopher, c’est apprendre à mourir » (Montaigne). Apprendre à mourir ne signifie pas seulement apprendre à supporter l’idée de la mort, c’est apprendre aussi une “autre vie”, c’est apprendre à penser, c’est apprendre à apprendre.
Mais si, comme l’écrit Valéry, « la mort est une surprise que fait l’inconcevable au concevable », comment penser la mort ? Nous sommes dans le domaine de l’inconcevable et de l’incompréhensible. La mort ne peut en aucune façon être l’objet d’une expérience directe ; et l’on ne revient jamais d’entre les morts pour témoigner. Pareillement la conscience nécessite un objet, mais la mort n’est pas un objet. « En première personne, je suis toujours avant ma propre mort ; le pendant et a fortiori l’après me sont obstinément refusés. (...) Ainsi la mort joue à cache-cache avec la conscience. » (Jankélévitch.) La pensée de la mort se heurte donc à une aporie, à une contradiction de principe. — Sauf, comme nous le verrons, à penser la mort des autres, ou bien encore sa propre mort, non plus comme résultat (après la mort) mais comme intégration dans la vie (avant ou pendant la mort).
La seule façon d’envisager l’”après-mort” — impensable comme telle — est d’en passer par une médiation, par une réalisation destinée à nous “représenter” dans l’au-delà (qu’il soit céleste ou terrestre) : dans le cadre de la sublimation, il s’agit de l’œuvre. L’œuvre, qu’elle soit artistique, scientifique, philosophique, assure d’une certaine façon la perpétuité de l’individu ; elle permet également à ce dernier de prévoir et d’anticiper ce que sera sa vie outre-tombe, sa vie posthume ... Mais pour les autres ! Au fond, l’œuvre a une vocation testamentaire.
II – La mort des autres ou l’inadmissible
1) La mort socialisée
C’est bien connu, ce sont toujours les autres qui meurent. Ce qu’exprime Heidegger : « Le “on meurt” répand l’opinion que la mort frappe, si l’on peut dire, le on. (...) ce n’est chaque fois justement pas moi ; car ce on n’est Personne » (Etre et temps). Le “trépas” est ramené au niveau d’un événement qui frappe sans doute la réalité humaine mais ne concerne spécialement personne. Or, comment ne pas voir dans ce “on” le domaine de l’inauthenticité et du mensonge ? L’on s‘aperçoit par exemple que, dans la façon ordinaire de rapporter la mort du “on”, la mort d’untel, l’on ne fait que relater les circonstances de la mort — l’accident, la maladie, les obsèques, la douleur des proches — mais jamais la mort elle-même. La mort des autres est bien commode, mais elle se dérobe à la pensée, au langage.
La mort socialisée pourrait signifier, en particulier aujourd’hui, “la mort indifférente”. Il s’agit de considérer la mort des autres en dépersonnalisant le plus possible, et ces autres, et cette mort. Sociologiquement, notre époque se caractérise par un refus de la mort. Ou plus exactement : angoisse, répulsion, marginalisation et mensonge à l’endroit des mourants ; mais parallèlement exposition, représentation, surexploitation du spectacle de la mort. Autrement dit, l’on a profondément déshumanisé la mort pour se livrer à une sorte de gigantesque exorcisme médiatique. On filme la mort, mais l’on n’”accompagne” plus les mourants. Refus d’appeler un chat un chat, la mort est indicible : “Il a besoin de se reposer... Laissez le dormir...” entend-on dans les hôpitaux. « Avec l’oisif, plus que lui, le mourant est l’immoral : l’un, sujet qui ne travaille pas ; l’autre, objet qui ne s’offre même plus à un travail ; tous deux intolérables dans une société ou la disparition des sujets est partout compensée par la multiplication des tâches » (Michel de Certeau).
Il n’en a pourtant pas toujours été ainsi. Le degré de raffinement d’une société se mesure à sa façon de traiter ses morts. Et ses mourants. C’est la fonction du rite funéraire que de donner une signification à la mort. D’un côté, la mort est ainsi l’occasion de se réconcilier avec les vivants ; de l’autre, de retrouver ses ancêtres disparus. La coutume et la tradition font paradoxalement de la mort le lien ou le ciment de la vie sociale. De ce point de vue, les obsèques participent de la fonction générale de la “fête” (ceci est encore une réalité dans certains pays africains).
D’une façon plus générale, l’humanité en général se définit par le fait qu’elle enterre ses morts. A tel point que la sépulture marque peut-être le passage (et non l’opposition) de la nature à la culture, de l’animalité à l’humanité. Comme l’écrit Jacqueline Russ « Partout et toujours, à toutes les époques et dans toutes les civilisations, le seul passeport d’humanité en règle, c’est la sépulture ».
2) Bioéthique de la mort
Redoutable compensation, la société s’arroge en revanche le droit de donner la mort. En fonction d’un certain échange symbolique, la société “achète” bien souvent la paix au prix du sacrifice d’un de ses membres : c’est justement la fonction rituelle du sacrifice. L’éthique de la mort se formule donc tout d’abord en termes juridiques et sociologiques. L’on rencontre ici, par exemple, le problème de la peine de mort, sous sa triple face : sociologique (le recours à la peine de mort, son inexistence, son abolition ou son rétablissement s’expliquent par les coutumes en vigueur et les problèmes ponctuels rencontrés par une société), juridique (par exemple : la société se trouve-t-elle en état de légitime défense lorsqu’elle décrète la peine de mort ?), moral ou religieux (en général, l’homme a-t-il un droit sur la vie d’autrui ?).
Il faut réserver une place à part à la bioéthique de la mort, c’est-à-dire l’ensemble des problèmes éthiques que soulève le développement des sciences biologiques et médicales, dans la mesure notamment où les médecins sont désormais en mesure, techniquement, de “prescrire” ou à l’inverse de retarder la mort. Les deux problèmes principaux — et symétriques — sont à cet égard l’avortement et l’euthanasie. Que penser de l’”acharnement thérapeutique” ? (Cf. le film Johnny got his gun). Faut-il généraliser les “dons d’organe” ? Etc. Se repose avec une acuité sans égal le problème, maintes fois rencontré, de la “limite”, et aussi de la mesure. Quelles mesures prendre pour rendre la mort plus humaine, quelles limites ne pas dépasser pour éviter de la rendre plus inhumaine ? N’est-ce pas, sur tout ceci, au sujet lui-même d’en décider ? Le point de vue des autres (médecins, famille, morale, etc.), dans cette matière funèbre, n’est-il pas généralement et par principe même abusif ?
Le Marquis de Sade (La Philosophie dans le boudoir) proposait justement une éthique de la démesure et du sans-limite : une éthique (la seule connue à ce jour !) de l’assassinat ! “Donner” la mort sans compter. Pouvoir jouir de l’autre absolument et sans limite, jusqu’à sa mort ; et réciproquement... Mais si cette jouissance est vraiment réciproque, alors cette morale de la jouissance et de l’assassinat s’annule elle-même. S’il faut s’entretuer les uns les autres, autant n’en rien faire ! L’absurdité logique de cette thèse montre les limites de toute considération à propos de la mort des autres, parce qu’elles sont toujours les considérations des autres. Or la mort est d’abord une affaire personnelle ; seul ce point de vue permet de régler, notamment, les questions posées par la “bioéthique”. Concernant par exemple le don d’organe, comment décider à la place de quelqu'un !?
3) Le deuil
Il existe au moins un sentiment qui permet de “vivre”, en quelque sorte, la mort des autres: c’est le deuil. “Être en deuil” signifie exactement “regretter” l’autre ; mais ce regret, s’il comporte naturellement la peine, témoigne surtout du respect que l’on éprouve pour l’autre — autrement dit, maintenant, pour sa “mémoire”. Le deuil n’est pas la douleur brute ressentie à l’occasion de la mort d’un proche ; il est l’acceptation digne et la résolution de cette douleur. En elle-même, dans son aveuglement, la douleur morale est facilement accusatrice ; il lui faut un responsable ; et dans le cas présent, le responsable désigné ne saurait être que le mort lui-même. C’est bien un comble : je te pleure d’abord parce que je t’en veux d’être mort ! Le deuil consiste précisément à renoncer à cette haine muette et inconsciente. Par quel moyen ? Par le souvenir, ou plutôt par l’élévation du souvenir à la symbolisation. Le deuil peut être considéré comme le temps nécessaire pour symboliser la mort d’autrui ; symboliser consiste à trouver les signifiants, les représentations capables de suppléer à la perte physique ressentie. Faire son deuil, c’est mettre des mots où il y avait un corps.
Mais peut-on faire son deuil de toute mort ? N’y a-t-il pas des pertes inconsolables car précisément non symbolisables ? Comment en effet faire son deuil d’un enfant, de son enfant? Quelle raison peut venir justifier une telle mort ? Quel signifiant peut “remplacer” ce qui, peut-être, est encore trop directement charnel, chair de sa chair, non suffisamment advenu au langage ? « Pourquoi la mort prématurée ? » demandait déjà Lucrèce. L’on voit qu’il s’agit d’un problème logique autant qu’affectif ! — Il y a donc des degrés dans la mort des autres. On définira donc la mort d’un enfant comme proprement inadmissible ; le scandale à l’état pur. Quant à la mort des proches, voici l’analyse de Jankélévitch, toujours dans son ouvrage La mort : « Entre l’anonymat de la troisième personne et la subjectivité tragique de la première, il y a le cas intermédiaire et en quelque sorte privilégié de la deuxième personne ; entre la mort d’autrui, qui est lointaine et indifférente, et la mort-propre, qui est à même notre être, il y a la proximité de la mort du proche. Le Toi représente en effet le premier Autre (...). Quant à la mort de nos parents, elle fait disparaître le dernier intermédiaire interposé entre la mort en troisième personne et la mort-propre ; le dernier glacis est tombé, qui séparait de notre mort personnelle le concept de la mort. » Autrement dit, la mort du plus proche signifie l’approche au plus près de sa mort.
III. La mort propre ou l’impossible
1) L’être-pour-la mort
Que sont finalement l’Idée de la mort et la mort des autres sinon une sorte de fiction, d’anticipation ? Mais y a-t-il un réel sous-jacent ? La fiction de la mort nous renvoie invariablement à la réalité vécue de notre existence, elle exprime à sa manière toutes les ambiguïtés de cette existence, et n’a, finalement, d’autre visage que celui, composite, des vivants, avec leurs espoirs et leurs inquiétudes. C’est pourquoi la philosophie classique, tout occupée à assurer les démarches d’une pensée claire et distincte, ne s’est guère attardée à discourir de la mort dont le concept ne semble guère pouvoir prendre place dans le discours rationnel. Aussi la religion est-elle déclarée seule compétente en la matière. Et en effet, c’est bien dans le discours religieux qu’apparaît une première forme du “souci” de la mort, de la mort propre, comme témoignage même de sa foi. Calvin : « il y a grande différence entre Réprimer notre douleur, afin qu’elle soit sujette à Dieu ; et S’endurcir comme une pierre [stoïciens], en rejetant tout sentiment humain. Il faut donc que la douleur des fidèles soit mêlée de consolation, qui les duise à patience. L’espérance de l’immortalité bienheureuse, laquelle est mère de patience, fera cela » (Commentaire de la Lettre aux Thessaliens).
Les penseurs modernes ont fait une distinction entre la vie organique et l’existence humaine, et ils ont défini l’existence comme la vie plus la conscience de la mort. La mort devient du même coup la “grande affaire” de la vie : elle se définit comme ce qui rend possible tous les possibles de la vie. La perspective de la mort n’est autre que la preuve de la réalité de la vie. Heidegger : « Cette fin que l’on désigne par la mort ne signifie pas, pour la réalité humaine, être-à-la-fin, “être-finie” ; elle désigne un être pour la fin (...). La mort est une manière d’être (...). L’homme est un être-pour-la-mort » (Être et temps). Pour saisir l’essence de la mort, et donc de l’existence, il faut s’arracher d’abord à l’inauthenticité, au règne du “on” et de l’anonymat. Pour cela je dois accepter mon angoisse : dans l’angoisse devant la mort, je suis en présence d’une donnée fondamentale de ma vie. Je saisis alors la mort comme forme même de toute l’existence (Heidegger) et non point comme décès. A chaque instant de la vie, la mort est présente.
Mais quelle est la raison profonde de ce phénomène ? Heidegger précise : « Les mortels sont ceux qui ont la possibilité d’expérimenter la mort en tant que mort. L’animal ne le peut pas. Mais la Parole aussi lui est inaccessible. Le rapport constitutif entre mort et langage saute ici aux yeux en un éclair soudain. » C’est le langage, en effet, qui définit l’homme comme être-pour-la-mort. Car dans le langage, existe la possibilité pour l’homme de projeter la totalité, et donc le terme, de sa vie. — Par ailleurs, la mort est bien dans le langage, au sens où, comme le disait Hegel, le concept est la mort de la chose. Le mot est le meurtre de la chose !
2) L’angoisse
Selon Heidegger, l’être-pour-la-mort s’éprouve essentiellement dans l’angoisse, précisément comme angoisse devant la mort. Or, toute angoisse (même si l’on ne “pense” pas à la mort, même si l’on croit ne pas y penser) peut se définir comme un sentiment de la mort. C’est-à-dire la sensation panique d’une absence ou d’un manque. « L’angoisse n’est pas liée à la peur d’un objet mais à la confrontation du sujet à une absence d’objet, à un manque d’être où il est happé et auquel tout est préférable » précise Lacan. Or que faut-il pour “être”, pour vivre comme un être réellement désirant ? Du manque ! De quoi, donc, l’angoisse est-elle manque : du manque. Manquer du manque, comme l’on dirait manquer d’espace, ou manquer d’air, c’est littéralement étouffer...
Comment la mort pourrait-elle nous étouffer en elle-même, puisqu’elle n’est jamais là, jamais présente ? Ceci est moins sûr : car, pour semer l’angoisse, la mort a des représentants dans la vie, et parmi ceux-là les plus insoupçonnables, les plus proches. Les parents, les amis, l’Autre en général peuvent représenter la mort, en ce sens où leur présence peut devenir meurtrière. D’où provient l’angoisse des enfants, en général, sinon d’un rapport spécialement étouffant avec les parents ; avec cette conséquence que souvent l’enfant développe alors une phobie afin de combler à tout prix ce manque, fût-ce donc par un objet effroyable; en d’autres termes l’enfant tente de fuir l’angoisse au moyen de la peur, comme pour lui donner une “raison” consciente. “Maintenant” il aura peur de ceci, de cela — et non plus de “rien” !
L’angoisse n’en reste pas moins sous-jacente à la peur ; mais le sujet n’en sait rien. Comme il ignore la définition proprement mortifère de son angoisse. Mais qu’est-ce qui se trouve ainsi menacé de mort, finalement ? Le sujet lui-même, assurément. Et quoi dans le sujet ? Son désir. L’angoisse est toujours l’angoisse de perdre son désir — ce qui signifie, en effet, la mort. Mais comment risquer de perdre son désir, par qui, comment ? Il s’agit de la sensation, du sentiment confus que l’Autre “attend” tout de moi, beaucoup plus en tout cas que je n’en peux donner ; et logiquement, s’il désire la perfection en moi (c’est du moins ce que je crois), alors il désire aussi ma mort, puisque la perfection signifierait la mort de mon désir. Lacan définit ainsi l’angoisse comme « la sensation du désir de l’Autre ». Le candidat à un concours connait l’angoisse parce qu’il connait la différence éventuelle entre ce qu’il sait et ce qu’on pourrait être amené à lui demander. “On”, c’est l’examinateur ; mais derrière celui-ci, se cache bien souvent la figure mythique et symbolique du Père : qu’en pensera-il si j’échoue, et même si je réussis, serais-je conforme à l’image qu’il a de moi ? Or cette image, et tout ce cirque, c’est bien évidemment le sujet lui-même qui le construit imaginairement ; c’est lui qui se nuit à s’imaginer imaginé par l’Autre, et qui se tue littéralement à vouloir ressembler à ce qu’il n’est pas, ni pour lui-même ni pour personne. — Nous avons décrit par là même les principaux caractères de la névrose obsessionnelle, tout entière fondée sur l’angoisse de la mort — c’est-à-dire en fait la non-reconnaissance véritable de l’Autre, la supposition peu flatteuse pour l’Autre qu’il me considère comme son esclave et que je dois travailler pour lui. Il faut donc définir l’angoisse, au-delà de Heidegger, non comme le signal simplement conscient de ma mort, mais comme le rapport entre ma mort et le désir de l’Autre, ou mieux comme la passion mortelle du désir de l’Autre.
Or cela, à y bien regarder, définit aussi bien le suicide. L’on pourrait croire que le suicidé dit adieu à la vie par désespoir ...et l’on aurait raison. Cependant, ce n’est pas la vie qui le désespère (il aimerait bien nous le faire croire, et il fait tout pour cela, jusqu’à l’irréparable), ce sont les autres... Même lorsqu’il s’accuse de tous les maux, c’est pour mieux en accuser les autres de l’avoir fait comme tel, de l’avoir laissé vivre et mourir aussi malheureux. L’on sait bien qu’un acte de suicide s’adresse toujours à quelqu’un (les parents, la société, Dieu). — Donc, comme l’angoisse, l’on serait tenté de dire que le suicide n’est pas vraiment “à la hauteur” de la mort ; il est une approche de la mort par la médiation problématique de l’Autre. En lui-même, le suicide est d’ailleurs contradictoire : « à quoi bon se tuer, puisque l’on se tue toujours trop tard » remarque Émile Cioran…
3) Le courage d’avoir peur
Autrement dit, contre l’angoisse annihilante, et pour affronter la mort c’est-à-dire concrètement et courageusement vivre, il faut réhabiliter la peur – une certaine peur, y compris la peur de mourir quand l’on se sait responsable de la vie, et surtout de celle des autres.
Si nous avons pu définir l'angoisse comme la "sensation confuse du désir de l'Autre", la peur serait plutôt ici la sensation de la jouissance de l'Autre, de ce que l'Autre pourrait nous faire, et d'abord nous tuer.
Mais il y a une seconde peur, qui ne tient plus seulement au danger que peut représenter Autrui ; une peur d'autant plus authentique (donc tout le contraire de la "déchéance" heideggerienne) qu'elle est moins la peur "de" l'Autre qu'une peur "devant" l'Autre. C’est ce dont nous entretient Emmanuel Levinas qui, ce faisant, rectifie décisivement l'ontologie de Heidegger par l'éthique, en parlant de responsabilité.
La peur au second sens, dans sa positivité pleine et entière, est celle qui conduit à l'œuvre et d'abord à l'action ; c'est la peur qui demande et génère du courage (il n'y a pas de courage sans peur), et qui devient engagement. (Courage et engagement qui ont tant fait défaut à Heidegger dans les années sombres du Rectorat, comme on sait, et au-delà dans son déni, et qui ne sont qu'une conséquence du déni de la peur.)
Avec l'angoisse nous sommes évidemment dans la culpabilité, mais avec la peur nous sommes dans la responsabilité. L'angoisse nous dépossède de toute autonomie face à l'Autre parce que ne sachant pas ce qu'il nous veut, nous sommes toujours "en faute" devant lui (culpabilité). Mais la peur tient à l’exigence explicite d’accomplir l’acte, d’aller jusqu’au bout de sa réalisation, ou de la création, et ceci fondamentalement parce qu'elle est attendue de l'Autre. Or nous sommes toujours seuls (il n'y a pas de modèles ni de recettes dans le rapport avec Autrui - d'où la peur) ; seuls devant cet Autre pour lequel nous nous sentons cette fois "en défaut", non plus coupables mais responsables.
Peur et responsabilité lorsque la peur de mourir se transforme, pour l'éthique, en peur de causer la mort, voire de commettre un meurtre. Peur (légitime) et responsabilité lorsque le parent doit s'occuper de l'enfant handicapé et doit penser à son avenir, lorsque lui-même ne sera plus là (tout le contraire de la culpabilité, même si l'angoisse vient se mêler à la peur, dans pareil cas). En bref peur et responsabilité devant l'Autre lorsque le temps qui passe, l'adversité, la fatigue, nous détournent de l'œuvre à accomplir. « Peur de mourir – peur de laisser une œuvre manquée » dit encore Levinas, non par égoïsme, mais parce que l'œuvre est nécessairement destinée à l'Autre.
L’agonie (conclusion)
Contre Heidegger, nous dirons alors que l’angoisse ne signe pas la condition mortelle de l’homme, son “être-mortel”, sa mortalité. Au-delà de la peur, dont nous avons vu la fonction proprement éthique, nous évoquerons pour finir le concept de détresse puis celui d’agonie. L’homme est naturellement un être de détresse, en détresse, c’est-à-dire fondamentalement abandonné, fondamentalement seul. Ainsi face à la mort : « Nous mourrons seuls », dit Pascal. A la limite, l’angoisse n’est qu’une ruse du moi pour cacher cette détresse en quoi se résume la condition humaine. Le caractère terrible — et exaltant ! — d’une telle condition se situe bien au-delà de tout optimisme et de tout pessimisme. Car si l’homme est seul, encore plus qu’il ne l’imagine, l’on peut bien dire aussi qu’il est libre au dernier degré...
Fondamentalement, l’homme en détresse — il ne s’agit même plus d’un “appel au secours”, ni d’un désespoir puisqu’il s’agit de désespérer même du désespoir — n’”attend” pas la mort, puisqu’il n’attend rien de rien. Il est déjà dans la mort ; il est sa propre mort. Il vit, il meurt, et c’est la même chose. La mort n’est pas une fin, elle est au contraire la marque de l’infinité de l’existence humaine, de l’intrusion fondamentale et illimitée de la mort dans la vie, leur confusion même.
Plutôt doit-on la définir comme une limite. Cette limite a un nom : c’est l’agonie. Il ne s’agit plus de faire de l’agonie le dernier terme de la lutte de la vie contre la mort, mais de l’instituer comme limite ou comme rapport infini de la vie et de la mort. Définir l’existence comme agonie, c’est vouloir vivre sa mort dans chaque instant de sa vie ; éterniser le présent grâce à la mort ; devenir en quelque sorte immortel par l’acceptation paradoxale mais radicale de la mort. Ainsi existe-il une véritable “condition d’agonie”, par quoi l’homme se situe toujours en “face-à-face” avec la mort et ne la quitte plus.
Si la mort n’est pas une fin, mais une limite, alors la mort n’est pas une vérité dernière. Elle ne l’est pas au sens négatif ou nihiliste, puisque la mort n’est pas un déclin, ou une déchéance, mais la déclinaison même de la vie.
dm