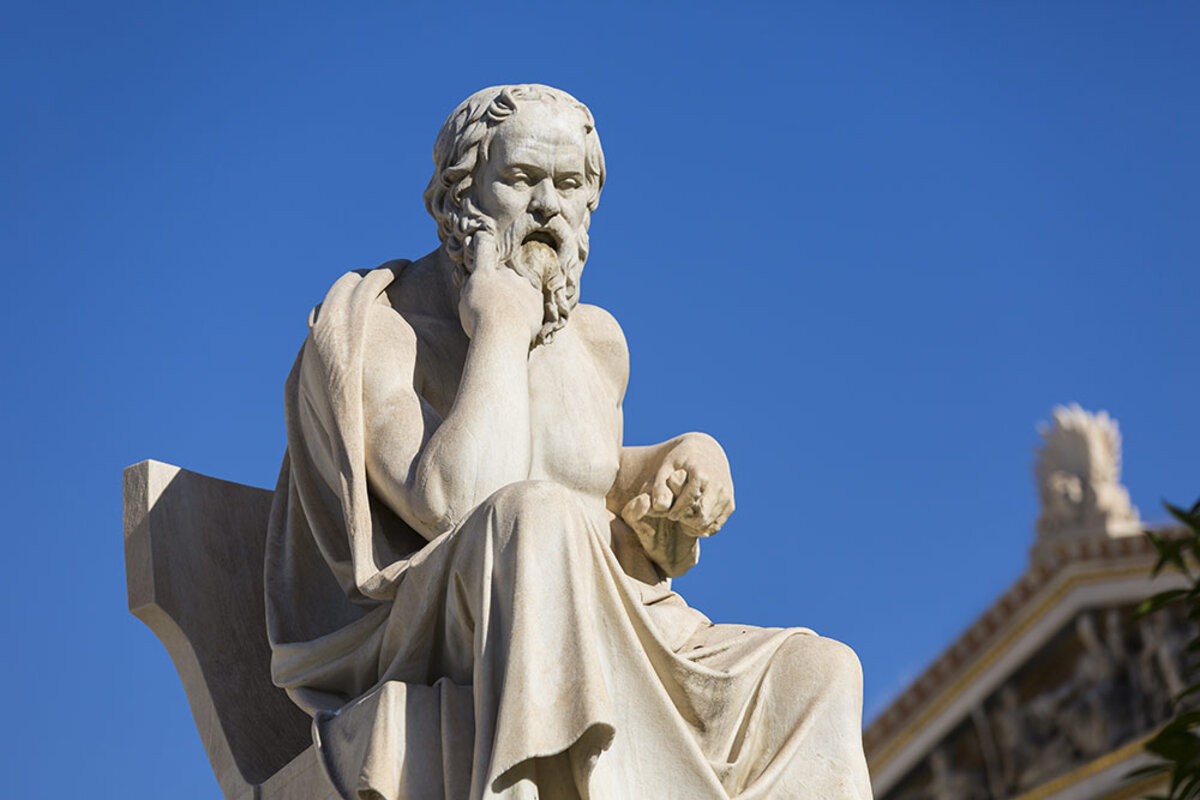
Agrandissement : Illustration 1
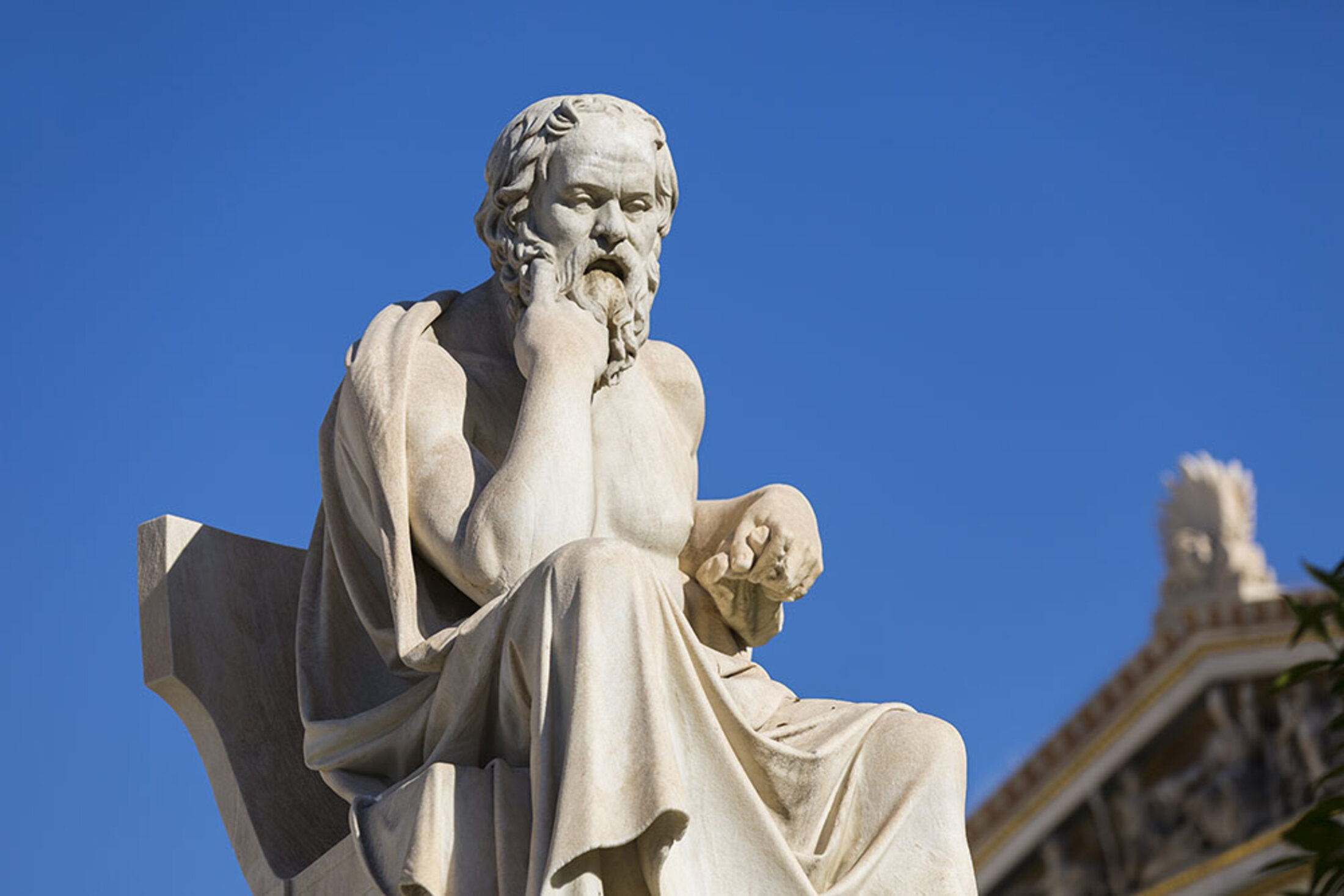
Le commencement de la philosophie avec Socrate (470-399 av. J.-C.)
La philosophie n'a pas toujours existé ; elle est historique en ce sens d'abord qu'elle a eu un commencement. S’opposant aux mythes et aux simples préjugés culturels, la philosophie repose sur la décision de conférer à la seule pensée rationnelle la détermination du vrai : la raison universelle, présente - au moins potentiellement - en chaque homme. Or cette décision historique revient aux Grecs à partir des VIè et Vè siècle avant J.-C. Certes il y avait bien des spéculations abstraites en Chine ou en Inde à la même époque, mais elles n’étaient pas vraiment coupées de leur base culturelle mythologique ou religieuse.
Par ailleurs il est évident que l'invention de la démocratie par les Athéniens, en matière de politique, n'est pas étrangère à ce choix en faveur de la discussion rationnelle. D’autres facteurs historiques ont pu être déterminants, comme l’essor des mathématiques en Grèce (donc le goût pour l’abstraction), l’intérêt pour la physique et l’astronomie, et parallèlement le déclin de la religion païenne (polythéiste) tournant de plus en plus en folklore ridicule.
Socrate est le père véritable de la philosophie telle que nous la connaissons - à quoi il faut ajouter les spéculations de son disciple Platon qui a rapporté les paroles du maître. Avant Socrate il y avait bien des penseurs (dits “pré-socratiques” justement : Empédocle, Héraclite...), mais ceux-là étaient surtout des physiciens. Socrate est le premier à avoir pris pour cible exclusive de sa réflexion le sujet humain, et en particulier sa capacité à tenir un discours vrai.
Le personnage de Socrate est, littéralement, atypique. D'après l'oracle de la pythie de Delphes, Socrate serait le plus savant des hommes. Pourtant, paradoxalement, ce dernier affirme ne rien savoir. Il s'interroge donc sur le sens de cet oracle et recherche à travers les rue d' Athènes des concitoyens plus savants que lui. Or il ne rencontre que des individus professant un savoir faux et illusoire (de simples "opinions"). Socrate ne sait rien, mais le fait d'en avoir conscience représente un savoir précieux, et surtout il ne professe aucun scepticisme. Sa recherche de la vérité est sincère ; en atteste sa lutte contre les sophistes (des spécialistes de la rhétorique) qui prétendent que toutes les opinions se valent, que l'on peut donc toutes les démontrer, aucune n'étant vraie puisque notre connaissance n'a aucun fondement.
Socrate utilise le dialogue pour rechercher la vérité, grâce à des questions, des hypothèses, des déductions échangées avec ses interlocuteurs. Mais certains questions demeurent sans réponses, elles sont dites alors "aporétiques". Puisqu'il affirme ne rien savoir, Socrate cherche à s'appuyer sur le savoir (prétendu) des autres, ce qui l'amène à utiliser l'ironie. Il feint d'adhérer à l'opinion de son interlocuteur, pour le questionner et révéler des contradictions, entre son opinion et les conséquences qui en découlent. Par analogie avec sa mère, Phénarète, qui était sage-femme, Socrate se dit accoucheur des esprits, autrement dit "maïeuticien". Il aide son interlocuteur à découvrir la vérité qui était cachée en lui.
Mais l’enseignement de Socrate, basé sur la critique rationnelle et la réflexion autonome, a été perçu comme subversif par ses concitoyens. Un fait témoigne de la haute valeur morale de Socrate. Injustement condamné à mort par le tribunal d'Athènes, et alors qu'il a la possibilité de s'évader, Socrate préfère subir cette condamnation, même si elle est injuste, plutôt que de bafouer la justice de la Cité. "Subir une injustice est préférable à la commettre" déclare-t-il.
*
L’amour de la sagesse
Conformément à l’étymologie grecque, Philo-sophia est l’Amour de la sagesse (du verbe philein, aimer, et de sophia, sagesse). Philo-sophos s’oppose ainsi, par exemple, à philo-somatos (amour du corps), ou bien à philo-edenos (amour des plaisirs).
Cet amour est synonyme de « désir », ou encore de recherche, et donc de manque. Celui qui désire la sagesse ne la possède pas. Dans le contexte grec, seul le Dieu est Sophos, sage. Pour l’humain cela implique donc un parcours d’apprentissage, une étude. Le philosophe n’est pas le « vieux sage » traditionnel, possesseur des secrets de la nature et rempli d’expérience. Ce n’est pas non plus un “maître” accompli comme le sage oriental, un demi-dieu comme le Bouddha…
Dans son ouvrage le Banquet, Platon met en scène Socrate racontant comment une mystérieuse Diotime lui aurait enseigné la véritable identité du demi-dieu Eros (Amour) et par-là même la vraie nature de la philosophie, car selon Diotime, Eros – par son imperfection même – est le seul parmi les dieux à être philosophe.
« DIOTIME. — Comme fils de Poros et de Pénia, voici quel fut le partage de l'Amour : d'abord il est toujours pauvre, et, loin d'être beau et délicat, comme on le pense généralement, il est maigre, malpropre, sans chaussures, sans domicile, sans autre lit que la terre, sans couverture, couchant à la belle étoile auprès des portes et dans les rues; enfin, comme sa mère, toujours dans le besoin. Mais, d'autre part, selon le naturel de son père, il est toujours à la piste de ce qui est beau et bon; il est mâle, hardi, persévérant, chasseur habile, toujours machinant quelque artifice, désireux de savoir et apprenant avec facilité, philosophant sans cesse, enchanteur, magicien, sophiste. De sa nature, il n'est ni mortel ni immortel. Mais, dans le même jour, il est florissant et plein de vie, tant qu'il est dans l'abondance, puis il s'éteint, pour revivre encore par l'effet de la nature paternelle. Tout ce qu'il acquiert lui échappe sans cesse, en sorte qu'il n'est jamais ni riche ni pauvre. Il tient aussi le milieu entre la sagesse et l'ignorance, car aucun dieu ne philosophe ni ne désire devenir sage, puisque la sagesse est le propre de la nature divine; et, en général, quiconque est sage ne philosophe pas. Il en est de même des ignorants : aucun d'eux ne philosophe ni ne désire devenir sage, car l'ignorance a précisément le fâcheux effet de persuader ceux qui ne sont ni beaux, ni bons, ni sages, qu'ils possèdent ces qualités ; or nul ne désire les choses dont il ne se croit point dépourvu.
SOCRATE. — Mais, Diotime, qui sont donc ceux qui philosophent, si ce ne sont ni les sages ni les ignorants.
DIOTIME. — Il est évident, même pour un enfant, dit-elle, que ce sont ceux qui tiennent le milieu entre les ignorants et les sages, et l'Amour est de ce nombre. La sagesse est une des plus belles choses du monde ; or l'Amour aime ce qui est beau ; en sorte qu'il faut conclure que l'Amour est amant de la sagesse, c'est-à-dire philosophe, et, comme tel, il tient le milieu entre le sage et l'ignorant. »
*
Hegel, à propos de Socrate
« Avec Socrate, au début de la guerre du Péloponnèse, le principe de l'intériorité, l'indépendance absolue de la pensée en soi, est parvenu à s'exprimer librement. n enseignait que l'homme devait trouver et reconnaître en lui-même ce qui est juste et bien et que par sa nature ce juste et ce bien est universel. Socrate est célèbre comme maître de morale ; mais bien plus, il a inventé la morale. Les Grecs ont eu de la moralité, mais les vertus, les devoirs moraux, voilà ce que voulait leur enseigner Socrate. L'homme moral n'est pas celui qui veut et qui fait le bien, ce n'est pas seulement l'homme innocent, mais celui qui a conscience de son action. En appelant Sagesse la conviction qui détermine l'homme à agir, Socrate a attribué au sujet, à l'encontre de la patrie et de la coutume, la décision finale, se faisant ainsi oracle, au sens grec. Il disait qu'il avait en lui un "daimon" qui lui conseillait ce qu'il devait faire et qui lui révélait ce qui était utile à ses amis. Le monde intérieur de la subjectivité en paraissant a provoqué la rupture avec la réalité. Si Socrate lui-même, il est vrai, accomplissait encore ses devoirs de citoyen, la vraie patrie pour lui n'était pas cet État actuellement existant et la religion de celui-ci, mais le monde de la pensée. Alors fut soulevée la question de l'existence des dieux et de leur nature. »
Quelques mots de commentaire...
Extrait des Leçons sur la Philosophie de l'histoire, ce texte de Hegel commence précisément par une référence explicite à l'histoire grecque, comme pour signifier que les progrès de la conscience humaine s'inscrivent dans le temps. Il y est question de l'apparition du "sujet" avec Socrate. Le texte insiste sur l'indépendance de la pensée et sur la fondation de la morale dans l'intériorité. On remarque que Hegel aborde la question de l'intériorité au moyen d'un lexique essentiellement moral : justice, bien, devoirs, moralité, conscience…. Hegel expose la thèse d'une rupture, survenue historiquement avec Socrate et dans la pensée de celui-ci, entre la pensée extérieure, sociale ou culturelle, et la pensée intérieure qui fonde la vraie morale : seul le sujet autonome est en même temps un homme moral. Associer la liberté et la morale ne va pas de soi. Il faut démontrer que la subjectivité est porteuse de rationalité et donc d'universalité. L'enjeu essentiel – comme le signale la fin du texte - pourrait bien être d'opposer la sagesse philosophique intérieure à l'autorité religieuse purement sociale.
Hegel pose les principes d'une autonomie du sujet, d'abord dans l'intériorité ; une vie invisible, immatérielle… mais bien réelle. Hegel ne fait pas demi-mesure puisqu'il évoque "l'indépendance absolue de la pensée en soi". Les pensées sont des représentations mentales. Est "absolu" ce qui précisément ne dépend de rien d'autre pour s'affirmer. Certaines formes d'indépendance ne peuvent être que relatives. Or Hegel soutient que l'indépendance absolue de la pensée est le principe même de l'intériorité. On ne parlerait pas d'intériorité si l'âme était influençable par la première cause extérieure (physique) venue…
Puis Hegel fait dériver du concept d'autonomie le concept de sagesse, c'est-à-dire au fond l'usage de la raison. Le sujet qui se sait indépendant par la pensée possède des convictions, c'est-à-dire des pensées qu'il tient pour vraies et certaines, en fonction de quoi il se décide à agir. Alors il "se fait oracle" car il annonce à lui-même ses propres décisions. Hegel fait référence au "daimon" personnel de Socrate, que celui-ci prétendait héberger en lui-même, bien que "daimon" n'était rien qu'une formule métaphorique pour désigner sa raison.
Hegel précise que le principe de l'intériorité est "parvenu à s'exprimer librement". On suppose donc qu'il était jusqu'ici "brimé", bridé, empêché par la société et ses contraintes. La dimension historique, événementielle, de l'apparition du sujet, est clairement affirmée. Mais l'indépendance de la pensée est-elle vraiment "absolue" ? L'antagonisme existant entre le sujet et la société (patrie et coutumes) est bien réel.
Hegel souligne d'ailleurs un autre antagonisme en réservant le terme de "morale" (avec "devoir", "vertu") pour la conscience personnelle, et en appelant "moralité" les mœurs et les coutumes sociales, auxquelles il suffit d'obéir pour être déclaré "innocent". Cette distinction des deux morales épouse l'opposition entre un monde extérieur social et un monde intérieur personnel. Les termes clefs sont ceux de "devoir" et de "conscience", car ils impliquent une activité réflexive du sujet. Le lien entre l'autonomie, la raison, et la morale se fait dans le concept d'universalité.
Mais Hegel va très loin en évoquant une "rupture avec la réalité". Comment peut-on rompre avec la réalité ? Dans sa propre logique Hegel soutient le pouvoir essentiellement "négateur" (c'est-à-dire d'abord libérateur) de la conscience. Le propre de cette logique est de présenter les oppositions (intériorité/réalité, morale/mœurs, etc.) comme étant positives et productives : l'histoire serait faite de ce genre de ruptures. Socrate refusait-il la réalité sociale de son temps ? Il le fallait bien pour s'inscrire dans une démarche philosophique établissant la primauté de la pensée. La religion n'échappe pas à l'examen critique de la raison, même si explicitement Socrate n'a jamais critiqué la religion de son temps (d'où le caractère d'autant plus injuste de sa condamnation).
L'essentiel de ce texte tient dans la relation directe qu'il établit entre l'intériorité, l'autonomie du sujet et la vertu morale revendiquée par le philosophe. En un sens, ce texte se contente de retracer objectivement ce qui s'est passé historiquement : l'apparition d'un homme exceptionnel, Socrate, ayant libéré le "sujet" en chaque homme. Il ne se contente pas d'enregistrer ce fait, il en souligne le caractère événementiel pour l'histoire de l'humanité. Socrate a-t-il vraiment "inventé" la morale ? Pour ce que nous en savons : oui ! On peut considérer la remarque finale sur les dieux comme l'apothéose du texte : la sagesse philosophique signe-t-elle son congé définitif à la foi religieuse ? Hegel suggère que la question fut soulevée… mais non réglée pour autant.
dm



