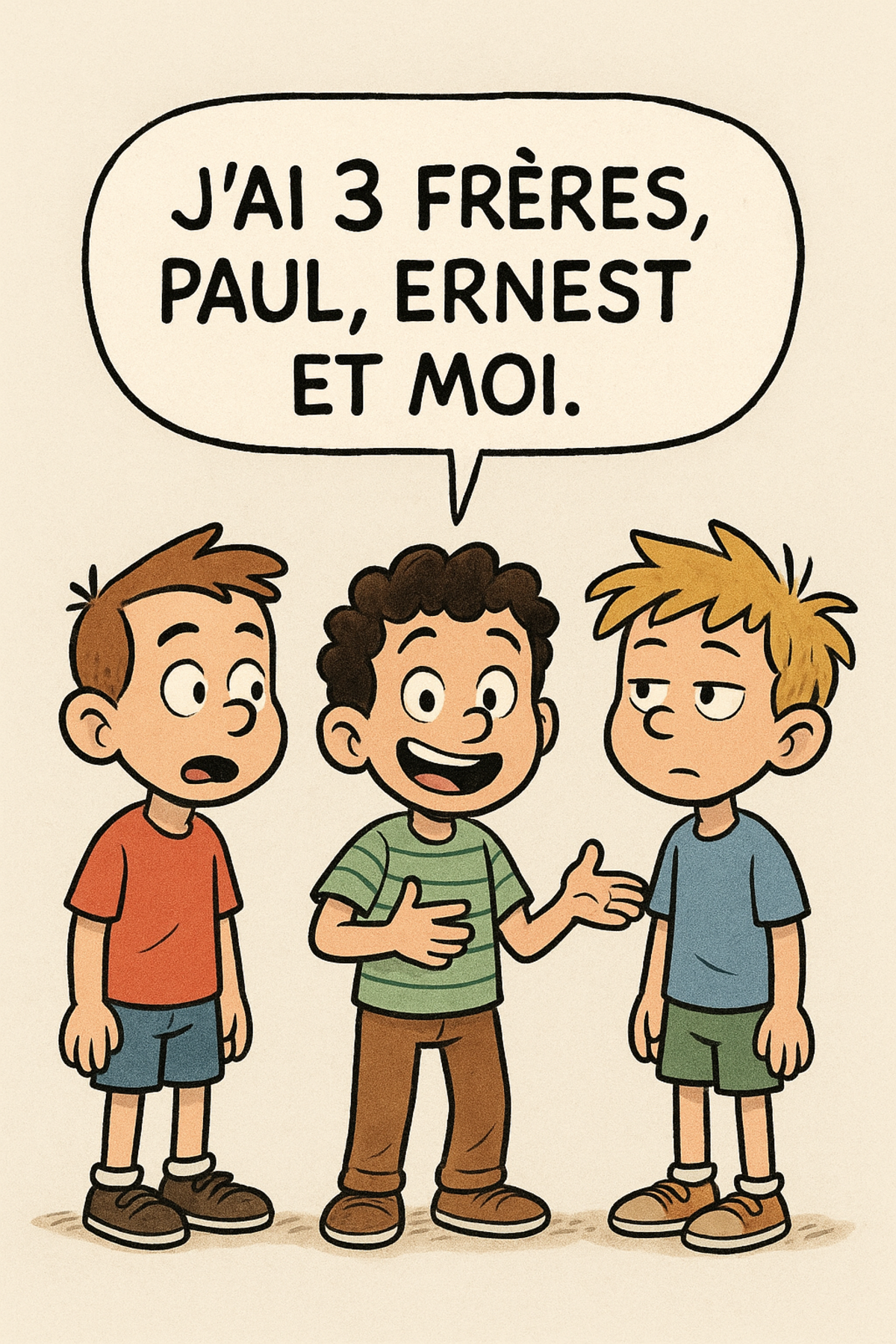
Agrandissement : Illustration 1
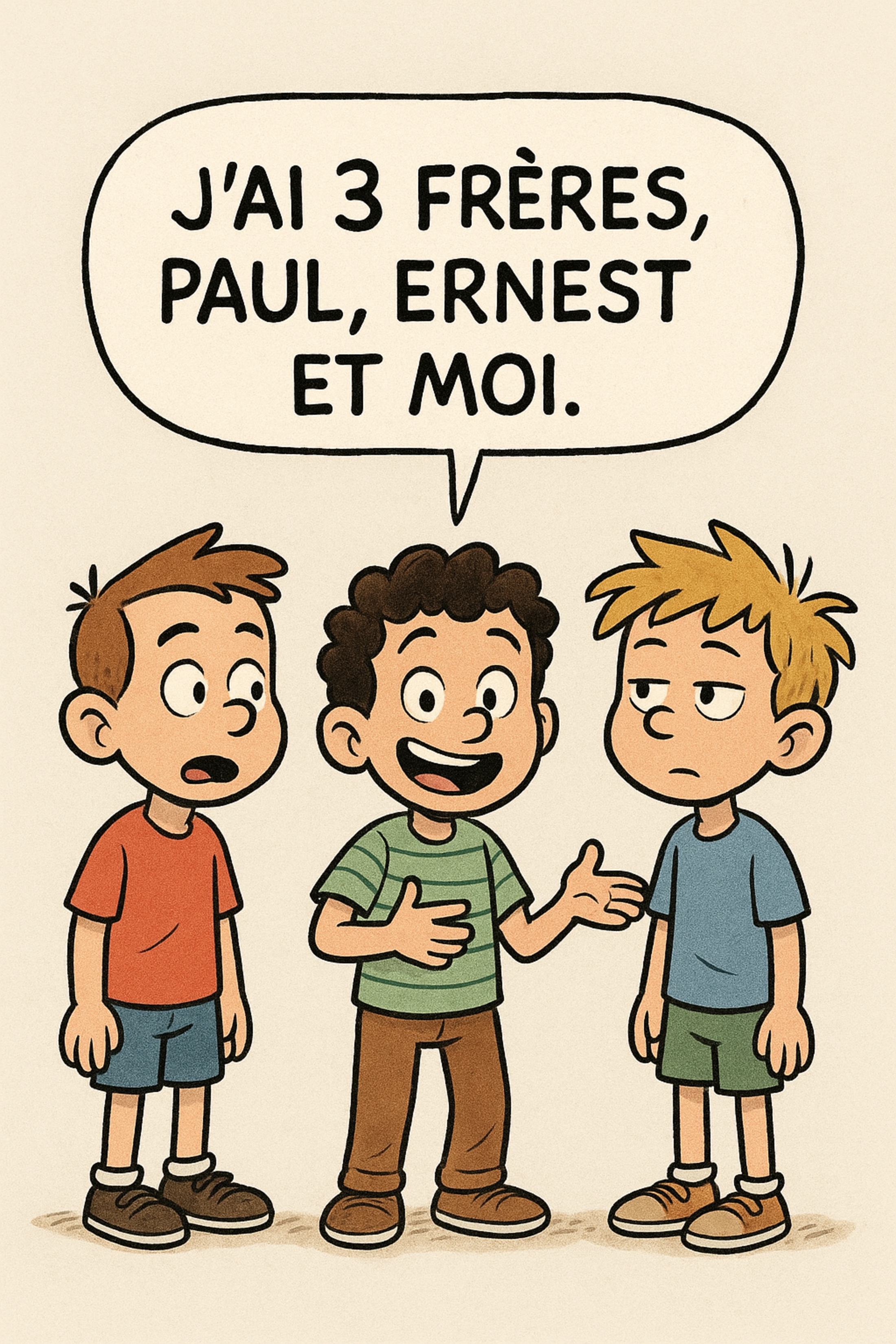
Partons de cette observation d'Emmanuel Kant : "Mais il est remarquable que l'enfant, qui sait déjà parler assez correctement, ne commence pourtant qu'assez tard (peut-être bien un an après) à dire Je ; jusque-là, il parlait de lui à la troisième personne (Karl veut manger, marcher, etc.) ; et il semble que pour lui ce soit comme une lumière qui vient de se lever, quand il commence à dire Je ; à partir de ce jour, il ne revient jamais à l'autre manière de parler. - Auparavant il ne faisait que se sentir, maintenant il se pense". (Anthropologie du point de vue pragmatique)
Si l'on parle d'identité personnelle, de conscience, etc., il faut supposer un processus d'identification intervenant dans le temps et impliquant nécessairement autrui. Le phénomène décrit par Kant ci-dessus correspond, après l'identification par l'image (cf. billet précédent sur le stade du miroir), à une identification par le langage ; après l'identification imaginaire (autour de 6 mois), place à l'identification symbolique (vers 3 ans). Elle intervient donc beaucoup plus tard avec l’acquisition du langage, et surtout avec la maîtrise des formes pronominales. Kant remarque que l’enfant jusque vers trois ans parle souvent de lui à la troisième personne, qu’il éprouve les pires difficultés à aligner d’un seul jet le pronom personnel sujet « je » et sa forme complément d’objet « me » ou « moi » : ainsi au lieu de « dire « je me suis fait mal », toto va dire « toto s’est fait mal ». Cette maîtrise une fois acquise n’est pas seulement formelle, logique et grammaticale, elle est sociale et existentielle. L’enfant devient conscient de lui-même et de son existence parmi d’autres : de même que “Je” doit s’articuler correctement dans la phrase avec les autres mots, “Je” doit tenir une place dans la société et tenir compte des autres (c’est l’époque de la scolarisation).
Notons que cette identification que l'on peut qualifier de "symbolique", par opposition à imaginaire, est surtout explicitement "logique" et "linguistique" ; elle reste secondaire par rapport à une première identification proprement symbolique (par le "trait unaire" comme le dit Lacan) intervenant au niveau de l'inconscient dès les premiers âges de la vie, dès que l'enfant entend qu'il est assujetti à la parole d'autrui, "parlé" avant même d'être parlant, et notamment appelé par son prénom. Trait unaire qui n’est pas seulement symbolique au sens linguistique : il est l’inscription minimale de la différence dans le symbolique, le signe du Un qui permet la série. C’est la marque de l’Autre sur le sujet, bien avant qu’il dise « je ».
Qu’est-ce que cela signifie, le fait que l’enfant maîtrise l’usage combiné du « je » et du « moi », sinon que son individualité jusque-là confuse au niveau linguistique (je et moi confondus) mais égocentrée à l’extrême psychologiquement, surprotégée socialement au sein du giron familial, désormais s’inscrit distinctement dans une chaîne bien ordonnée et différenciée qui est celle de la vie sociale, où le « moi » est sans cesse en butte aux autres moi, où les individus peuvent être des garçons… ou des filles (et la société nous le fait bien comprendre), où la joie le dispute à la tristesse, où la mort succède à la vie… Un jour un autre moi peut même apparaître au sein de la famille, un frère ou une sœur, une nouvelle existence que rien ne permettait d’anticiper. Un jour, l’enfant comprend même ce que veut dire « plus jamais » : un grand-père, une grand-mère peuvent mourir...
Amusons-nous, à la suite du célèbre logicien et philosophe Gottlob Frege (Sinn und Bedeutung, 1892), de la confusion de ce petit enfant décrivant ainsi sa fratrie : « J’ai trois frères, Paul, Ernest, et moi »... Frege utilise cet exemple pour illustrer l’ambiguïté grammaticale et logique du langage naturel — ici, le fait que la tournure « et moi » conduit à une contradiction ou à une absurdité si on la prend littéralement. Puis Jacques Lacan reprend cette phrase à plusieurs reprises, lui donnant une signification psychanalytique, pour montrer comment le sujet parlant s’inclut inconsciemment dans ce qu’il énonce, ce qui produit une faille, une contradiction — révélatrice du sujet divisé du langage. Donc le propos est différent : chez Frege, c’est une absurdité logique : le sujet ne peut être inclus dans l’ensemble dont il parle ; chez Lacan, c’est une vérité subjective : le « je » qui parle n’est jamais totalement celui qui est dit (« moi »). Lacan ne commente pas cette phrase d'un point de vue purement logique, encore moins d'un point de vue développemental ; il n'y voit pas seulement une erreur d’enfant mais un indice structural du langage, à savoir que dès qu’un sujet parle, il se divise. Le « je » de l’énonciation ne peut jamais se superposer au « moi » de l’énoncé — il y a toujours un reste, un écart.
Reprenons néanmoins la phrase sous l'angle plus classiquement psychologique - voire existentiel - que nous avions emprunté au début de notre exposé, à la suite de Kant. Bien entendu cet enfant a deux frères et non trois ! L’enfant devrait dire “Nous sommes trois frères” (ou bien « je suis l’un des trois frères »), mais il énonce “J’ai trois frères”, substituant le “Je” au “Nous” et le verbe "avoir" au verbe "être". Il ne parvient pas à se positionner correctement avec le verbe être, comme s’il n’était pas encore clairement conscient de son existence individuelle, à côté de celle des autres. En utilisant le verbe avoir, il devrait dire « j’ai deux frères », mais il dit « j’ai trois frères » : le caractère illogique (et amusant, pour nous) de cette réponse provient du fait que l’enfant se compte deux fois, donc de façon très égocentrique : une première fois en tant que sujet de cette phrase (le "sujet de l'énonciation", “Je”), une seconde fois en tant que l’un des trois objets de cette phrase, l’un des trois frères de cette famille (le "sujet de l'énoncé", désigné par “moi”). Le “je” et le “moi” ne sont pas coordonnés logiquement. L’enfant ne distingue pas, ni dans sa phrase ni par conséquent dans son esprit, le “je” qui pense et qui parle ici (en position de sujet), en train de compter ses frères, et le “moi” (en position d’objet) qu’il est également, en tant que frère lui-même…
Certes cette division est structurelle, si l'on en croit Lacan ; et certes il s’agit bien d’une confusion logique, au niveau de la phrase. Mais qu’est-ce que cela révèle de la psychologie, voire du statut social de l’enfant ? L’utilisation du verbe avoir, et le fait de se compter deux fois, montre simplement que l’enfant peine encore à se compter à égalité parmi ses frères, à partager avec eux sa place dans la famille et sans doute auprès des parents, et qu’il voit les choses encore de façon trop égocentrique comme s’il était le “centre du monde”, comme un enfant qui n’a pas encore acquis la maturité pour assumer une existence sociale partagée.
dm



