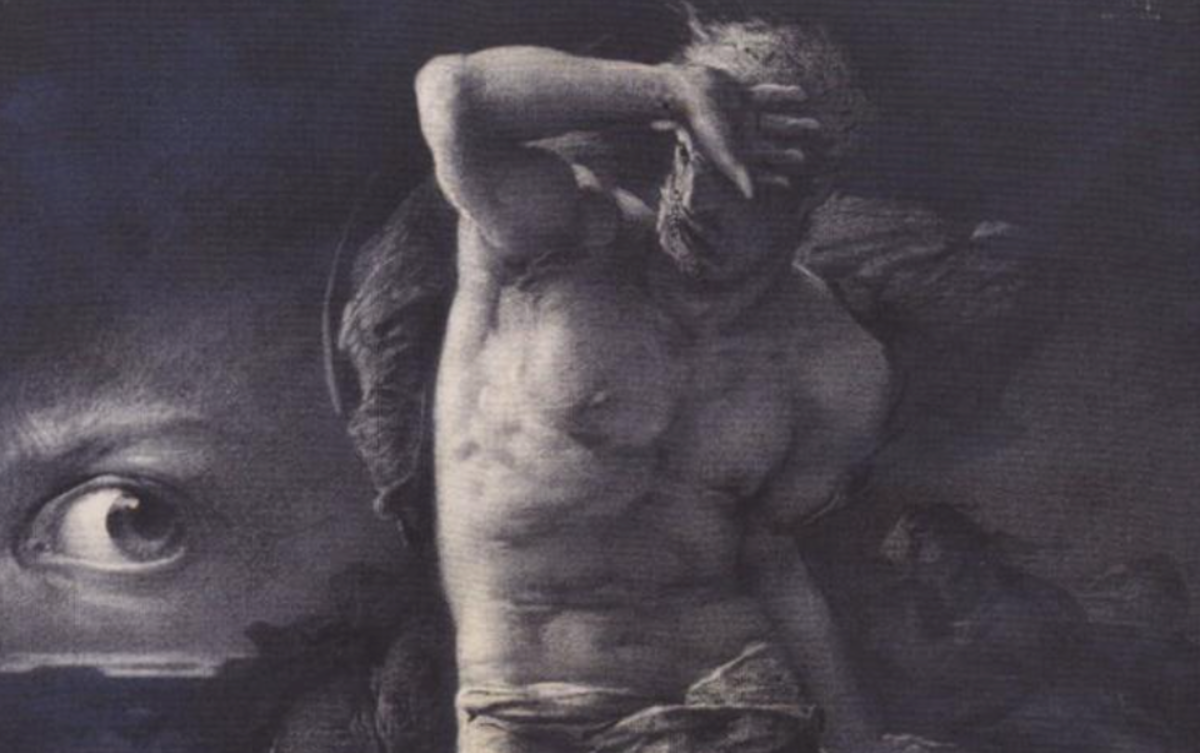
Agrandissement : Illustration 1

La "mauvaise conscience" : le remords est la face obscure de la conscience qui s'accuse elle-même. Le fait d'éprouver du remords, parce que l'on a fait du tort à autrui, réellement ou imaginairement, prouve au moins la présence d'une conscience. Mais de même que la "conscience malheureuse", au plan psychologique, doit être dépassée sur le chemin de la reconnaissance, la "mauvaise conscience" ne possède pas en elle-même le remède à sa propre souffrance. Celui qui s'accuse lui-même n'est guère plus avancé que celui qui ne s'accuse jamais, celui qui a "bonne conscience", comme on dit. Ce sont deux attitudes également "autistiques", deux rapports à soi (détestation de soi ou amour de soi) qui ignorent ou feignent d'ignorer que le principe de la vraie conscience morale réside dans le rapport à l'Autre et la reconnaissance d’autrui.
Qu'est-ce alors que la "conscience morale" ? C'est la connaissance de ce que l'on nomme en raccourci le "bien" et le "mal", plus précisément la conscience de ce l'on doit faire ou ne pas faire, en fonction de principes qui placent le respect de la loi et in fine de la personne humaine au-dessus des seuls intérêts personnels. Il s'agit d'une conscience pratique et non seulement théorique ; ce n'est pas seulement un savoir, mais surtout une volonté. Cette volonté est par définition personnelle, autonome (personne ne peut me "forcer" à vouloir), mais elle est quand même placée sous l'autorité d'un devoir qui, lui, implique une forme d'universalité. Il existe une sorte de "cogito" moral qui pourrait se décliner ainsi : je veux (faire ceci ou cela) parce que je le dois, et je le dois parce que l’Autre (l’Humain en général) me l’ordonne.
A la notion de conscience morale est associée la notion essentielle de responsabilité. La responsabilité est ce qui fait de moi, sur le plan moral, un sujet. Cela consiste à être conscient de ses actes, à "savoir ce que l'on fait" : d'abord se reconnaître soi-même comme l'auteur de l'acte (d’où l’expression « répondre de ses actes », verbe latin respondere), et ensuite reconnaître que nos actes peuvent nuire à autrui. Le contraire de cette reconnaissance (de soi, de ses actes) est la mauvaise foi ; la non-reconnaissance d’autrui est l’égocentrisme.
L’action suppose : une intention + une réalisation. A première vue, c’est l’élément intentionnel (la pensée) de l'acte qui s'avère être le siège de la conscience morale. Il convient de distinguer ici responsabilité morale et responsabilité pénale (juridique). Rappelons que la loi morale n’est pas écrite, à la différence de la règle de droit. L’intention de mal agir est condamnable par elle-même, moralement ; mais si elle n’est suivie d’aucune réalisation, elle n’est pas condamnable juridiquement (aux yeux de la loi).
Par exemple, l'intention de tuer n'est pas constitutive d’un meurtre ni même d’une tentative de meurtre – sauf bien sûr si un début de réalisation est manifeste (menacer avec une arme, par ex.). Inversement, la réalisation privée d'intention ne constitue pas non plus un acte également qualifié : le fait de donner la mort sans avoir l'intention de la donner ne constitue pas un meurtre, mais un homicide involontaire, c’est bien différent.
Mais si une intention pure ne constitue pas un acte, qu’est-ce qui doit être qualifié comme « bon » ou « mauvais » finalement : l’intention ou l’acte dans son ensemble ? Ce n’est pas toujours très clair. Il faut sans doute distinguer plus finement la simple « mauvaise pensée » (« j’ai envie de tuer untel » !) et l’intention qui, d’une certaine façon, dispose à agir, rend possible l’action (« je vais le tuer » !) en tant qu'elle mobilise la volonté, soit un certain effort de la pensée… Quoi qu’il en soit, si l'acte est un composé d'intention et de réalisation, il convient de ne pas attribuer à la pensée voire à l'intention seules le caractère moral de l'acte : ce serait trop facile ! Si une mauvaise intention en soi suffisait à constituer une faute, cela voudrait dire qu’une bonne intention seule suffirait à rendre un sujet vertueux… Or ne dit-on pas que "l'enfer est pavé de bonnes intentions" ? Nous retrouverions ici la figure décrite par Hegel de la « belle âme » : celle ou celui qui se pose en défenseur du Bien et de la morale, celui qui critique les mauvaises actions des autres sans agir le moins du monde lui-même… L'âme est "belle" parce qu'elle défend de beaux principes, et elle n'est pas souillée par l'action ; mais elle ne réalise pas que le fait de ne rien faire… constitue un acte à part entière, le plus souvent condamnable : laisser faire, c'est faire !
Posons maintenant la question de l'origine, de la genèse de la conscience morale. Serait-elle innée ? Comment se forme-t-elle ? Si l'on a reconnu l'autonomie (venant de soi) de la volonté morale, on a indiqué également que sa source, son origine (en rapport d'ailleurs avec sa finalité) devait être l'Autre, ou Autrui, donc l’hétéronomie. Il faut bien que, d'une manière ou d'une autre, l'on m'ait intimé l'ordre : "fais ceci, car c'est bien", pour que j'en sois venu à me l'ordonner moi-même. Quelle est donc l'origine de la conscience morale ? Pourquoi certains individus semblent totalement dépourvus de conscience morale ? Est-elle d'origine naturelle ou sociale ? Résumons trois thèses en la matière, pour faire vite.
1) Jean-Jacques Rousseau prétend trouver les principes de la moralité (c’est-à-dire la conscience morale) “au fond de mon cœur, écrits en caractères ineffaçables” ; c’est une “voix intérieure” qui est un “principe inné de justice et de vertu”."Inné" ne doit pas être pris ici au sens biologique, comme aujourd'hui, mais plutôt comme une disposition naturelle qui ne demande qu'à éclore (ou pas !). Elle dérive de la faculté propre à l'être humain de s'identifier à son semblable et donc de compatir à ses malheurs : parce que je peux m'imaginer à sa place, et parce que j'ai une sensibilité, je ne veux pas naturellement de mal à autrui. Pour Rousseau, la conscience est à la fois la voix de Dieu et celle de la nature, et c’est parfois (paradoxalement) la société qui nous empêche de l’entendre.
« Conscience ! conscience ! instinct divin, immortelle et céleste voix ; guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre ; juge infaillible du bien et du mal, qui rends l'homme semblable à Dieu, c'est toi qui fais l'excellence de sa nature et la moralité de ses actions ; sans toi je ne sens rien en moi qui m'élève au-dessus des bêtes, que le triste privilège de m'égarer d'erreurs en erreurs à l'aide d'un entendement sans règle et d'une raison sans principe. Grâce au ciel, nous voilà délivrés de tout cet effrayant appareil de philosophie : nous pouvons être hommes sans être savants ; dispensés de consumer notre vie à l'étude de la morale, nous avons à moindres frais un guide plus assuré dans ce dédale immense des opinions humaines. Mais ce n'est pas assez que ce guide existe, il faut savoir le reconnaître et le suivre. S'il parle à tous les cœurs, pourquoi donc y en a-t-il si peu qui l'entendent ? Eh ! c'est qu'il nous parle la langue de la nature, que tout nous a fait oublier. La conscience est timide, elle aime la retraite et la paix ; le monde et le bruit l'épouvantent : les préjuges dont on la fait naître sont ses plus cruels ennemis ; elle fuit ou se tait devant eux : leur voix bruyante étouffe la sienne et l'empêche de se faire entendre ; le fanatisme ose la contrefaire, et dicter le crime en son nom. Elle se rebute enfin à force d'être éconduite ; elle ne nous parle plus, elle ne nous répond plus, et, après de si longs mépris pour elle, il en coûte autant de la rappeler qu'il en coûta de la bannir. » (Rousseau, Emile ou de l'éducation)
Pour Emmanuel Kant également, la conscience morale a un caractère inné ; mais là encore, ce n'est pas prendre au sens biologique, ni au sens d'instinct. Elle ne résulte pas de la sensibilité et de la pitié, elle est un a priori de la Raison pratique présente en chaque homme, qui lui indique par définition même le caractère universel des valeurs morales. Mais naturellement, se servir convenablement de sa raison, cela s’apprend.
Tous les auteurs soulignent l'importance de l'éducation dans la genèse du sens moral chez l'individu. Qu’elle soit logée dans le « cœur » ou dans la raison, ou même qu’elle résulte purement et simplement des conventions sociales, seule l’éducation peut faire apparaître au grand jour, progressivement, cette faculté de distinguer le bien du mal. Seulement, comment expliquer que certains individus apparemment "raisonnables" et bien éduqués se transforment, par exemple, en redoutables harceleurs (on sait que le phénomène touche également tous les milieux), voire en délinquants ou en criminels ? Les carences éducatives, ou même les facteurs sociologiques en général n'expliquent pas tout : les personnes "issues des milieux défavorisées" seraient-elles, au regard du sens moral, plus "fragiles" ou plus déficientes que les autres ? Cela reste à démontrer ! Cela reviendrait à confondre un peu vite éducation et instruction, et en outre, à rabattre la moralité (intérieure) sur les "bonnes manières" (extérieures).
D'où une troisième explication qui va ajouter à ces arguments une dimension affective profonde. Freud a assimilé la conscience morale à un aspect très particulier du psychisme qu'il a nommé le "Surmoi". Il le définit comme "l'intériorisation des interdits parentaux". Se pose alors la question de savoir comment cette intériorisation a pu s'effectuer. Freud situe ce processus à un niveau inconscient où l’affectif prime sur le rationnel. Pour l’enfant, il ne s’agit pas tant de « comprendre » ce que lui demande ou lui commande l’adulte, mais plutôt de le croire. Or à partir de quand l’adulte est-il crédible ? Freud n’articule pas clairement son concept de Surmoi avec l’éducation, il en souligne plutôt le caractère sévère et oppressant ; de sorte que ce Surmoi génère moins le vrai sens moral qu'un sentiment de culpabilité inconscient. Mais il nous oriente vers le fait que, au niveau de l’inconscient, intégrer des idéaux et des règles morales, passe par un mécanisme d’identification (de l’enfant à l’adulte) qui nécessite lui-même l’amour (pas n'importe lequel, pas l'amour possessif ou fusionnel !) et un contexte familial favorable.
Avec ce nouveau schéma explicatif, il devient plus facile de comprendre la cause d'une absence de conscience morale, par exemple chez ceux que la voix populaire nomme des "monstres". Des monstres immoraux, sans doute, mais qui ne l'ont pas toujours été - donc ne le sont point "par essence" -, qui furent probablement des enfants eux-mêmes maltraités, traumatisés, privés d'attention et d'affection (quelques fois ils en ont "trop reçu" et c'est pire), qui ont pu subir des drames familiaux terribles, bref des enfants qui pour toutes ces raisons n'ont pas pu et/ou su et/ou voulu trouver le "bon" chemin, celui qui conduit au respect de la loi et au respect d'autrui.
dm



