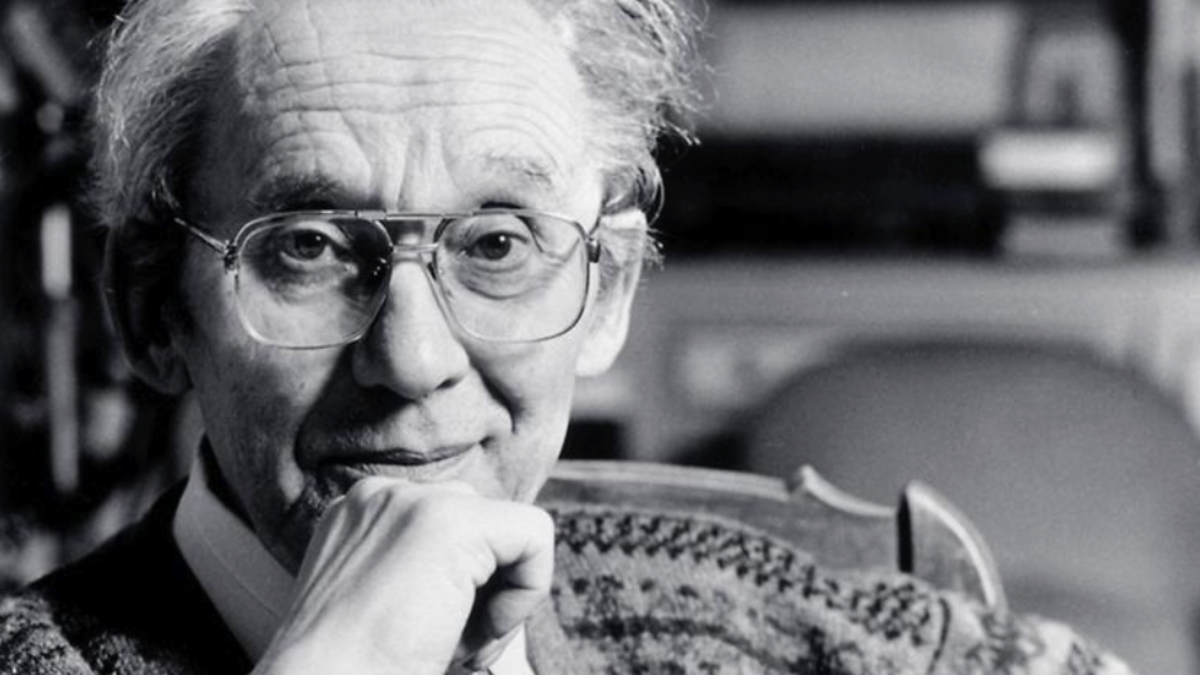
Agrandissement : Illustration 1
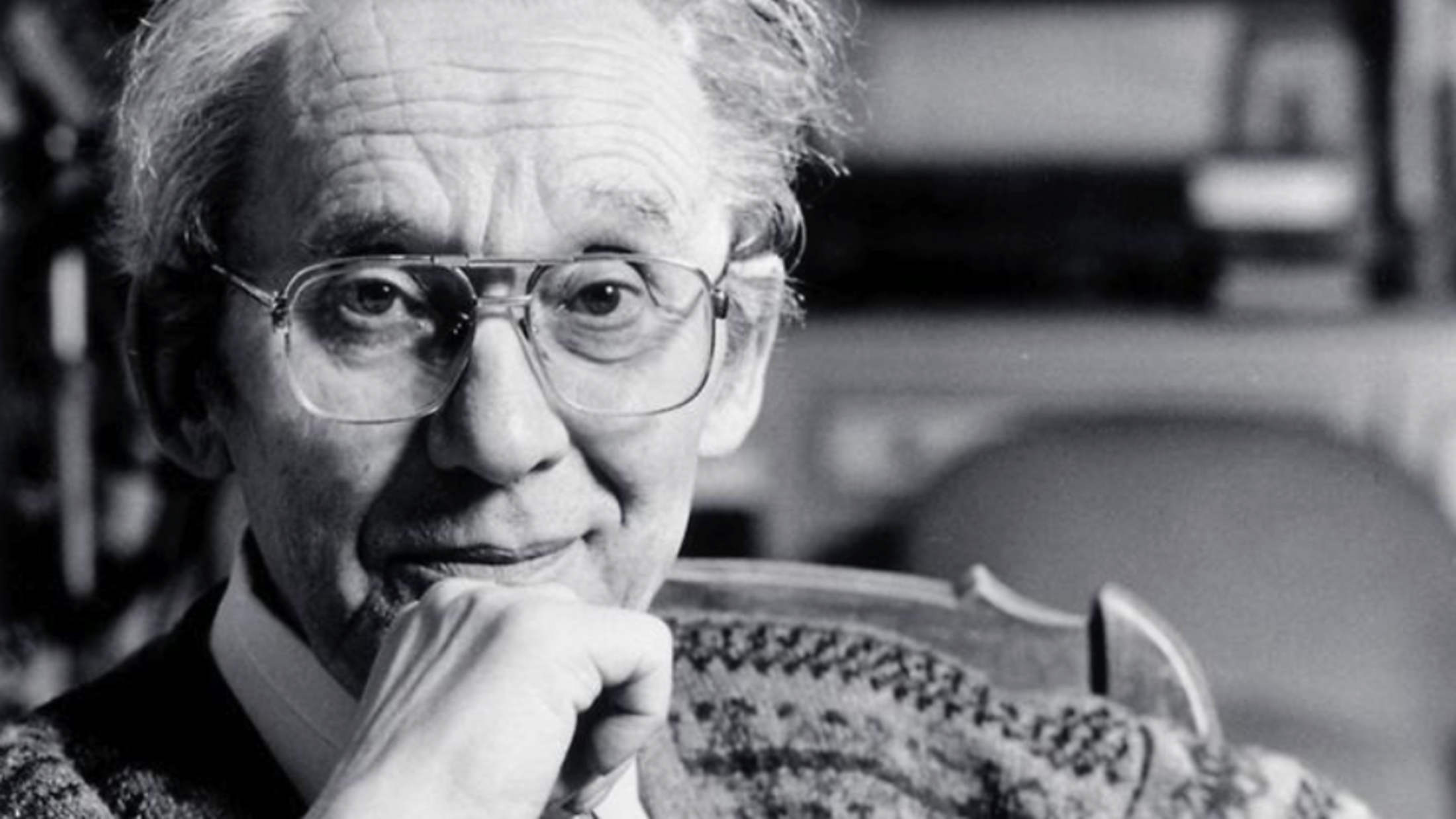
La conscience et l’identité mémorielle
Nous savons que le temps est le facteur déterminant de notre identité, parce que la « mêmeté » du « moi » suppose des représentations successives justement identiques : je suis le même moi, non parce que j’aurais toujours les mêmes qualités, mais parce toujours je rapporte ces qualités à un même « sujet ». Et à chaque fois je suis conscient de cette relation. Or ces représentations de soi successives se gravent dans la mémoire, c’est ce qui va former l’« identité mémorielle ».
Sans la mémoire (et sans la conscience de nos états passés) nous n’aurions aucune idée de notre identité. La mémoire se présente donc comme ce qui conditionne la cohésion de notre être, elle est l'artisane de notre identité personnelle. C’est ce que nous rappelle John Locke dans ce texte célèbre qui articule les deux processus de la conscience et de la mémoire pour déboucher sur l’identité.
« Lorsque nous voyons, que nous entendons, que nous flairons, que nous goûtons, que nous sentons, que nous méditons, ou que nous voulons quelque chose, nous le connaissons à mesure que nous le faisons. Cette connaissance accompagne toujours nos sensations et nos perceptions présentes : et c'est par là que chacun est à lui-même ce qu'il appelle soi-même. [...] Car puisque la conscience accompagne toujours la pensée, et que c'est là ce qui fait que chacun est ce qu'il nomme soi-même, et par où il se distingue de toute autre chose pensante : c'est aussi en cela seul que consiste l'identité personnelle, ou ce qui fait qu'un être raisonnable est toujours le même. Et aussi loin que cette conscience peut s'étendre sur les actions ou les pensées déjà passées, aussi loin s'étend l'identité de cette personne : le soi est présentement le même qu'il était alors : et cette action passée a été faite par le même soi que celui qui se la remet à présent dans l'esprit. » (J. Locke, Essai philosophique concernant l'Entendement Humain)
La personnalité et l’identité narrative
Le rôle de la mémoire est donc établi, mais il faut distinguer plusieurs sortes de mémoire. La mémoire dont on a parlé jusqu’ici n’est qu’une faculté qui assure la possibilité formelle d’une identité personnelle. Et certes nous rattachons consciemment à cette identité, à ce sujet, un certain nombre de traits, de caractères, de qualités que nous considérons comme fixes et permanents. Mais quid de la responsabilité de cette identité, au sens où être « responsable » (respondere en latin) revient non seulement à connaître mais à reconnaître cette identité, justement à travers le temps, à travers toute une vie. C’est ici que nous avons besoin d’un concept plus large d’identité que l’on nommera avec le philosophe français Paul Ricoeur (20è) « identité narrative ». Elle se définit comme la capacité de la personne de mettre en récit de manière concordante les événements de son existence. Un sujet ne se contente pas d’être « lui-même » formellement, il se doit d’entretenir cette identité, réellement, à travers le récit et l’interprétation qu’il donne de sa vie et des événements qui la composent. De ce fait il n’a pas seulement conscience de son identité mais, au-delà, de sa personnalité.
Car, à strictement parler, la permanence dans le temps de ce que je suis, au sens de l’identité mémorielle, ne permet pas de répondre à la question « qui suis-je ? », selon Ricoeur, mais plutôt « que suis-je ? ». Cette « seconde mémoire » est donc aussi ce qui nous relie à autrui. C’est ce qu'illustre la figure emblématique de la promesse dans laquelle j'engage d'abord qui je suis, dans mon rapport à autrui… au futur, et non ce que je suis dans le strict rapport à moi-même au présent. La seule mémoire de « ce que je suis » ne me permettrait pas d’honorer une promesse, que bien souvent je ne pourrais honorer dans le présent, et donc c'est précisément au-delà de « ce que je suis » aujourd'hui que je m'engage à tenir parole, associant cette parole à « qui je suis ».
Cette jeune femme disant à ce jeune homme : « je suis ta femme, et lorsque tu reviendras de voyage (ou de la maladie, de la guerre, etc.), nous serons unis », l’expression « je suis ta femme » affirme qu'elle est au-delà de ce qu’elle est, car une promesse est une anticipation impliquant une mémoire narrative (l’histoire que l’on se raconte) ainsi que le respect d’une parole donnée. Donc la vraie identité personnelle se manifeste concrètement et activement par le maintien volontaire de soi devant autrui, par la manière qu'a une personne de se comporter devant autrui notamment, telle qu'« autrui peut compter sur elle » dit Ricoeur.
La notion d’identité narrative repose sur l'idée que tout individu s'approprie « lui-même », voire se constitue, dans une narration de soi sans cesse renouvelée. Il ne s'agit pas d'une histoire objective, mais de celle que, scripteur et lecteur de ma propre vie, « je » me raconte sur moi-même. L'identité personnelle se constitue ainsi au fil des narrations qu'elle produit et de celles qu'elle intègre continuellement. Ce faisant, loin de se figer dans un noyau dur, le « je » se transforme à travers ses récits propres où le rapport avec autrui est déterminant. « En narrativisant la visée de la vraie vie, il lui donne les traits reconnaissables de personnages aimés ou respectés », écrit ainsi Ricœur (Soi-même comme un autre, 1990). L'identité n'est donc jamais parfaitement définitive, et de ce fait, elle permet d'enrichir la compréhension ordinaire de la personne désormais conçue comme un personnage qui lutte narrativement contre l'éparpillement de ses propres expériences vécues. Il est notable que ce récit peut prendre, dans une certaine mesure, la forme d’une fiction : jusqu’à quel point notre personnalité est-elle imaginaire ? Jusqu’au point, sans doute, où autrui valide ou invalide ce récit et nous force à le rectifier !
Approfondissements et débats
Pour comprendre la pertinence du concept d’identité narrative, il faut le replacer dans le cadre d’un débat classique sur l’identité personnelle opposant deux traditions philosophiques. La première, « métaphysique », fait porter l’identité sur les notions de « sujet » et de « substance » ; la seconde, « empiriste », nie la notion de substance et ne retient que les différentes perceptions qui donnent une impression (plutôt fausse) de permanence et d’identité. Petit rappel. Aristote avait défini la substance (d’un être, d’une chose en général) comme étant ce qui demeure, par-delà tous les accidents et les changements qui peuvent survenir. L’identité se rapporte donc logiquement à la substance. Mais quel rapport entre la substance et le sujet ? Le mot « hypokeimenon » en grec désigne proprement le « sujet », ce qui se tient par-dessous, base et support de l’être, et c’est ce terme qui sera traduit par « subjectum » en latin et qui donnera le « sujet » en français. Or l’identité est rapportée généralement au « sujet », avec toujours cette idée d’un être doté d’une certaine permanence. De même qu’en grammaire, le « sujet » est ce terme (unique) dans la phrase auquel on va rapporter un nombre (variable) de qualités, ou d’actions. Puis au plan intellectuel et psychologique, ce sujet, cette subjectivité individuelle (ego) sera rapportée explicitement à la pensée (cogito) notamment par Descartes, qui n’hésitera pas à parler de « substance pensante » pour désigner l’âme.
C’est justement cette idée de substance pensante que contestent les empiristes. Par exemple, le texte de John Locke cité plus haut relève de l’empirisme, car même s’il semble accepter la notion d’identité, c’est en la rapportant à ces facultés que sont la conscience et à la mémoire et non à l’âme en tant que substance. Un autre philosophe anglais et empiriste, tel que David Hume (18è), sera plus radical et critiquera même la notion d’identité : « Il y a certains philosophes [Hume vise les cartésiens], qui imaginent que nous avons à tout moment la conscience intime de ce que nous appelons notre moi; que nous sentons son existence et sa continuité d’existence; et que nous sommes certains, plus que par l’évidence d’une démonstration, de son identité et de sa simplicité parfaites. Pour ma part, quand je pénètre le plus intimement dans ce que j’appelle moi, je bute toujours sur une perception particulière ou sur une autre, de chaud ou de froid, de lumière ou d’ombre, d’amour ou de haine, de douleur ou de plaisir. Je ne peux jamais me saisir, moi, en aucun moment sans une perception et je ne peux rien observer que la perception. ». Si bien que le philosophe empiriste réduit la « permanence de soi-même » à une simple croyance, relayée par la mémoire et l’imagination.
La notion d’identité narrative, promue par Ricoeur, vise à surmonter ce conflit entre métaphysiciens et empiristes ; elle cherche à établir une vraie permanence de l’identité personnelle fondée sur le récit de soi.
dm



