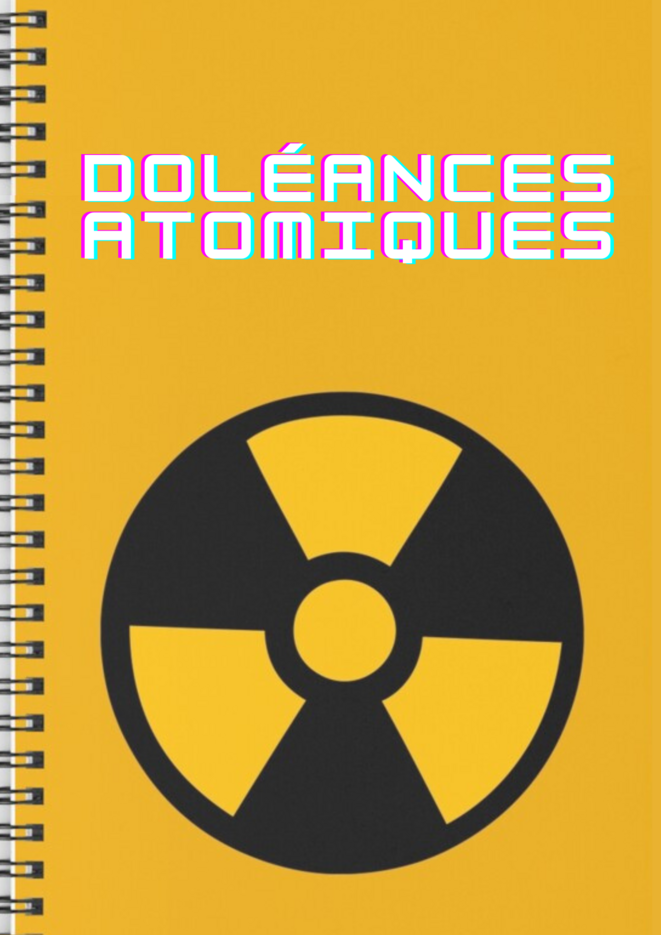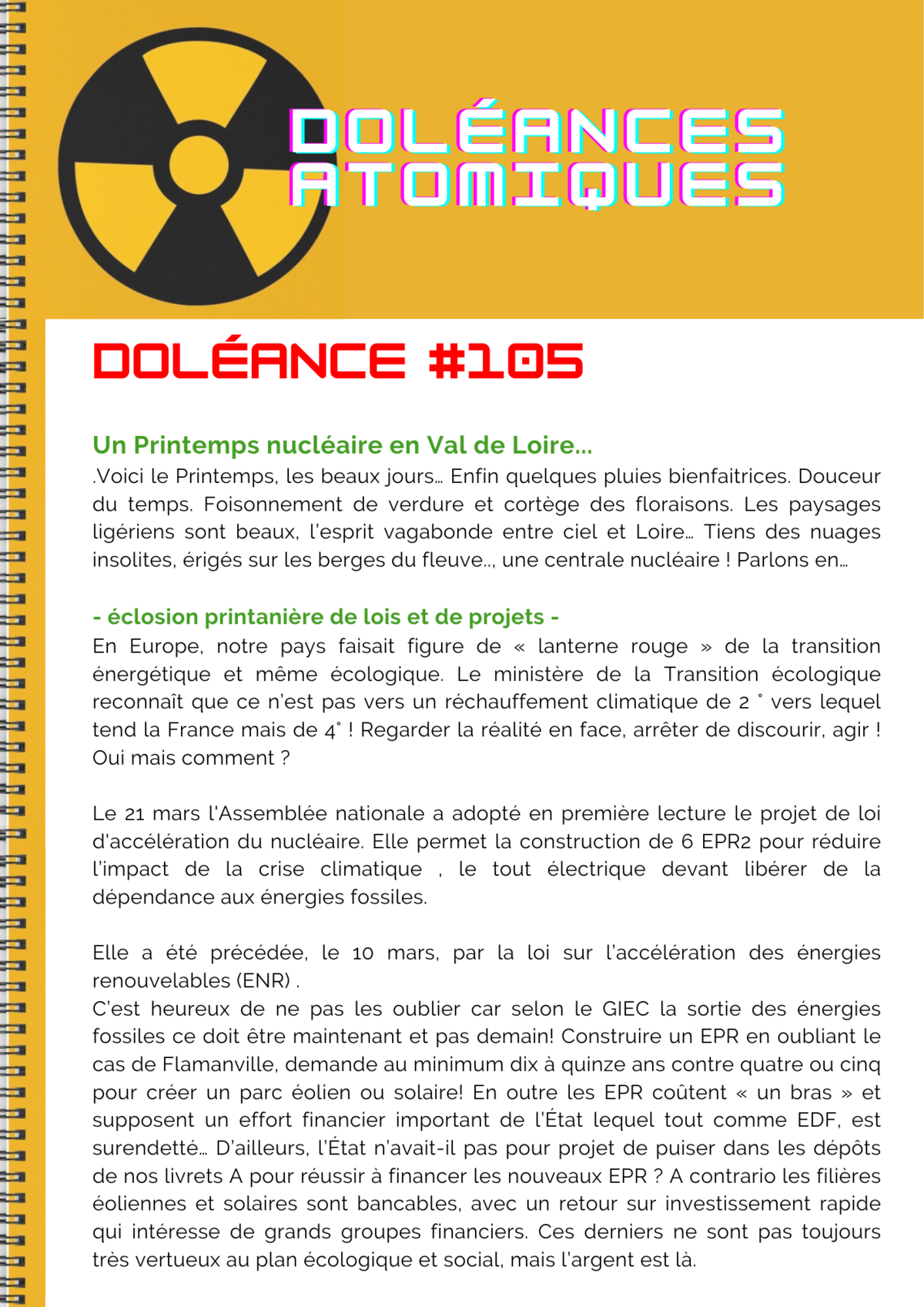
Agrandissement : Illustration 1
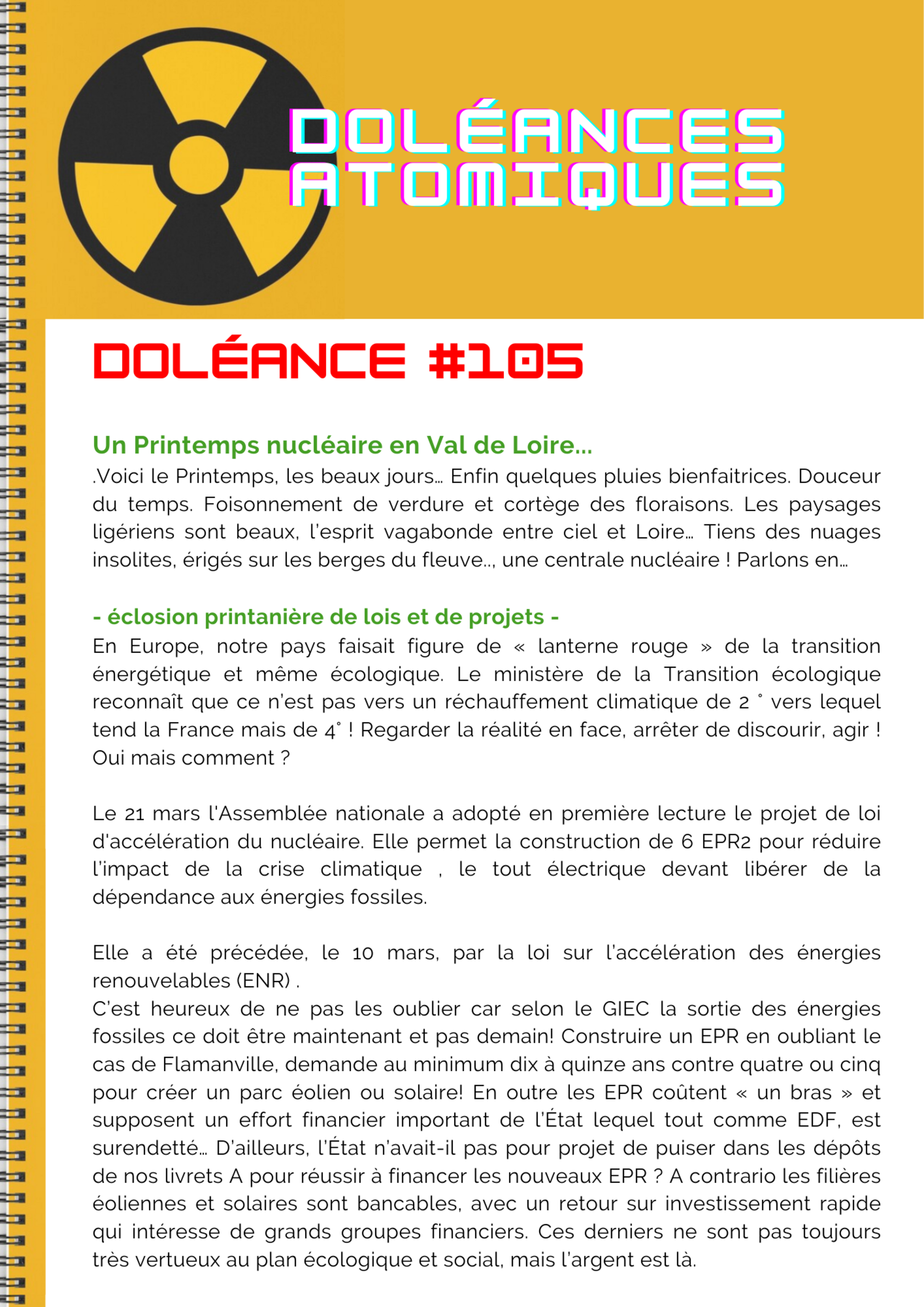

Agrandissement : Illustration 2
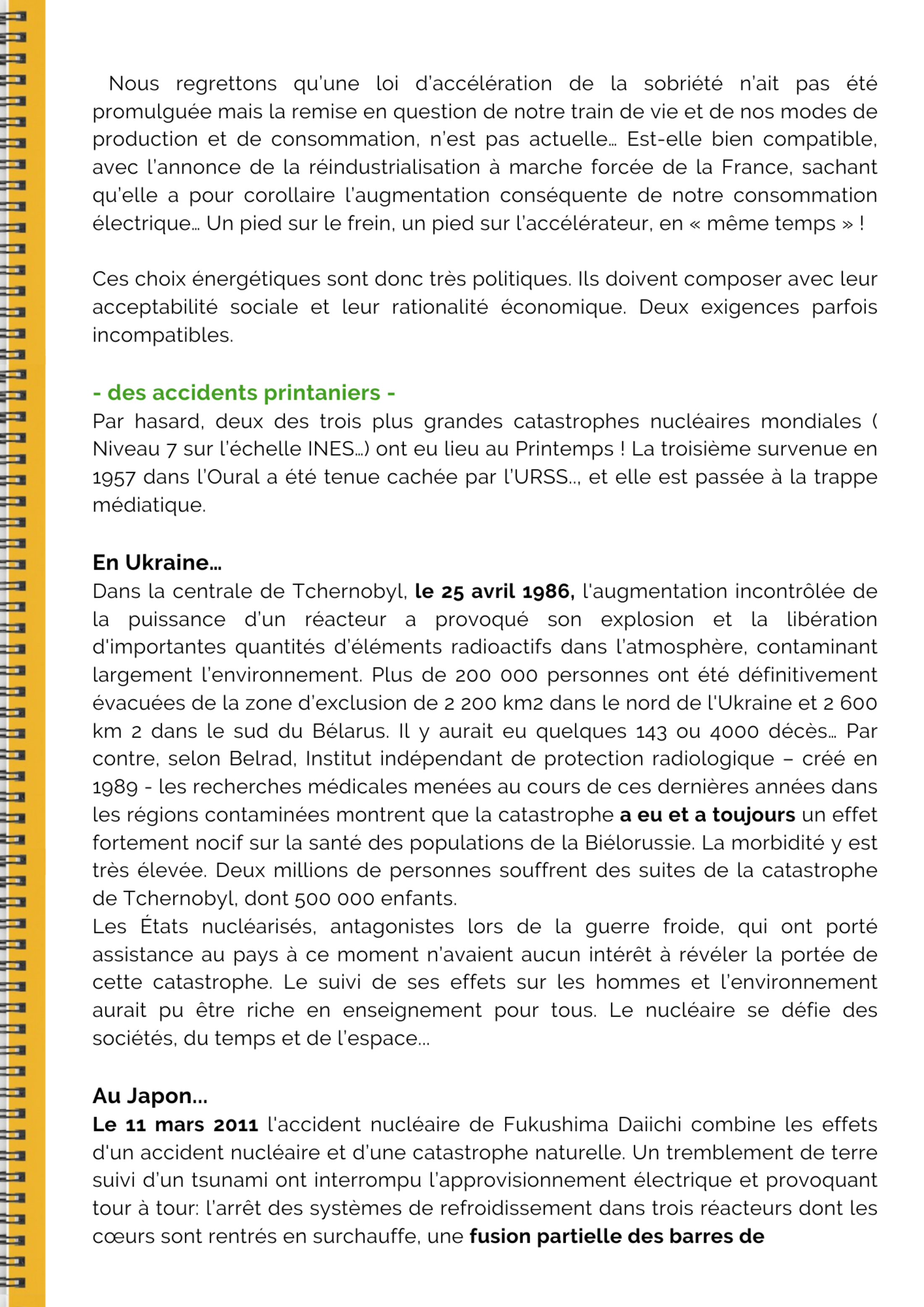
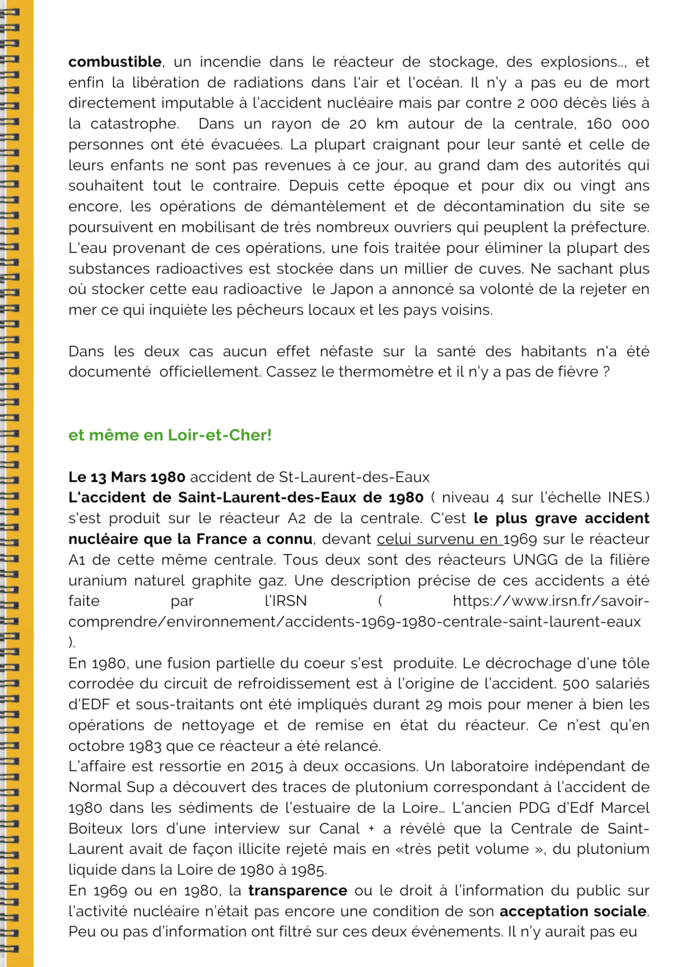
Agrandissement : Illustration 3
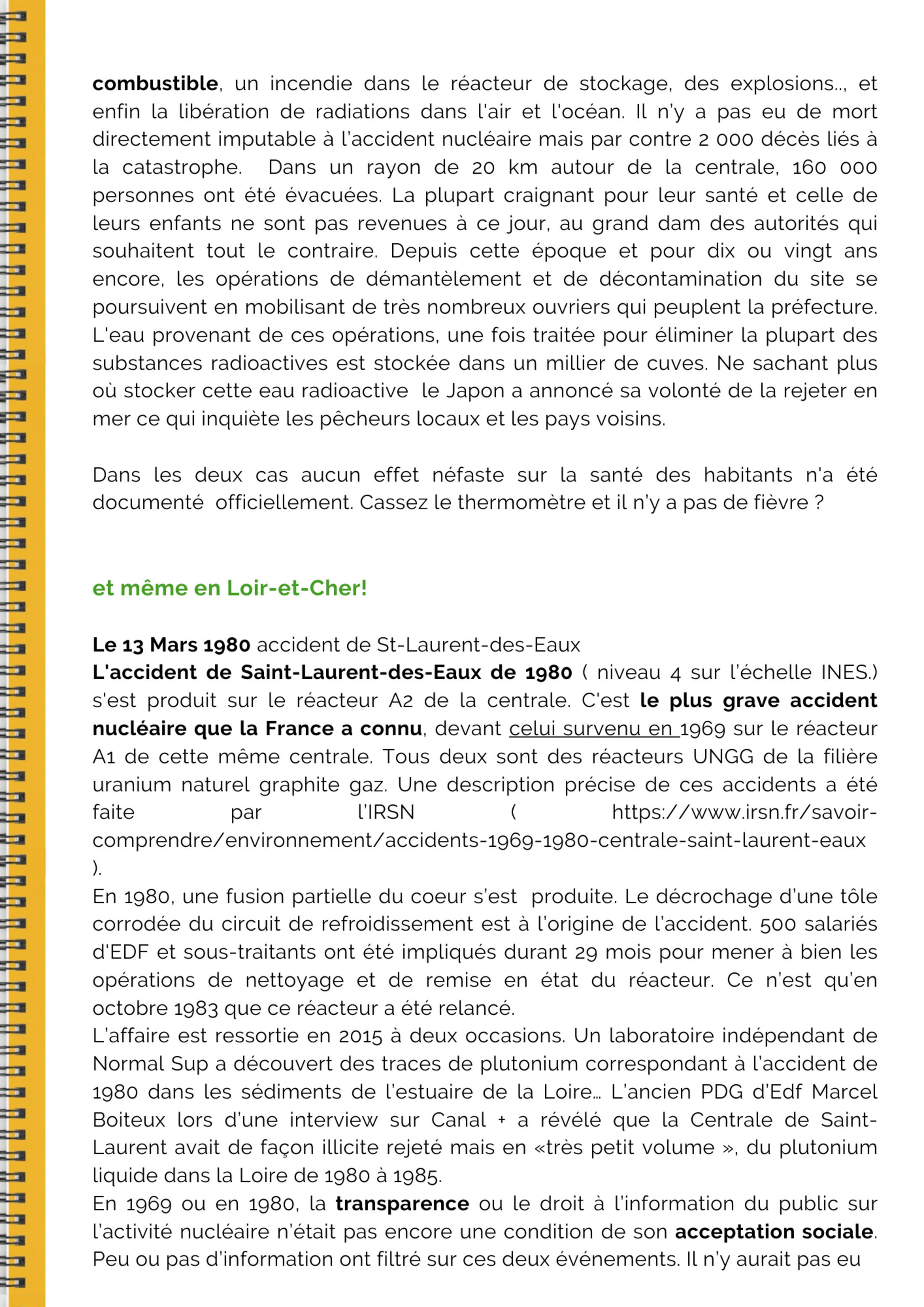
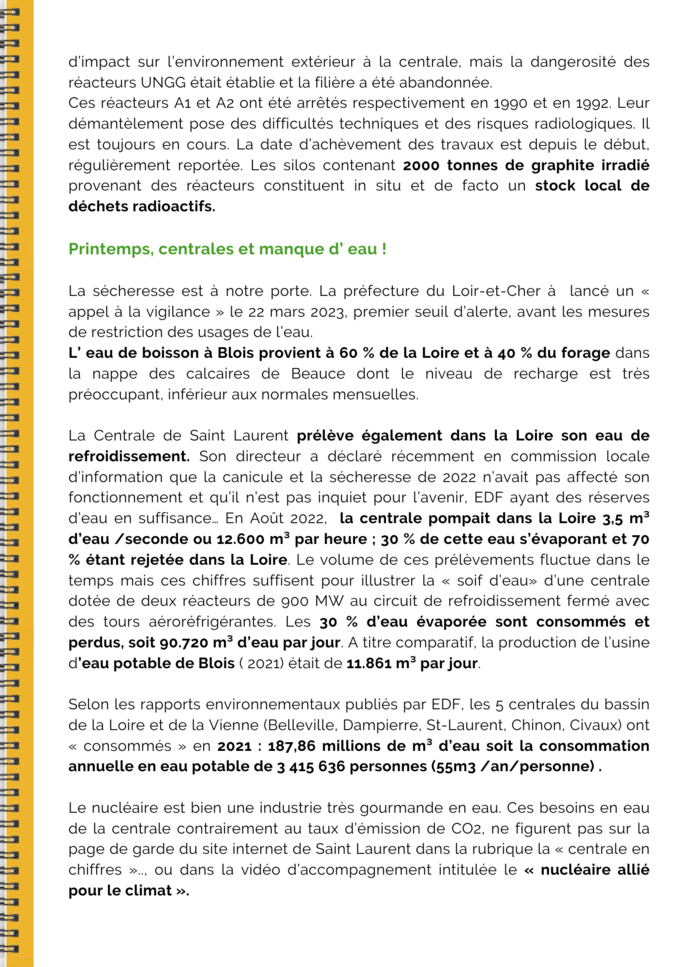
Agrandissement : Illustration 4
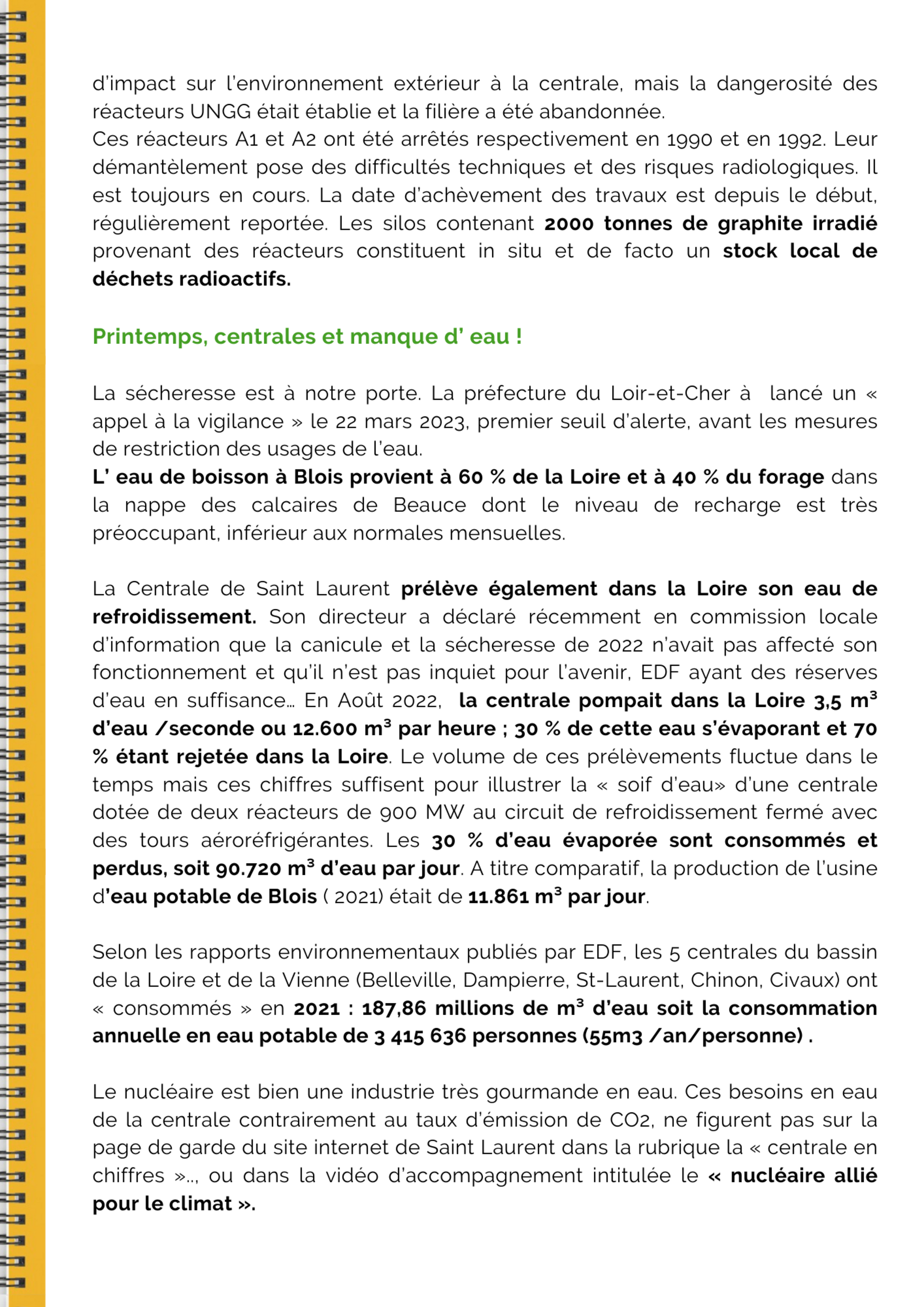
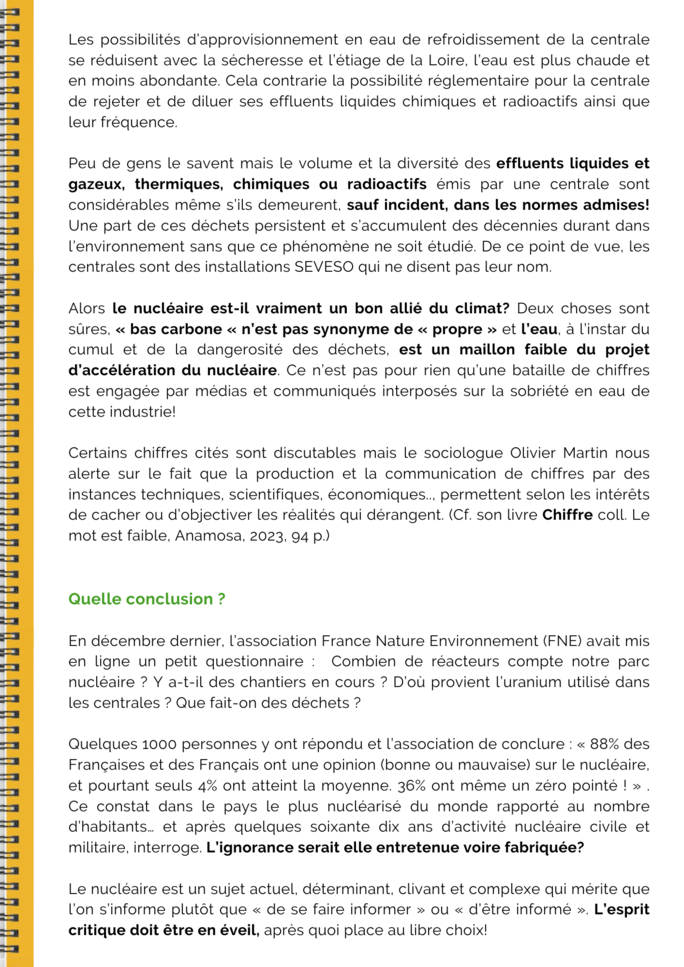
Agrandissement : Illustration 5
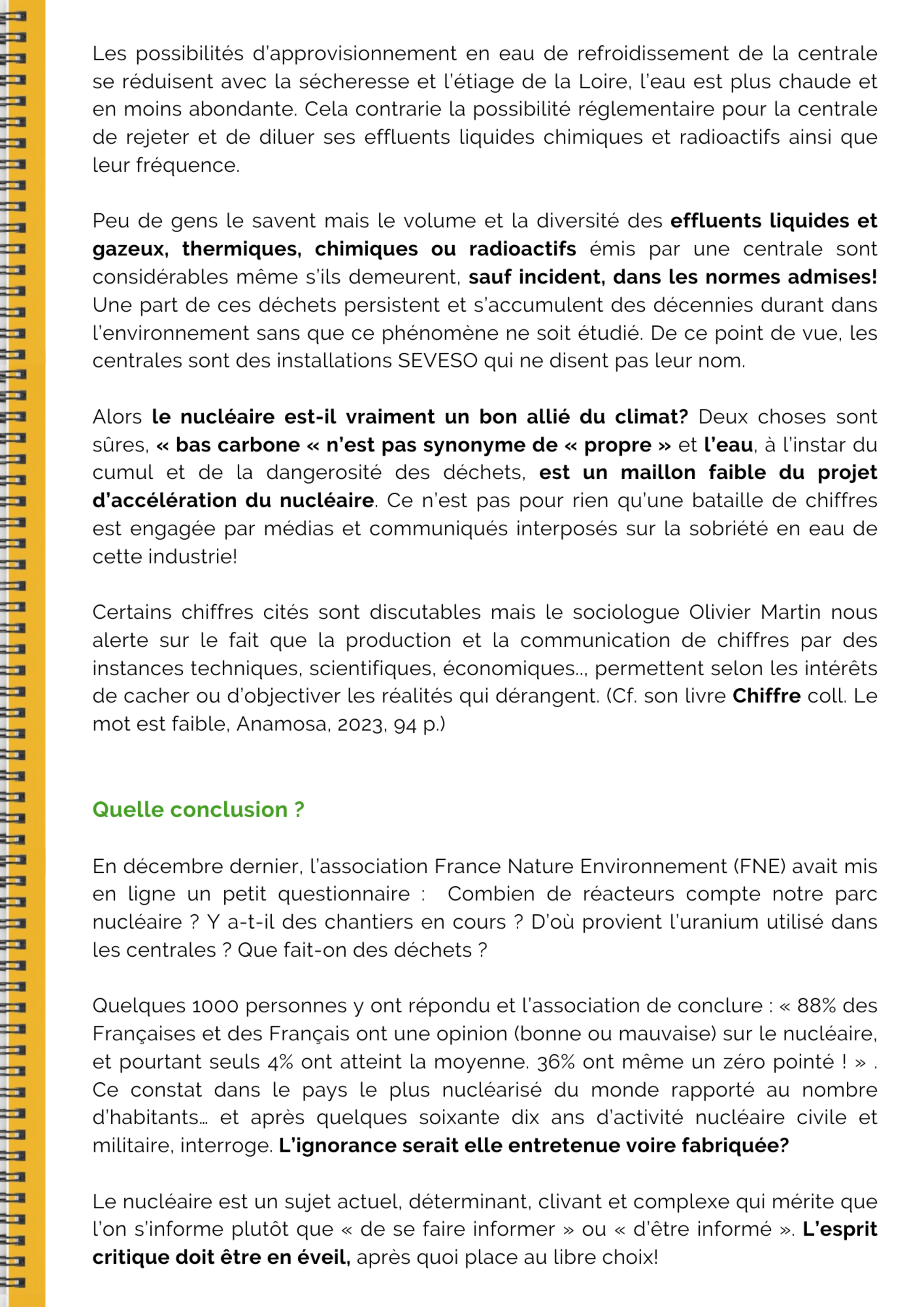
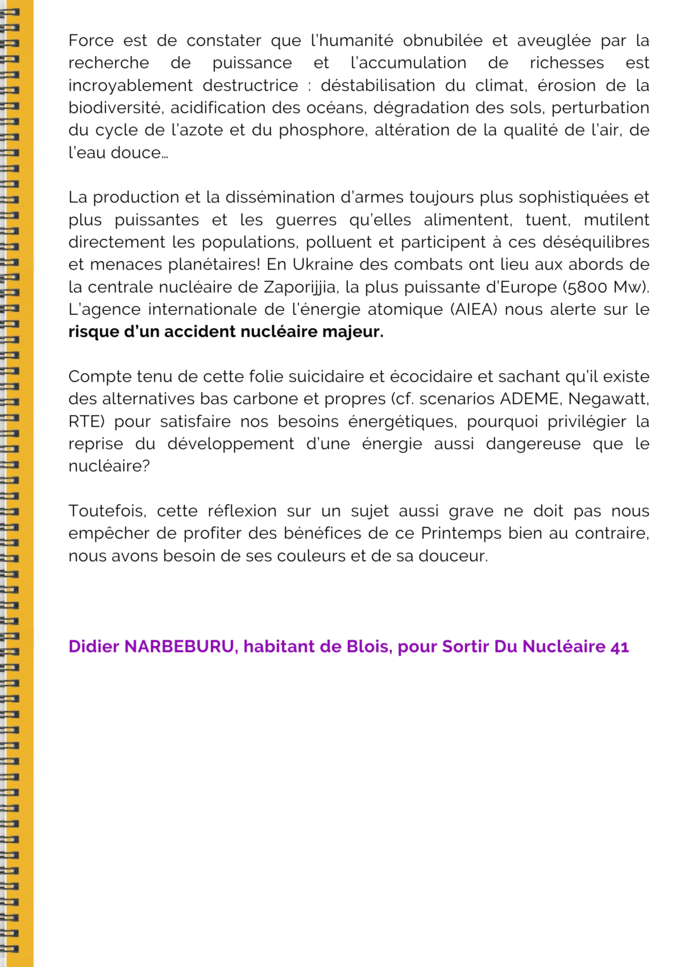
Agrandissement : Illustration 6
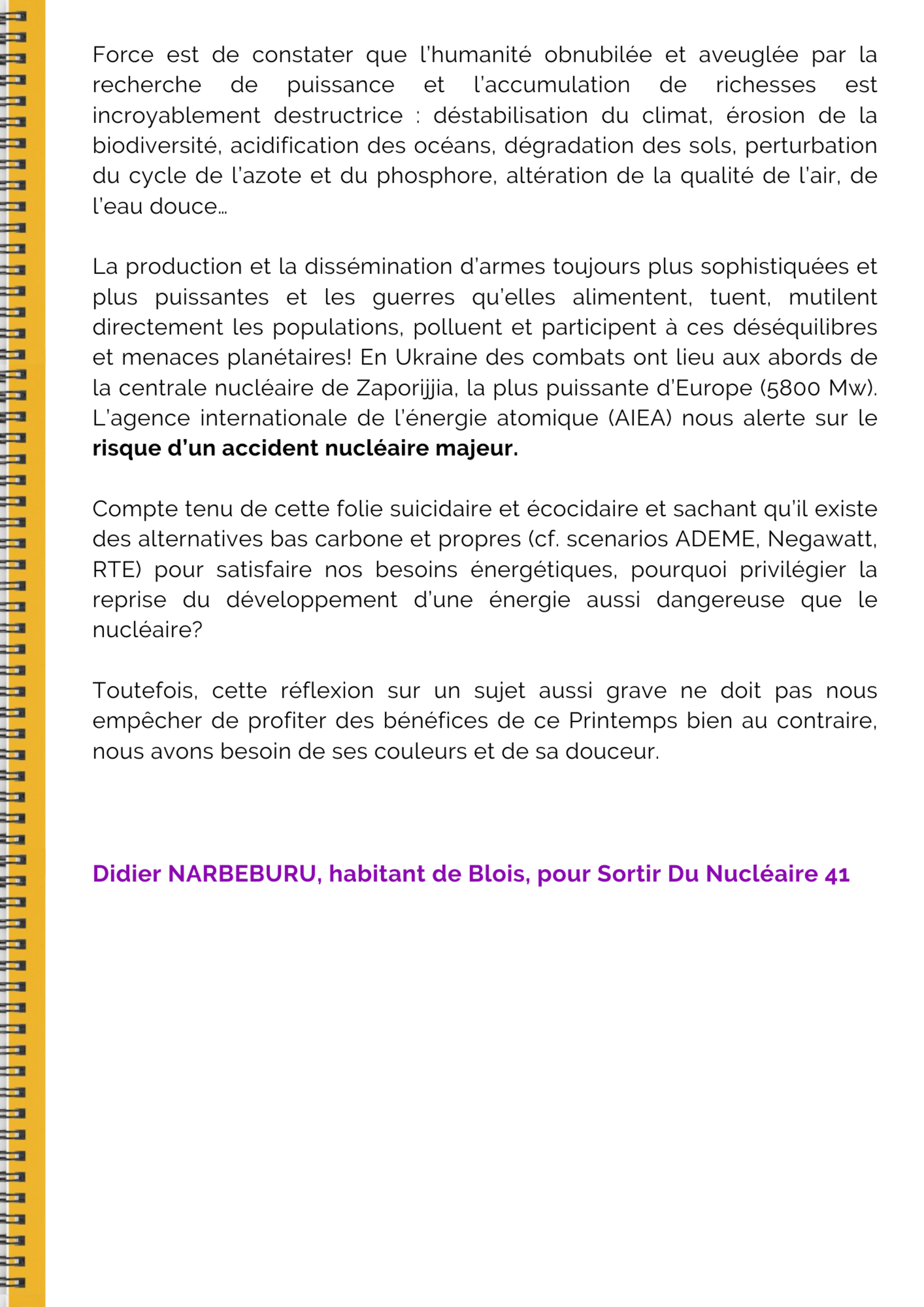
Un Printemps nucléaire en Val de Loire...
Voici le Printemps, les beaux jours… Enfin quelques pluies bienfaitrices. Douceur du temps. Foisonnement de verdure et cortège des floraisons. Les paysages ligériens sont beaux, l’esprit vagabonde entre ciel et Loire… Tiens des nuages insolites, érigés sur les berges du fleuve.., une centrale nucléaire ! Parlons en…
- éclosion printanière de lois et de projets -
En Europe, notre pays faisait figure de « lanterne rouge » de la transition énergétique et même écologique. Le ministère de la Transition écologique reconnaît que ce n’est pas vers un réchauffement climatique de 2 ° vers lequel tend la France mais de 4° ! Regarder la réalité en face, arrêter de discourir, agir ! Oui mais comment ?
Le 21 mars l'Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi d'accélération du nucléaire. Elle permet la construction de 6 EPR2 pour réduire l’impact de la crise climatique , le tout électrique devant libérer de la dépendance aux énergies fossiles.
Elle a été précédée, le 10 mars, par la loi sur l’accélération des énergies renouvelables (ENR) .
C’est heureux de ne pas les oublier car selon le GIEC la sortie des énergies fossiles ce doit être maintenant et pas demain! Construire un EPR en oubliant le cas de Flamanville, demande au minimum dix à quinze ans contre quatre ou cinq pour créer un parc éolien ou solaire! En outre les EPR coûtent « un bras » et supposent un effort financier important de l’État lequel tout comme EDF, est surendetté… D’ailleurs, l’État n’avait-il pas pour projet de puiser dans les dépôts de nos livrets A pour réussir à financer les nouveaux EPR ? A contrario les filières éoliennes et solaires sont bancables, avec un retour sur investissement rapide qui intéresse de grands groupes financiers. Ces derniers ne sont pas toujours très vertueux au plan écologique et social, mais l’argent est là.
Nous regrettons qu’une loi d’accélération de la sobriété n’ait pas été promulguée mais la remise en question de notre train de vie et de nos modes de production et de consommation, n’est pas actuelle… Est-elle bien compatible, avec l’annonce de la réindustrialisation à marche forcée de la France, sachant qu’elle a pour corollaire l’augmentation conséquente de notre consommation électrique… Un pied sur le frein, un pied sur l’accélérateur, en « même temps » !
Ces choix énergétiques sont donc très politiques. Ils doivent composer avec leur acceptabilité sociale et leur rationalité économique. Deux exigences parfois incompatibles.
- des accidents printaniers -
Par hasard, deux des trois plus grandes catastrophes nucléaires mondiales ( Niveau 7 sur l’échelle INES…) ont eu lieu au Printemps ! La troisième survenue en 1957 dans l’Oural a été tenue cachée par l’URSS.., et elle est passée à la trappe médiatique.
En Ukraine…
Dans la centrale de Tchernobyl, le 25 avril 1986, l'augmentation incontrôlée de la puissance d’un réacteur a provoqué son explosion et la libération d'importantes quantités d’éléments radioactifs dans l’atmosphère, contaminant largement l’environnement. Plus de 200 000 personnes ont été définitivement évacuées de la zone d’exclusion de 2 200 km2 dans le nord de l'Ukraine et 2 600 km 2 dans le sud du Bélarus. Il y aurait eu quelques 143 ou 4 000 décès… Par contre, selon Belrad, Institut indépendant de protection radiologique – créé en 1989 - les recherches médicales menées au cours de ces dernières années dans les régions contaminées montrent que la catastrophe a eu et a toujours un effet fortement nocif sur la santé des populations de la Biélorussie. La morbidité y est très élevée. Deux millions de personnes souffrent des suites de la catastrophe de Tchernobyl, dont 500 000 enfants.
Les États nucléarisés, antagonistes lors de la guerre froide, qui ont porté assistance au pays à ce moment n’avaient aucun intérêt à révéler la portée de cette catastrophe. Le suivi de ses effets sur les hommes et l’environnement aurait pu être riche en enseignement pour tous. Le nucléaire se défie des sociétés, du temps et de l’espace...
Au Japon…
Le 11 mars 2011 l'accident nucléaire de Fukushima Daiichi combine les effets d'un accident nucléaire et d’une catastrophe naturelle. Un tremblement de terre suivi d’un tsunami ont interrompu l’approvisionnement électrique et provoquant tour à tour: l’arrêt des systèmes de refroidissement dans trois réacteurs dont les cœurs sont rentrés en surchauffe, une fusion partielle des barres de combustible, un incendie dans le réacteur de stockage, des explosions.., et enfin la libération de radiations dans l'air et l'océan. Il n’y a pas eu de mort directement imputable à l’accident nucléaire mais par contre 2 000 décès liés à la catastrophe. Dans un rayon de 20 km autour de la centrale, 160 000 personnes ont été évacuées. La plupart craignant pour leur santé et celle de leurs enfants ne sont pas revenues à ce jour, au grand dam des autorités qui souhaitent tout le contraire. Depuis cette époque et pour dix ou vingt ans encore, les opérations de démantèlement et de décontamination du site se poursuivent en mobilisant de très nombreux ouvriers qui peuplent la préfecture. L'eau provenant de ces opérations, une fois traitée pour éliminer la plupart des substances radioactives est stockée dans un millier de cuves. Ne sachant plus où stocker cette eau radioactive le Japon a annoncé sa volonté dela rejeter en mer ce qui inquiète les pêcheurs locaux et les pays voisins.
Dans les deux cas aucun effet néfaste sur la santé des habitants n'a été documenté officiellement. Cassez le thermomètre et il n’y a pas de fièvre ?
et même en Loir-et-Cher!
Le 13 Mars 1980 accident de St-laurent-des-eaux
L'accident de Saint-Laurent-des-Eaux de 1980 ( niveau 4 sur l’échelle INES.) s'est produit sur le réacteur A2 de la centrale. C'est le plus grave accident nucléaire que la France a connu, devant celui survenu en 1969 sur le réacteur A1 de cette même centrale. Tous deux sont des réacteurs UNGG de la filière uranium naturel graphite gaz. Une description précise de ces accidents a été faite par l’IRSN ( https://www.irsn.fr/savoir-comprendre/environnement/accidents-1969-1980-centrale-saint-laurent-eaux ).
En 1980, une fusion partielle du coeur s’est produite. Le décrochage d’une tôle corrodée du circuit de refroidissement est à l’origine de l’accident. 500 salariés d'EDF et sous-traitants ont été impliqués durant 29 mois pour mener à bien les opérations de nettoyage et de remise en état du réacteur. Ce n’est qu’en octobre 1983 que ce réacteur a été relancé.
L’affaire est ressortie en 2015 à deux occasions. Un laboratoire indépendant de Normal Sup a découvert des traces de plutonium correspondant à l’accident de 1980 dans les sédiments de l’estuaire de la Loire… L’ancien PDG d’Edf Marcel Boiteux lors d’une interview sur Canal + a révélé que la Centrale de Saint-Laurent avait de façon illicite rejeté mais en «très petit volume », du plutonium liquide dans la Loire de 1980 à 1985.
En 1969 ou en 1980, la transparence ou le droit à l’information du public sur l’activité nucléaire n’était pas encore une condition de son acceptation sociale. Peu ou pas d’information ont filtré sur ces deux événements. Il n’y aurait pas eu d’impact sur l’environnement extérieur à la centrale, mais la dangerosité des réacteurs UNGG était établie et la filière a été abandonnée.
Ces réacteurs A1 et A2 ont été arrêtés respectivement en 1990 et en 1992. Leur démantèlement pose des difficultés techniques et des risques radiologiques. Il est toujours en cours. La date d’achèvement des travaux est depuis le début, régulièrement reportée. Les silos contenant 2000 tonnes de graphite irradié provenant des réacteurs constituent in situ et de facto un stock local de déchets radioactifs.
Printemps, centrales et manque d’ eau !
La sécheresse est à notre porte. La préfecture du Loir-et-Cher à lancé un « appel à la vigilance » le 22 mars 2023, premier seuil d’alerte, avant les mesures de restriction des usages de l’eau.
L’ eau de boisson à Blois provient à 60 % de la Loire et à 40 % du forage dans la nappe des calcaires de Beauce dont le niveau de recharge est très préoccupant, inférieur aux normales mensuelles.
La Centrale de Saint Laurent prélève également dans la Loire son eau de refroidissement. Son directeur a déclaré récemment en commission locale d’information que la canicule et la sécheresse de 2022 n’avait pas affecté son fonctionnement et qu’il n’est pas inquiet pour l’avenir, EDF ayant des réserves d’eau en suffisance… En Août 2022, la centrale pompait dans la Loire 3,5 m³ d’eau /seconde ou 12.600 m³ par heure ; 30 % de cette eau s’évaporant et 70 % étant rejetée dans la Loire. Le volume de ces prélèvements fluctue dans le temps mais ces chiffres suffisent pour illustrer la « soif d’eau» d’une centrale dotée de deux réacteurs de 900 MW au circuit de refroidissement fermé avec des tours aéroréfrigérantes. Les 30 % d’eau évaporée sont consommés et perdus, soit 90.720 m³ d’eau par jour. A titre comparatif, la production de l’usine d’eau potable de Blois ( 2021) était de 11.861 m³ par jour.
Selon les rapports environnementaux publiés par EDF, les 5 centrales du bassin de la Loire et de la Vienne (Belleville, Dampierre, St-Laurent, Chinon, Civaux) ont « consommés » en 2021 : 187,86 millions de m³ d’eau soit la consommation annuelle en eau potable de 3 415 636 personnes (55m3 /an/personne) .
Le nucléaire est bien une industrie très gourmande en eau. Ces besoins en eau de la centrale contrairement au taux d’émission de CO2, ne figurent pas sur la page de garde du site internet de Saint Laurent dans la rubrique la « centrale en chiffres ».., ou dans la vidéo d’accompagnement intitulée le « nucléaire allié pour le climat ».
Les possibilités d’approvisionnement en eau de refroidissement de la centrale se réduisent avec la sécheresse et l’étiage de la Loire, l’eau est plus chaude et en moins abondante. Cela contrarie la possibilité réglementaire pour la centrale de rejeter et de diluer ses effluents liquides chimiques et radioactifs ainsi que leur fréquence.
Peu de gens le savent mais le volume et la diversité des effluents liquides et gazeux, thermiques, chimiques ou radioactifs émis par une centrale sont considérables même s’ils demeurent, sauf incident, dans les normes admises! Une part de ces déchets persistent et s’accumulent des décennies durant dans l’environnement sans que ce phénomène ne soit étudié. De ce point de vue, les centrales sont des installations SEVESO qui ne disent pas leur nom.
Alors le nucléaire est-il vraiment un bon allié du climat? Deux choses sont sûres, « bas carbone « n’est pas synonyme de « propre » et l’eau, à l’instar du cumul et de la dangerosité des déchets, est un maillon faible du projet d’accélération du nucléaire. Ce n’est pas pour rien qu’une bataille de chiffres est engagée par médias et communiqués interposés sur la sobriété en eau de cette industrie!
Certains chiffres cités sont discutables mais le sociologue Olivier Martin nous alerte sur le fait que la production et la communication de chiffres par des instances techniques, scientifiques, économiques.., permettent selon les intérêts de cacher ou d’objectiver les réalités qui dérangent. (Cf. son livre Chiffre coll. Le mot est faible, Anamosa, 2023, 94 p.)
Quelle conclusion ?
En décembre dernier, l’association France Nature Environnement (FNE) avait mis en ligne un petit questionnaire : Combien de réacteurs compte notre parc nucléaire ? Y a-t-il des chantiers en cours ? D’où provient l’uranium utilisé dans les centrales ? Que fait-on des déchets ?
Quelques 1000 personnes y ont répondu et l’association de conclure : « 88% des Françaises et des Français ont une opinion (bonne ou mauvaise) sur le nucléaire, et pourtant seuls 4% ont atteint la moyenne. 36% ont même un zéro pointé ! » . Ce constat dans le pays le plus nucléarisé du monde rapporté au nombre d’habitants… et après quelques soixante dix ans d’activité nucléaire civile et militaire, interroge. L’ignorance serait elle entretenue voire fabriquée?
Le nucléaire est un sujet actuel, déterminant, clivant et complexe qui mérite que l’on s’informe plutôt que « de se faire informer » ou « d’être informé ». L’esprit critique doit être en éveil, après quoi place au libre choix!
Force est de constater que l’humanité obnubilée et aveuglée par la recherche de puissance et l’accumulation de richesses est incroyablement destructrice : déstabilisation du climat, érosion de la biodiversité, acidification des océans, dégradation des sols, perturbation du cycle de l’azote et du phosphore, altération de la qualité de l’air, de l’eau douce…
La production et la dissémination d’armes toujours plus sophistiquées et plus puissantes et les guerres qu’elles alimentent, tuent, mutilent directement les populations, polluent et participent à ces déséquilibres et menaces planétaires! En Ukraine des combats ont lieu aux abords de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus puissante d’Europe (5800 Mw). L’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) nous alerte sur le risque d’un accident nucléaire majeur.
Compte tenu de cette folie suicidaire et écocidaire et sachant qu’il existe des alternatives bas carbone et propres (cf. scenarios ADEME, Negawatt, RTE) pour satisfaire nos besoins énergétiques, pourquoi privilégier la reprise du développement d’une énergie aussi dangereuse que le nucléaire?
Toutefois, cette réflexion sur un sujet aussi grave ne doit pas nous empêcher de profiter des bénéfices de ce Printemps bien au contraire, nous avons besoin de ses couleurs et de sa douceur.
Didier NARBEBURU, habitant de Blois, pour Sortir Du Nucléaire 41