Ce que l’on remarque d’abord, au fond du café , c’est ce regard, bleu et ferme, qui rappelle celui d’Ella Maillart, fille de la montagne, elle aussi, autre versant des Alpes. Mais ce n’est pas en aventurière que Monique Rivet, 25 ans, a débarqué un jour de 1956 à Sidi bel Abbès. Encore que.

On rit beaucoup, avec cette dame au teint hâlé, souvent malicieuse, qui choisit ses mots sans se bousculer, s’apprête à prendre le volant pour rallier sa maison des Cévennes . Au programme, amitiés, marches et nage dans les torrents. Elle pensera, à sa façon, au cinquantenaire de l’Indépendance algérienne, qui l’a pourtant occupée une bonne moitié de l’année.
Le Glacis, ce livre ressurgi d’un tiroir cinquante ans après avoir été écrit, et qui relate la découverte de l’univers colonial dans sa version provinciale au moment de la guerre d'Algérie lui a valu pas mal de déplacements, de rencontres, d’émotions.
C’est bien opportun, cette parution, mmm, lui a dit une critique littéraire, légèrement suspicieuse. Eclat de rire. « J’ai passé l’âge de faire un coup ! ». Il s’agit d’autre chose, en fait. Un sentiment d’inachevé qui lui a fait ressortir le manuscrit dactylographié.
Relu, remanié, mais à peine : c’est ce qui fait tout le prix du Glacis. Il aurait pu être tentant, des années après, de revisiter cette histoire simple – la découverte de la sale guerre, le petit monde policé et provincial-étouffant, sur fond d' horreurs qu'on ignore de son mieux, l’expulsion au terme d’une année scolaire – avec le savoir et le recul acquis. Mais non. Ce qui différencie ce court roman des très nombreuses publications de l’année sur le sujet, c’est justement la façon dont il restitue, sans pittoresque aucun, sans pathos, ce qu’était la guerre, vue à hauteur de jeune femme française progressiste arrivant, sans enthousiasme aucun, dans l'Algérie de 1956. On approche alors de cette question qui nous traverse parfois, en lisant, des décennies plus tard : « Qu’aurais-je fait ? Pensé ? »

Agrandissement : Illustration 2

Le Glacis – le nom est bien réel, créativité coloniale – est un large boulevard qui tranche aussi sûrement Sidi Bel Abbès en deux parties qu’un mur : européens ici, arabes ( surnommé « village nègre ») là. Pour Laure Delessert, la narratrice, le choc est progressif et profond. Tout a lieu, en amorti, en léger retrait : arrestations, interrogatoires, assassinats, tandis que se tient le bal des officiers, que le problème urgent est de trouver où se loger ( et surtout pas au-delà du Glacis section noble). Les « barbelés, chicanes et chevaux de frise », oui, mais aussi dans la campagne « les vignes restées rouges », l’animation, l’épicerie, « la longaniza et les pois chiches qui serviront au souper » du quartier espagnol, des femmes qui passent , légèrement voilées, « elles le retenaient entre leurs dents », l’amitié menacée avec Elena, femme libre et chaleureuse, mais qui s’est rangée sans hésiter aux côtés de l’armée française.
Laure Delessert parle net et sans précaution, questionne et s'indigne. Pour autant, elle arrive avec un bel appétit de vivre, a un amant républicain espagnol qui ne lui dit pas tout, on la trouve « mal nippée ». Elle ne devrait pas lire Le Monde, c’est mal vu. Elle découvre qu’elle aime enseigner aux jeunes visages tournés vers elle, et découvre aussi que la police peut faire irruption au lycée pour interroger une élève.
Elle pourrait aller du cabinet d’esthéticienne à la salle de gym, sauf qu’elle y emmène Naïma, et que cela fait scandale. Les juifs, les venus d’ailleurs sont à peine mieux considérés.
Elle assiste aux obsèques d’un « mort pour la France », et ce n’est pas rien. « Les gens n’écoutent pas. Ils regardent autour d’eux, ils veulent se venger ». Même pour Laure, le sentiment d'appartenance, les références communes entrent fugitivement en conflit avec les idées.
La plaie vive de l’Occupation est encore toute proche, en 1956, on est patriote, et défendre l’Algérie française, c’est défendre le pays, les choix ne sont pas si évidents, alors.
« Au fond, je me dis que c’est par patriotisme que j’étais anticolonialiste », dit Monique Rivet, au fond du café. Combien pouvaient penser ainsi ? Elle a fait de sa narratrice la fille d’un homme mort en déportation. Dans la vraie vie, son père, officier, était dans la Résistance. Il a engendré trois enfants de gauche et antimilitaristes, ce qui ne le troublait guère : « vous ne le serez jamais autant que moi. ». Laure Delessert apprend que le maire de la ville a été emmené au camp de Lodi, préventivement, en somme : il était un élu du parti communiste et, horreur, avait ouvert le Conservatoire aux « indigènes »… Monique Rivet, elle, alors proche du PC, a bien failli devenir « pied-rouge », et revenir aider à construire le pays. Ca ne s’est pas fait.

Agrandissement : Illustration 3

Regard là-bas vers les voitures : « il y a des choses qui n’arrivent pas ». Un temps : « J’en ai réussi d’autres ». Au rang des « choses qui n’arrivent pas » elle place aussi – jusqu’à la miraculeuse rencontre avec Anne-Marie Métailié – l’aventure de l’édition. Trois romans publiés, pourtant, chez Flammarion puis Gallimard, l’intérêt de Jérôme Lindon, le soutien de Jacques Marchand et Dominique Aury, mais un ensablement. « Tantôt à Strasbourg, tantôt aux Etats-Unis, et j’étais assez en dehors » Et puis, on la pousse à le donner à lire, ce Glacis, et elle finit par gravir l’escalier des éditions Métailié. Elle ne voulait même pas essayer les Grandes Maisons. Là, tout en haut, une dame débordée qui soupire et lui montre la pile – conséquente – des tapuscrits du jour.
Et pourtant, comme dans les contes de fées éditoriaux, le téléphone sonne deux jours plus tard. Anne-Marie Métailié, la dame débordée, a jeté un coup d’œil, s'est enthousiasmée. Miracle des noms, la ville dans le roman est rebaptisée El Djond , mais le Glacis, l’éditrice a reconnu sur le champ: elle est native de Sidi Bel Abbès…
Ravie mais pas plus tourneboulée que ça, Monique Rivet entend poursuivre comme elle l’a toujours fait. En écrivant. Notamment ce journal qu’elle tient depuis l’âge de quinze ans, qu’on imagine lucide, impertinent, humaniste. A l'image de l’héroïne du Glacis, qui de crânes critiques en amant suspect bascule soudain du côté de l’ombre, dans un commissariat encore français.
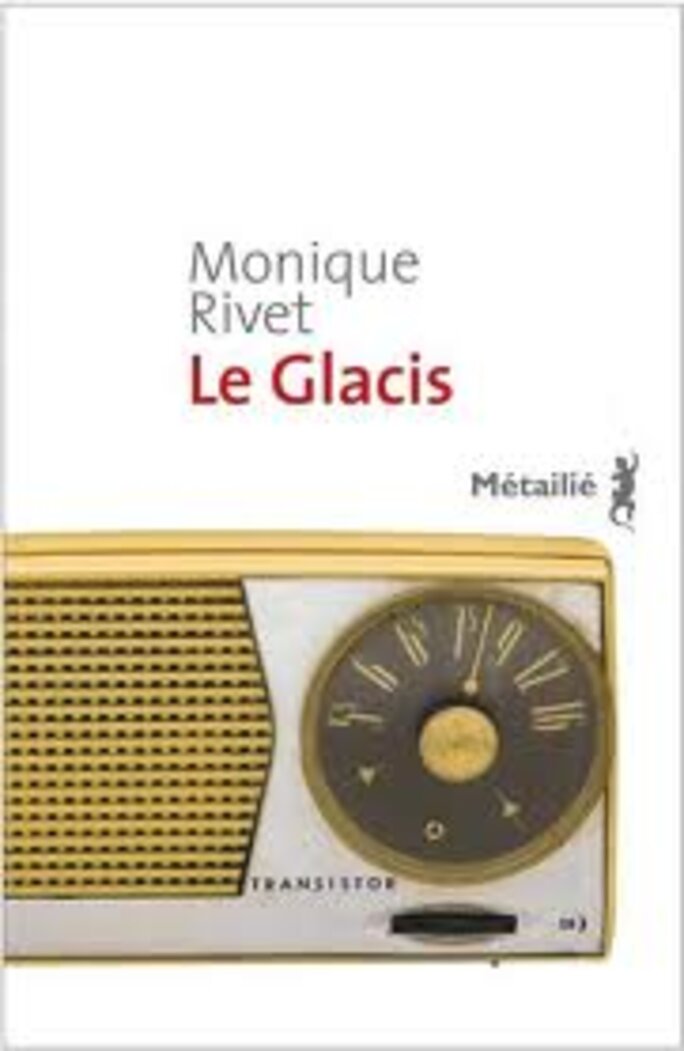
Le Glacis, Monique Rivet , Editions Métailié 2012, 131 pages, 14 €.



