L’IFRAE (1) et l’INALCO accueillent les 5 et 6 décembre 2022 l’historien Christopher E. Goscha pour deux conférences sur les thèmes « Écrire une "nouvelle" histoire du Vietnam : enjeux, défis et quelques regrets » (5 décembre 2022) et « L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur "un oubli indochinois" » (6 décembre 2022). Ce sont des conférences ouvertes à toute personne intéressée (sous réserve des places disponibles dans la salle).
Il y a quelques semaines, je m’entretenais avec un militant algérien qui me demandait des nouvelles du Vietnam, qui, pour lui, était un « trou noir », autrement dit qu’il ne savait rien de ce pays et qu’on n’en parlait jamais. La discussion portait sur les droits de l’Homme mais résonnait en moi car cela décrit la situation générale quand on parle du Vietnam, en dehors du milieu des spécialistes (et j’exclus les touristes de retour du Vietnam qui trouvent que les Vietnamiens sont souriants et accueillants, qu’on y mange bien et que c’est magnifique).
C’est pourquoi ces conférences, initialement prévues en septembre 2022, seront, à n’en point douter, riches d’intérêt. D’un point de vue académique, il est toujours enrichissant de dialoguer avec des chercheurs étrangers et issus d’autres universités. Christopher Goscha est à cet égard particulièrement intéressant car ce spécialiste de l’histoire de la péninsule indochinoise, a un parcours très international : Georgetown University, Australian National University, Université Paris Diderot (Paris VII, aujourd’hui Université Paris Cité), École Pratique des Hautes Études… Il enseigne actuellement les relations internationales, l’histoire des guerres du Vietnam et l’histoire globale à l’Université du Québec à Montréal (UQÀM).
Il s’intéresse plus particulièrement à la guerre froide en Asie et à la décolonisation, toujours avec une approche régionale ou globale, et multidisciplinaire, comme le montre le titre même de sa thèse « Le contexte asiatique de la guerre franco-vietnamienne : Réseaux, relations et économie (1945-1954) ».
Une histoire moins (politiquement) passionnée mais non moins passionnante

Christopher Goscha fait partie d’une lignée d’historiens qui se sont attachés à écrire une histoire du Vietnam fondée plus sur les faits et sur une vision globale que sur l’idéologie ou les lubies nationalistes. Il a ainsi émis plusieurs hypothèses audacieuses et contre-intuitives mais solidement étayées comme l’accommodement des Vietnamiens à l’Indochine française coloniale qui, d’une certaine façon, répondait à leurs aspirations, y compris expansionnistes, et a été déterminante dans l’émergence de la nation vietnamienne moderne et actuelle (voir son livre Indochine ou Vietnam ?, édition Vendémiaire, 2015).
Ce ne peut être donc que sain d’écouter, lors de la première conférence, un tel historien en ces temps de débat (politicien) sur le roman national, de falsification tragique de l’histoire, en Russie par exemple, ou d’utilisation de l’histoire pour justifier la censure jusqu’au grotesque. À cet égard, et tout récemment, le Vietnam a fait jouer l’interdiction de « déformer l’histoire, nier les réalisations révolutionnaires ou offenser la nation ou ses héros » (loi sur la presse, amendée en 2016) pour faire retirer du catalogue de Netflix diffusé au Vietnam le drama coréen Little Women. En l’espèce, les quelques minutes litigieuses concernaient un personnage (fictif) évoquant le ratio d’un soldat coréen tué pour 20 combattants communistes vietnamiens tués lors de la guerre du Vietnam. L’affaire ne serait que risible si la liberté d’expression n’était pas réduite, dans ce pays, à la portion congrue et si le régime vietnamien n'utilisait pas lui-même l'histoire à des fins politiques (2).
La seconde conférence se propose de traiter du mystère de l’occultation dans l’opinion française de l’expérience coloniale et de celle de la décolonisation en Indochine française. Cet « oubli indochinois » est à comparer avec l’extrême sensibilité de l’opinion quand il s’agit de l’Algérie. Le débat en France sur la colonisation et la décolonisation semble en effet inextricablement enchaîné à la question algérienne.
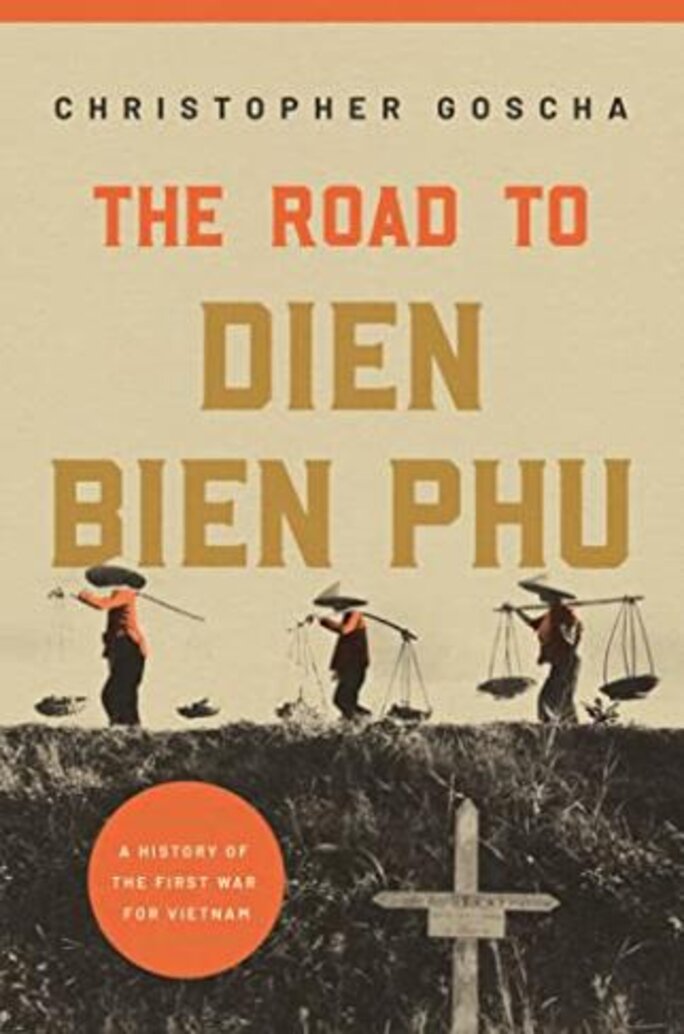
C’est en Algérie, en 2017, que le Président Macron relance la polémique en décrivant la colonisation comme un « crime contre l’humanité ». Tout récemment, c’est un éminent politicien français qui s’est offusqué de la disparition de la langue française (réalisée en fait dès 1977) sur les billets de banque algériens (avec la circonstance aggravante d’ajouter une traduction en anglais). Même s’il s’agissait avant tout d’une manœuvre politicienne, la réaction est à comparer avec l’absence totale de réaction de la France ou des Français lorsque, à la fin des années 1990, soit trois ou quatre ans après le mémorable Sommet de la Francophonie à Hanoi, le Vietnam annonçait que désormais les communications avec les Nations Unies se feraient en anglais et non plus en français (mais avouons que cet « événement » relève du confidentiel)…
Les explications traditionnelles sur la différence d’appréciation ont sans doute une pertinence : En Indochine, c’était l’armée de métier qui se battait alors qu’en Algérie, c’étaient les conscrits ; la communauté française en Indochine était minuscule par rapport à celle d’Algérie ; l’Algérie, c’est la porte à côté, l’Indochine l’autre bout du monde… Mais peut-être y a-t-il autre chose.
D’une certaine façon, le film « Les Centurions » (1966) de Mark Robson (avec Anthony Quinn et Alain Delon) est assez révélateur. L’histoire commence, en guise d’introduction, avec les toutes dernières heures du siège de Điện Biên Phủ en 1954, montrée comme une bataille dans les règles avec des soldats en uniforme de part et d’autre. La caméra passe très vite sur la reddition, l’internement et la libération des soldats français et coloniaux pour traiter, pour l’essentiel du film, à la guerre en Algérie décrite comme une lutte fratricide (entre anciens frères d’arme, histoire d’amour interdit), une guerre sale d’insurrection/contre-insurrection (avec son lot de torture et autres atrocités) et un dénouement tragique. En somme, une affaire rondement classée (même si c’est une défaite) dans le premier cas, une affaire qui prend aux tripes dans le second.
Le film, même si ce n’est sans doute pas son objet, laisse cependant deviner qu’il existe un lien entre la décolonisation en Indochine française et celle en Algérie. D’un point de vue historique, mais aussi mémoriel, il est sans doute donc nécessaire de se pencher sur et se souvenir de ce qui s’est passé à l’autre bout du monde entre 1945 et 1954.
Nous ignorons ce qu’en dira Christopher Goscha (nous pouvons en avoir un aperçu dans son intéressant article de septembre 2022), mais dans tous les cas, ces conférences arrivent à point nommé et nous ne saurons encourager les personnes intéressées à y assister.
- La conférence « Écrire une "nouvelle" histoire du Vietnam : enjeux, défis et quelques regrets » aura lieu le 5 décembre 2022, de 9h30 à 11h30, à l’Inalco (65, rue des Grands Moulins, 75013 Paris), en salle 4.18 (4e étage)
- La conférence « L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur "un oubli indochinois" » aura lieu le 6 décembre 2022, de 12h00 à 14h00, à l’Inalco (65, rue des Grands Moulins, 75013 Paris), en salle 5.09 (5e étage)
--------------------------------------
(1) L’Institut Français de Recherche sur l’Asie de l’Est (IFRAE / UMR 8043) est une équipe de recherche rattachée à l’Inalco, à l’université Paris Cité et au CNRS, mise en place au 1er janvier 2019. Composée de soixante-cinq chercheurs et enseignants-chercheurs, ainsi que plus de quatre-vingt-dix doctorants et postdoctorants, elle constitue l’une des plus grandes unités de recherche sur l’Asie de l’Est en France et en Europe.
(2) Un rapport de la FIDH et du VCHR révélait ainsi devant les Nations Unies que :
Le Professeur Dương Trung Quốc, membre de l’Assemblée Nationale et Secrétaire-général de l’Association vietnamienne des études historique, disait que l’enseignement de l’histoire était trop « politisée », causant le désintérêt total des étudiants pour le sujet. « L’enseignement de l’histoire dans les écoles est devenu une arène pour la propagande, conçue pour instiller chez les étudiants un certain nombre de valeurs imposées d’en-haut ». Durant les dernières décennies, dit-il encore, « les livres d’histoire au Vietnam sont entièrement consacrés à “la libération de notre peuple”, aux “quatre mille ans de résistance”, aussi tout est expliqué dans une perspective politique. Cela pouvait se concevoir en temps de guerre, quand le peuple voulait à tout prix vaincre l’ennemi. Mais c’est très différent en temps de paix. C’est précisément cette “politisation” qui a sclérosé l’enseignement de l’histoire et fait que les [jeunes] ont perdu confiance en l’histoire ». (Violations des droits économiques, sociaux et culturels au Vietnam, Rapport alternatif sur la mise en œuvre du PIDESC en République Socialiste du Vietnam, FIDH et VCHR, Genève, 10 novembre 2014, voir page 20) (notre traduction de l’anglais).



