
Agrandissement : Illustration 1

Cédric Lépine : Comment êtes venus à vous intéresser de près à la maladie d'Alzheimer ?
Roger Gil : La maladie d’Alzheimer concerne les médecins de famille, les neurologues, les psychiatres, les gériatres. C’est donc la neurologie qui m’a conduit à « apprendre » la maladie d’Alzheimer tandis que la neuropsychologie m’a conduit à m’immerger dans les liens entre le fonctionnement du cerveau, ses ressources immenses comme son immense fragilité. Mais le cerveau ne prend sens que comme interface entre l’être humain et lui-même comme entre l’être humain et le monde. Aussi l’étape capitale fut la rencontre des personnes atteintes de cette maladie, de leurs familles. C’était encore l’époque où l’on parlait de démences séniles, terme doublement stigmatisant et inexact. La sénilité n’est pas une période de la vie mais une manière dévalorisante de désigner l’avancée en âge. Les démences appartiennent à une terminologie dépassée, qui renvoyait à des maladies de l’esprit, alors qu’il s’agit de maladies du cerveau. Et on peut ajouter enfin que si le vieillissement est un facteur de risque de la maladie d’Alzheimer, elle peut aussi survenir chez de jeunes adultes. Sans compter qu’il ne faut pas oublier non plus les maladies apparentées.
C. L. : Pourquoi avoir choisi la forme d'un dialogue pour présenter vos deux démarches ?
R. G. : Parce que le dialogue plonge dans l’authenticité de notre démarche, celle d’une rencontre, suivie d’autres rencontres dans le cadre de conférences, de débats, initiés à Poitiers sous l’impulsion de France Alzheimer Vienne. Chacun de nous a alors appris à réagir aux propos de l’autre. J’ai découvert ainsi l’approche Carpe Diem qui est une approche humaniste des personnes atteintes d’Alzheimer. Mon approche était médicale. Le plus souvent ces approches se côtoient sans se rencontrer. Or j’ai trouvé que l’approche de Nicole Poirier était en cohérence avec la neuropsychologie qui imprégnait mon approche médicale et que ces deux approches pouvaient s’unir pour tenter de mieux accompagner les malades et leurs familles.
C. L. : Pouvez-vous parler de la philosophie Carpe Diem ?
R. G. : Je laisserai Nicole Poirier s’exprimer sur ce sujet. Je peux seulement dire ce qui m’a séduit dans cette philosophie : considérer d’abord non ce que la personne malade a perdu mais ce qui lui reste. On dit par exemple que la maladie d’Alzheimer est une maladie de la mémoire. C’est vrai mais c’est aussi faux car l’être humain dispose de multiples formes de mémoire et certaines sont longtemps préservées par la maladie. On dit aussi que certains malades sont apraxiques, car ils ne peuvent pas exécuter certains gestes alors que ces mêmes gestes peuvent être réalisés de manière empathique. Et c’est ainsi comme l’exprime Nicole Poirier que la société peut changer son regard sur les personnes malades.
C. L. : Quelles possibilités pour retransposer l'expérience Carpe Diem également en France ?
R. G. : À défaut de transposer, je dirais plutôt qu’il faut voir comment adapter l’expérience Carpe Diem en France en faisant de Carpe Diem un modèle, un exemple pour inspirer les structures, les organisations, les équipes qui accompagnent les personnes malades. Car Carpe Diem va de l’accompagnement quotidien aux modalités d’organisation de cet accompagnement, par exemple comment faire pour que le domicile et l’institution (comme l’EHPAD) participent d’un projet commun avec des ressources humaines communes. Est-ce une utopie ? N’est-ce pas l’un des chemins vers une société inclusive ?
C. L. : Quel est l'état de la recherche actuelle à l'égard de la maladie d'Alzheimer ?
R. G. : La recherche se poursuit même si les premiers médicaments n’ont pas donné les résultats espérés. Mais il faut garder confiance. De nombreux produits sont en cours d’étude. Il faudra peut-être du temps… Mais qui sait ? La tâche est immense car il y a la maladie d’Alzheimer (qui représente environ la moitié des maladies neurodégénératives) mais il y a aussi les maladies apparentées qui, sous des apparences apparemment proches, sont très différentes. On oublie trop souvent les « démences » liées autrefois à la syphilis : elles ont été vaincues par la pénicilline ! Et plus près de nous, ce qui a été appelé le « complexe démentiel lié au SIDA » a été lui aussi vaincu !
Mais il faut aussi penser à la prévention de la maladie même si elle ne l’éradiquera pas : prendre soin de sa « réserve » cérébrale en lisant, en se cultivant, en travaillant, en faisant du jardinage, en portant attention à autrui, bref en « étant-au-monde » en fonction de ses goûts, de ses inclinations, bref, comme disait Spinoza « persévérer dans son être ». Mais aussi plus prosaïquement soigner ses facteurs de risque vasculaire comme l’hypertension artérielle.
C. L. : Est-ce que la population est selon vous bien informée sur la maladie d'Alzheimer ?
R. G. : Je ne sais pas. Il faut toujours être humble en matière d’information. Il faudrait développer une pédagogie de l’information, ce qui veut dire s’ouvrir même à ce qui ne nous concerne pas dans l’immédiat… apprendre à voir « loin »… Mais c’est difficile ! Nous vivons dans un monde qui regorge d’informations, ce qui aboutit à un saupoudrage !
C. L. : Y a-t-il des facteurs particuliers qui conduisent au développement à l'heure actuelle de la maladie d'Alzheimer ?
R. G. : C’est l’allongement de la durée de vie, liée aux progrès de la médecine dans les domaines des maladies infectieuses, cardio-vasculaires et du cancer qui expliquent l’augmentation de la prévalence (nombre de cas dans la population générale) de la maladie d’Alzheimer dont l’âge est un facteur de risque. Toutefois l’incidence de la maladie, c’est-à-dire le nombre nouveau de cas par an commence à s’infléchir, ce qui montre que la prévention commence à produire ses effets.
C. L. : Quels sont les pays les plus touchés ?
R. G. : Ce sont les pays les plus riches, donc les pays dits industrialisés, ceux dans lesquels la durée de vie est la plus longue qui sont les plus touchés par la maladie d’Alzheimer.
C. L. : La maladie d'Alzheimer conduit à repenser les liens de solidarité entre les générations : quel constat faites- vous à cet égard de l'évolution de la société, en France comme au Canada ?
R. G. : En France on pense trop le vieillissement de la population et la maladie d’Alzheimer en particulier en termes de coût, et ceci peut conduire à distendre les liens intergénérationnels comme peut le faire l’opposition entre les retraités et les actifs. Or sur le plan économique et sociétal cette distinction qui oublie le passé des uns et néglige l’avenir des autres conduit à une méconnaissance de la solidarité des générations qui est non une inclination mais un état de fait qu’il faut conscientiser. Car en vérité, le vieillissement de la population ne coûte pas mais rapporte à la société.
Le prix des séjours dans les EHPAD (maisons de retraite) engloutit les pensions et les économies des personnes âgées et l’allocation de solidarité aux personnes âgées comme l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) sont des aides certes heureuses mais marginales : tous ces revenus des personnes âgées, liés à leur travail ou pour une petite partie à la solidarité nationale sont immédiatement déversées dans l’économie du pays, ont stimulé la construction de maisons de retraite et suscité la création d’un nombre considérable d’emplois dans le secteur médico-social et plus globalement d’aide à la personne. Et comment ne pas évoquer la silver économie devenue une filière industrielle lancée en France en 2013 qui représente 92 milliards d’euros et qui est précisément destinée à répondre aux besoins des personnes âgées ? Elle s’étend des technologies les plus avancées de la domotique et de la robotique jusqu’à l’habitat, la mobilité, le tourisme pour seniors... en passant par les aides techniques les plus simples et toute la gamme des services de téléassistance ou bouquets de services. Il est prévu qu’en Europe de l’Ouest, les 60 ans et plus devraient générer plus de 60% de la hausse de la consommation d’ici à 2030. Il s’ensuit que toutes les mesures qui tendent à réduire les revenus des plus âgés ne peuvent que retentir défavorablement sur l’économie du pays tout entier. Voilà de quoi transformer une solidarité de fait en solidarité de cœur en œuvrant sans cesse pour une société qui sécrète du lien intergénérationnel et qui sache allier la solidarité avec la fraternité.
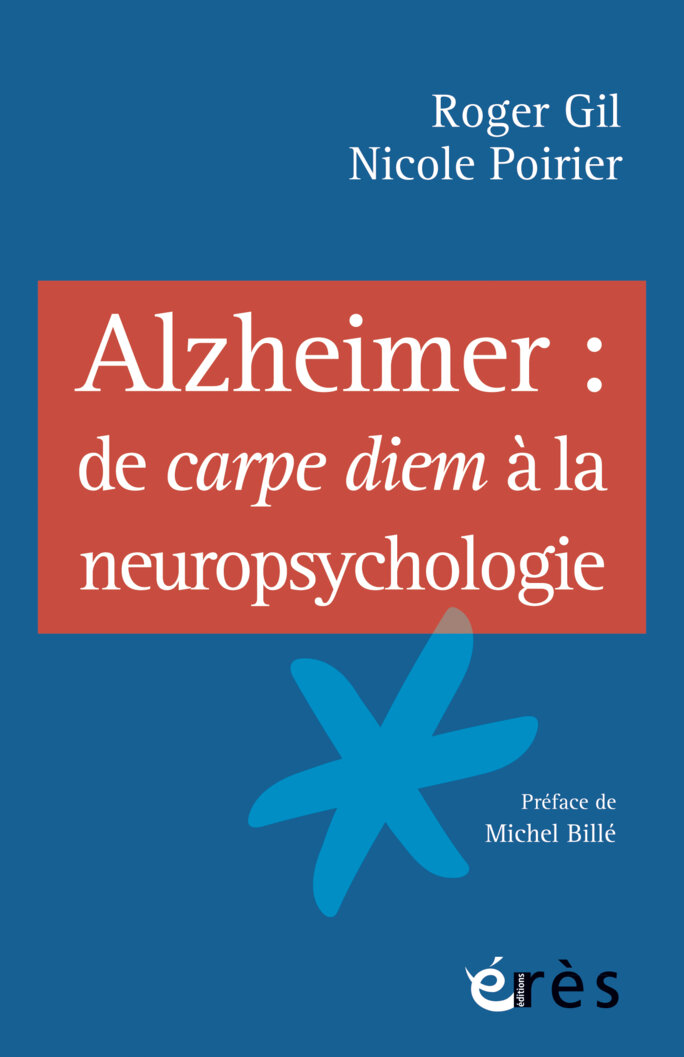
Agrandissement : Illustration 2
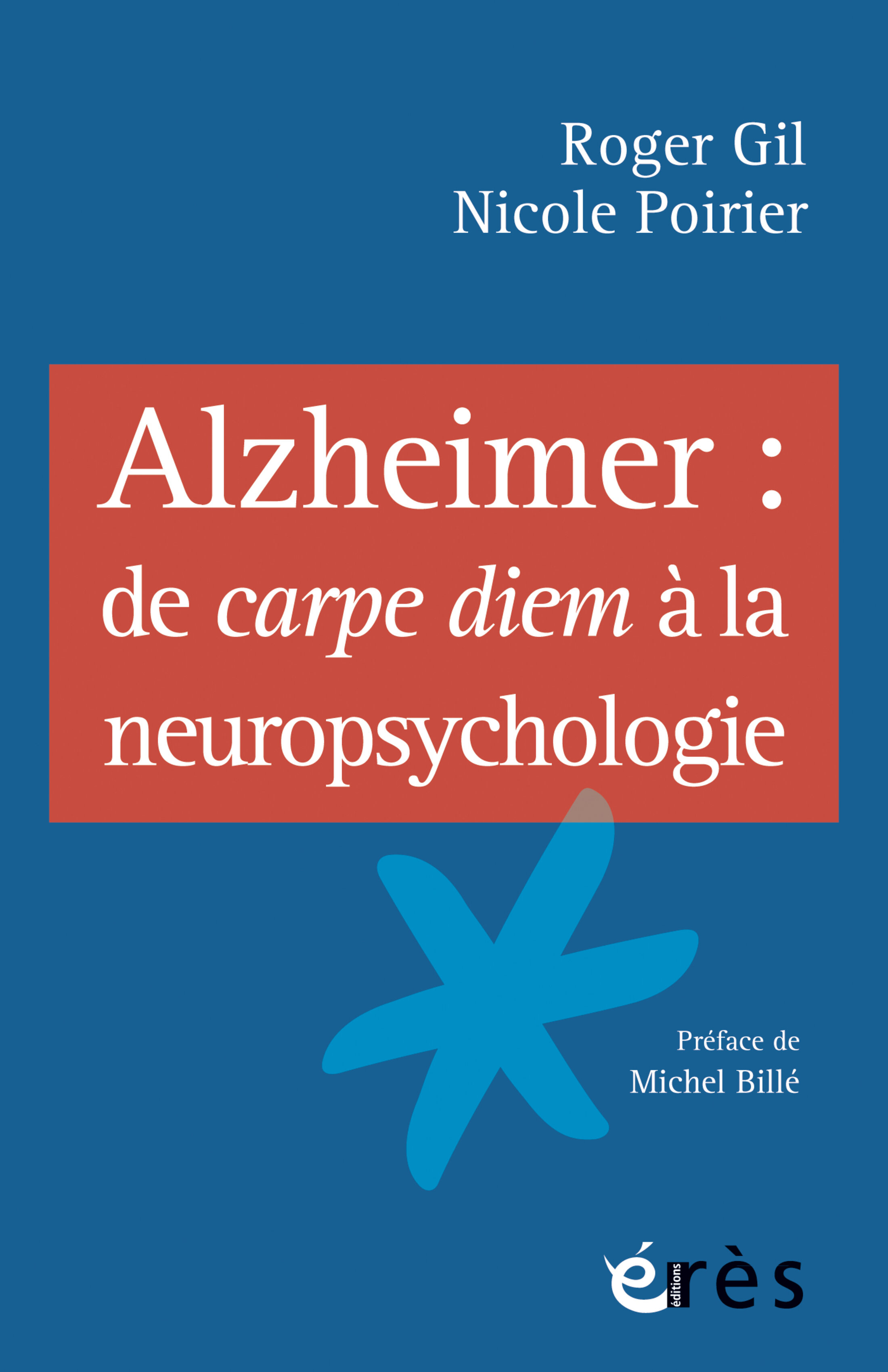
Alzheimer : de carpe diem à la neuropsychologie
de Roger Gil, Nicole Poirier
Nombre de pages : 272
Date de sortie (France) : 20 septembre 2018
Éditeur : érès



