
Agrandissement : Illustration 1

Cédric Lépine : Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser autant à la filmographie de Lars von Trier ?
Natalia Laranjinha : Ce qui m’a toujours intéressé chez Lars von Trier c’est sa capacité à se renouveler, à transgresser les modèles et les limites, comme si chaque film était une nouvelle expérience. Il a approché plusieurs genres comme le film noir avec Element of crime, le théâtre avec Dogville et Mandarlay ou encore le music-hall avec Dancer in the Dark. Il change toutefois les conventions cinématographiques de chaque genre ce qui produit une expérience nouvelle pour le spectateur. Et ce fut aussi la question des émotions qui parcourent ses films et qu’il approche d’une manière si pécuniaire.
C. L. : Quelle a été votre approche de ses films ? Leur donnez-vous la même importance dans votre étude ?
N. L. : J’ai essayé de parcourir tous ses films, il m’a paru qu’une étude de Lars von Trier n’aurait pas été complète en choisissant seulement certains de ses films, mais Dogville, Antichrist et Melancholia ont fini par recevoir une place plus importante.
C. L. : Pouvez-vous définir le concept de la surface-peau ?
N.L. : À partir du concept de surface défini, entre autres, par Gilles Deleuze et François Dagognet et celui du moi-peau de Didier Anzieu, j’ai abouti à celui de surface-peau. Le concept de surface-peau explique, à mon avis, les personnages principaux (la majorité des femmes) des films de Lars von Trier. Ce sont des personnages qui révèlent leur profondeur à la surface et qui réagissent d’une manière quasi spontanée, comme la peau, à la vie, et surtout aux émotions. Cette surface-peau est parcourue d’une énergie pathétique, émotionnelle, toujours démesurée qui domine les personnages et elle est l’espace de meurtrissures, de scarifications et de déchirures auxquelles le spectateur assiste (et parfois éprouve).
À partir aussi du concept de surface, j’ai approché les images, sa manière de filmer puisqu’il produit une surface-écran polie et une autre fissurée qui singularisent son esthétique.
C. L. : Quelle place particulière les femmes occupent dans le cinéma de Lars von Trier ?
N.L. : Les critiques sont connus à l’égard de l’approche de Lars von Trier face aux femmes, surtout l’accusation d’être misogyne. Toutefois, il me semble qu’une autre approche est possible et plus proche de ce qu’il montre dans ses films. Il y a une idée récurrente, celle que l’homme manifeste le logos alors que la femme manifeste le pathos. Le cinéaste critique sévèrement notre construction d’une société excessivement rationnelle et intellectualisée, ses personnages masculins (comme dans Antichrist ou Melancholia) essayent à tout prix de remettre l’ordre face à ce qui fuit toute rationalité (la mort tragique d’un fils et la fin du monde). Alors que la femme refuse cette rationalité, elle est capable de mourir pour sauver son fils de la cécité (Dancer in the Dark) ou d’échanger sa vie pour sauver celle de l’homme qu’elle aime (Breaking the Waves). Les femmes font montre d’une capacité d’abnégation (qui peut mener au sacrifice) et d’une disposition à embrasser les émotions, dans ce processus elles ressentent et perçoivent la vie d’une manière qui ne peut qu’échapper et même faire peur à l’homme. Cela ne veut pas dire que les femmes soient privées de logos ou les hommes de pathos. D’ailleurs dans Dogville, nous voyons Grace qui aboutit au logos et le résultat est sa terrible vengeance des habitants. C’est une question de choix.
C. L. : Quelles étaient vos intentions en éditant cet ouvrage ?
N.L. : Il n’y avait pas beaucoup d’études sur Lars von Trier, du moins une étude qui approchait ses films par le biais de ce qui me semble fondamentale à savoir cette question des émotions. Je voulais comprendre pourquoi et comment les émotions prennent le devant chez les personnages et quelles en sont les conséquences.
C. L. : Pensez-vous qu'il est essentiel pour appréhender un film de Lars von Trier de l'associer à toute sa filmographie ?
N.L. : Non, il me semble que Lars von Trier, comme les grands artistes, se guide par une idée ou une pensée qui est récurrente et que l’on retrouve dans tous ses films mais toujours d’une manière différente. Toutefois, il est très intéressant de voir ses changements, sa maturité depuis par exemple Images of Relief de 1982. On s’aperçoit par exemple qu’il délaisse peu à peu les questions d’ordre technique et même les restrictions du Dogme 95 pour s’aventurer dans d’autres expériences cinématographiques.
C. L. : Quel lien nourrit le cinéaste avec l'histoire du cinéma ?
N.L. : Lars von Trier a conquis sa place à côté d’autres grands cinéastes de sa génération comme Kiarostami, Kitano ou Kusturica, et sans aucun doute qu’on l’aime ou le déteste, il a enrichi le cinéma par son esthétique provocatrice et innovatrice.
C. L. : Avez-vous d'autres projets d'écriture de livres consacrés au cinéma ?
N.L. : Oui, je travaille en ce moment sur le post-humanisme au cinéma.
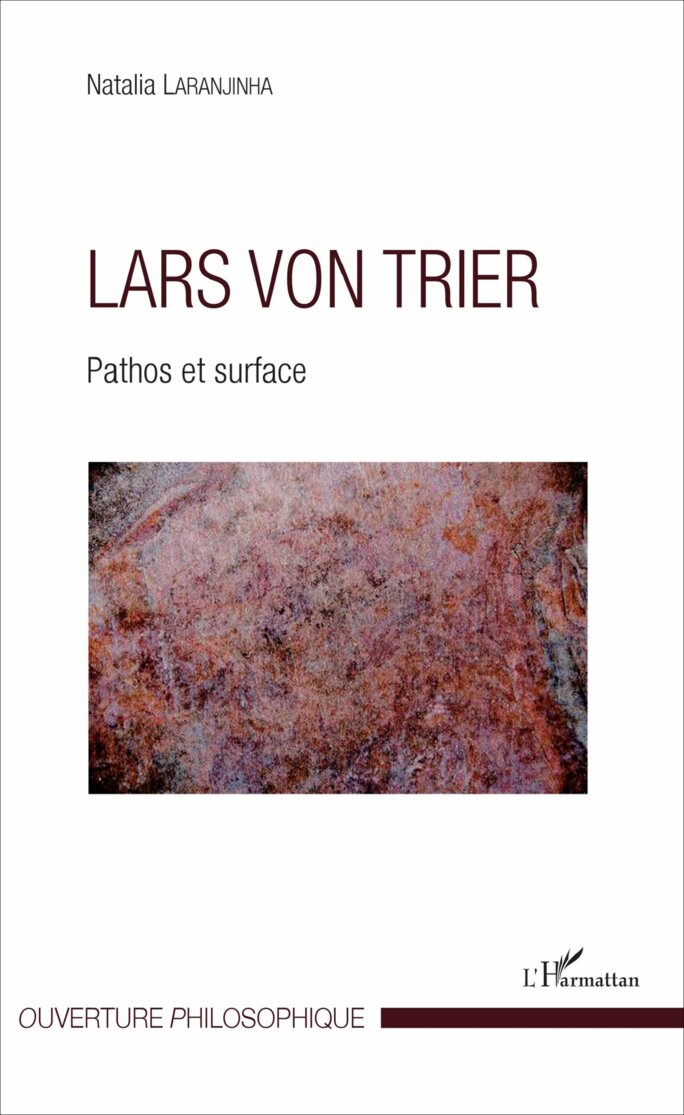
Agrandissement : Illustration 2

Lars von Trier. Pathos et surface
de Natalia Laranjinha
Nombre de pages : 230
Date de sortie (France) : 1er mai 2017
Éditeur : L'Harmattan
Collection : Ouverture Philosophique



